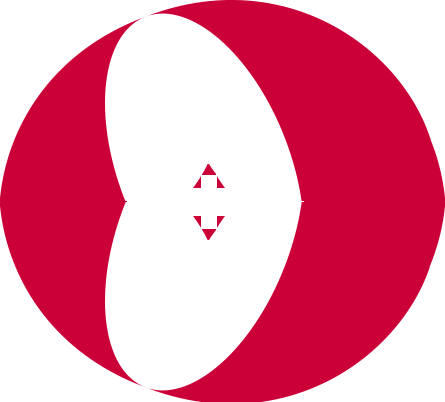| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
 |
Alexandre Dumas Le Comte de Monte-Cristo 6 volumes C. Lévy, 1889. QUATRIÈME VOLUME |
|
XVIII LE PROCÈS-VERBAL. Noirtier attendait, vêtu de noir et installé dans son fauteuil. Lorsque les trois personnes qu’il comptait voir venir furent entrées, il regarda la porte, que son valet de chambre ferma aussitôt. — Faites attention, dit Villefort bas à Valentine qui ne pouvait celer sa joie, que si M. Noirtier veut vous communiquer des choses qui empêchent votre mariage, je vous défends de le comprendre. Valentine rougit, mais ne répondit pas. Villefort s’approcha de Noirtier. — Voici M. Franz d’Épinay, lui dit-il ; vous l’avez mandé, monsieur, et il se rend à vos désirs. Sans doute nous souhaitons cette entrevue depuis longtemps, et je serai charmé qu’elle vous prouve combien votre opposition au mariage de Valentine était peu fondée. Noirtier ne répondit que par un regard qui fit courir le frisson dans les veines de Villefort. Il fit de l’œil signe à Valentine de s’approcher. En un moment, grâce aux moyens dont elle avait l’habitude de se servir dans les conversations avec son père, elle eut trouvé le mot clef. Alors elle consulta le regard du paralytique, qui se fixa sur le tiroir d’un petit meuble placé entre les deux fenêtres. Elle ouvrit le tiroir et trouva effectivement une clef. Quand elle eut cette clef et que le vieillard lui eut fait signe que c’était bien celle-là qu’il demandait, les yeux du paralytique se dirigèrent vers un vieux secrétaire oublié depuis bien des années, et qui ne renfermait, croyait-on, que des paperasses inutiles. — Faut-il que j’ouvre le secrétaire ? demanda Valentine. — Oui, fit le vieillard. — Faut-il que j’ouvre les tiroirs ? — Oui. — Ceux des côtés ? — Non. — Celui du milieu ? — Oui. Valentine l’ouvrit et en tira une liasse. — Est-ce là ce que vous désirez, bon père ? dit-elle. — Non. Elle tira successivement tous les autres papiers, jusqu’à ce qu’il ne restât plus rien absolument dans le tiroir. — Mais le tiroir est vide maintenant, dit-elle. Les yeux de Noirtier étaient fixés sur le dictionnaire. — Oui, bon père, je vous comprends, dit la jeune fille. Et elle répéta, l’une après l’autre, chaque lettre de l’alphabet ; à l’S, Noirtier l’arrêta. Elle ouvrit le dictionnaire, et chercha jusqu’au mot secret. — Ah ! il y a un secret ? dit Valentine. — Oui, fit Noirtier. — Et qui connaît ce secret ? Noirtier regarda la porte par laquelle était sorti le domestique. — Barrois ? dit-elle. — Oui, fit Noirtier. — Faut-il que je l’appelle ? — Oui. Valentine alla à la porte et appela Barrois. Pendant ce temps, la sueur de l’impatience ruisselait sur le front de Villefort, et Franz demeurait stupéfait d’étonnement. Le vieux serviteur parut. — Barrois, dit Valentine, mon grand-père m’a commandé de prendre la clef dans cette console, d’ouvrir ce secrétaire et de tirer ce tiroir ; maintenant il y a un secret à ce tiroir, il paraît que vous le connaissez, ouvrez-le. Barrois regarda le vieillard. — Obéissez, dit l’œil intelligent de Noirtier. Barrois obéit ; un double fond s’ouvrit et présenta une liasse de papiers nouée avec un ruban noir. — Est-ce cela que vous désirez, monsieur ? demanda Barrois. — Oui, fit Noirtier. — À qui faut-il remettre ces papiers ? à M. de Villefort ? — Non. — À mademoiselle Valentine ? — Non. — À M. Franz d’Épinay ? — Oui. Franz, étonné, fit un pas en avant. — À moi, monsieur ? dit-il. — Oui. Franz reçut les papiers des mains de Barrois, et, jetant les yeux sur la couverture, il lut : « Pour être déposé, après ma mort, chez mon ami le général Durand, qui lui-même en mourant léguera ce paquet à son fils, avec injonction de le conserver comme renfermant un papier de la plus grande importance. » — Eh bien ! monsieur, demanda Franz, que voulez-vous que je fasse de ce papier ? — Que vous le conserviez cacheté comme il est, sans doute, dit le procureur du roi. — Non, non, répondit vivement Noirtier. — Vous désirez peut-être que monsieur le lise ? demanda Valentine. — Oui, répondit le vieillard. — Vous entendez, monsieur le baron, mon père vous prie de lire ce papier, dit Valentine. — Alors asseyons-nous, fit Villefort avec impatience car cela durera quelque temps. — Asseyez-vous, fit l’œil du vieillard. Villefort s’assit, mais Valentine resta debout à côté de son père, appuyée à côté de son fauteuil, et Franz debout devant lui. Il tenait le mystérieux papier à la main. — Lisez, dirent les yeux du vieillard. Franz défit l’enveloppe, et un grand silence se fit dans la chambre. Au milieu de ce silence, il lut : « Extrait des procès-verbaux d’une séance du club bonapartiste de la rue Saint-Jacques, tenue le 5 février 1815. » Franz s’arrêta. — Le 5 février 1815 ! C’est le jour où mon père a été assassiné ! Valentine et Villefort restèrent muets ; l’œil seul du vieillard dit clairement : Continuez. — Mais c’est en sortant de ce club, continua Franz que mon père a disparu ! Le regard de Noirtier continua de dire : Lisez. Il reprit : « Les soussignés Louis-Jacques Beaurepaire, lieutenant-colonel d’artillerie, Étienne Duchampy, général de brigade, et Claude Lecharpal, directeur des eaux et forêts, « Déclarent que, le 4 février 1815, une lettre arriva de l’île d’Elbe, qui recommandait à la bienveillance et à la confiance des membres du club bonapartiste le général Flavien de Quesnel, qui, ayant servi l’empereur depuis 1804 jusqu’en 1815, devait être tout dévoué à la dynastie napoléonienne, malgré le titre de baron que Louis XVIII venait d’attacher à sa terre d’Épinay. « En conséquence, un billet fut adressé au général de Quesnel, qui le priait d’assister à la séance du lendemain 5. Le billet n’indiquait ni la rue ni le numéro de la maison où devait se tenir la réunion ; il ne portait aucune signature, mais il annonçait au général que, s’il voulait se tenir prêt, on le viendrait prendre à neuf heures du soir. « Les séances avaient lieu de neuf heures du soir à minuit. « À neuf heures, le président du club se présenta chez le général : le général était prêt ; le président lui dit qu’une des conditions de son introduction était qu’il ignorerait éternellement le lieu de la réunion, et qu’il se laisserait bander les yeux en jurant de ne point chercher à soulever le bandeau. « Le général de Quesnel accepta la condition, et promit sur l’honneur de ne pas chercher à voir où on le conduirait. « Le général avait fait préparer sa voiture ; mais le président lui dit qu’il était impossible que l’on s’en servît, attendu que ce n’était pas la peine qu’on bandât les yeux du maître si le cocher demeurait les yeux ouverts et reconnaissait les rues par lesquelles on passerait. « — Comment faire alors ? demanda le général. « — J’ai ma voiture, dit le président. « — Êtes-vous donc si sûr de votre cocher, que vous lui confiez un secret que vous jugez imprudent de dire au mien ? « — Notre cocher est un membre du club, dit le président ; nous serons conduits par un conseiller d’État. « — Alors, dit en riant le général, nous courons un autre risque, celui de verser. « Nous consignons cette plaisanterie comme preuve que le général n’a pas été le moins du monde forcé d’assister à la séance, et qu’il y est venu de son plein gré. « Une fois monté dans la voiture, le président rappela au général la promesse faite par lui de se laisser bander les yeux. Le général ne mit aucune opposition à cette formalité : un foulard, préparé à cet effet dans la voiture, fit l’affaire. « Pendant la route, le président crut s’apercevoir que le général cherchait à regarder sous son bandeau : il lui rappela son serment. « — Ah ! c’est vrai, dit le général. « La voiture s’arrêta devant une allée de la rue Saint-Jacques. Le général descendit en s’appuyant au bras du président, dont il ignorait la dignité, et qu’il prenait pour un simple membre du club ; on traversa l’allée, on monta un étage, et l’on entra dans la chambre des délibérations. « La séance était commencée. Les membres du club, prévenus de l’espèce de présentation qui devait avoir lieu ce soir-là, se trouvaient au grand complet. Arrivé au milieu de la salle, le général fut invité à ôter son bandeau. Il se rendit aussitôt à l’invitation, et parut fort étonné de trouver un si grand nombre de figures de connaissance dans une société dont il n’avait pas même soupçonné l’existence jusqu’alors. « On l’interrogea sur ses sentiments, mais il se contenta de répondre que les lettres de l’île d’Elbe avaient dû les faire connaître… » Franz s’interrompit. — Mon père était royaliste, dit-il ; on n’avait pas besoin de l’interroger sur ses sentiments, ils étaient connus. — Et de là, dit Villefort, venait ma liaison avec votre père, mon cher monsieur Franz ; on se lie facilement quand on partage les mêmes opinions. — Lisez, continua de dire l’œil du vieillard. Franz continua : « Le président prit alors la parole pour engager le général à s’expliquer plus explicitement ; mais M. de Quesnel répondit qu’il désirait avant tout savoir ce que l’on désirait de lui. « Il fut alors donné communication au général de cette même lettre de l’île d’Elbe qui le recommandait au club comme un homme sur le concours duquel on pouvait compter. Un paragraphe tout entier exposait le retour probable de l’île d’Elbe, et promettait une nouvelle lettre et de plus amples détails à l’arrivée du Pharaon, bâtiment appartenant à l’armateur Morrel, de Marseille, et dont le capitaine était à l’entière dévotion de l’empereur « Pendant toute cette lecture, le général, sur lequel on avait cru pouvoir compter comme sur un frère, donna au contraire des signes de mécontentement et de répugnance visibles. « La lecture terminée, il demeura silencieux et le sourcil froncé. « — Eh bien ! demanda le président, que dites vous de cette lettre, monsieur le général ? « — Je dis qu’il y a bien peu de temps, répondit-il, qu’on a prêté serment au roi Louis XVIII, pour le violer déjà au bénéfice de l’ex-empereur. « Cette fois la réponse était trop claire pour que l’on pût se tromper à ses sentiments. « — Général, dit le président, il n’y a pas plus pour nous de roi Louis XVIII qu’il n’y a d’ex-empereur. Il n’y a que Sa Majesté l’empereur et roi, éloigné depuis dix mois de la France, son État, par la violence et la trahison. « — Pardon, messieurs, dit le général ; il se peut qu’il n’y ait pas pour vous de roi Louis XVIII, mais il y en a un pour moi : attendu qu’il m’a fait baron et maréchal de camp, et que je n’oublierai jamais que c’est à son heureux retour en France que je dois ces deux titres. « — Monsieur, dit le président du ton le plus sérieux et en se levant, prenez garde à ce que vous dites ; vos paroles nous démontrent clairement que l’on s’est trompé sur votre compte à l’île d’Elbe et qu’on nous a trompés. La communication qui vous a été faite tient à la confiance qu’on avait en vous, et par conséquent à un sentiment qui vous honore. Maintenant nous étions dans l’erreur : un titre et un grade vous ont rallié au nouveau gouvernement que nous voulons renverser. Nous ne vous contraindrons pas à nous prêter votre concours ; nous n’enrôlerons personne contre sa conscience et sa volonté ; mais nous vous contraindrons à agir comme un galant homme, même au cas où vous n’y seriez point disposé. « — Vous appelez être un galant homme connaître votre conspiration et ne pas la révéler ! J’appelle cela être votre complice, moi. Vous voyez que je suis encore plus franc que vous… |
|
Alexandre Dumas Le Comte de Monte-Cristo Tome 4 |