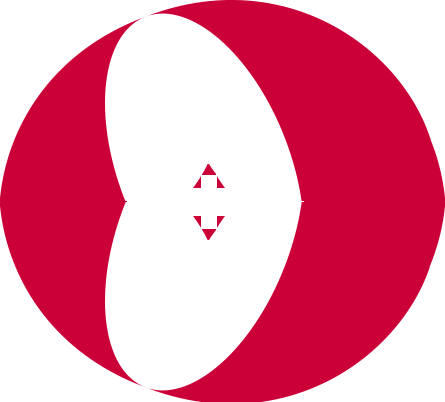| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
 |
Alexandre Dumas Le Comte de Monte-Cristo 6 volumes C. Lévy, 1889. QUATRIÈME VOLUME |
|
XVI LA PROMESSE. (cont.) — Oui, fit le vieillard. — C’est un nom irréprochable, que Maximilien est en train de rendre glorieux, car, à trente ans, il est capitaine de spahis, officier de la Légion d’honneur. Le vieillard fit signe qu’il se le rappelait. — Eh bien, bon papa, dit Valentine en se mettant à deux genoux devant le vieillard et en montrant Maximilien d’une main, je l’aime et ne serai qu’à lui ! Si l’on me force d’en épouser un autre, je me laisserai mourir ou je me tuerai. Les yeux du paralytique exprimaient tout un monde de pensées tumultueuses. — Tu aimes M. Maximilien Morrel, n’est-ce pas, bon-papa ? demanda la jeune fille. — Oui, fit le vieillard immobile. — Et tu peux bien nous protéger, nous qui sommes aussi tes enfants, contre la volonté de mon père ? Noirtier attacha son regard intelligent sur Morrel, comme pour lui dire : — C’est selon. Maximilien comprit. — Mademoiselle, dit-il, vous avez un devoir sacré à remplir dans la chambre de votre aïeule ; voulez-vous me permettre d’avoir l’honneur de causer un instant avec M. Noirtier ? — Oui, oui, c’est cela, fit l’œil du vieillard. Puis il regarda Valentine avec inquiétude. — Comment il fera pour te comprendre, veux-tu dire, bon père ? — Oui. — Oh ! sois tranquille ; nous avons si souvent parlé de toi, qu’il sait bien comment je te parle. Puis, se tournant vers Maximilien avec un adorable sourire, quoique ce sourire fût voilé par une profonde tristesse : — Il sait tout ce que je sais, dit-elle. Valentine se releva, approcha un siège pour Morrel, recommanda à Barrois de ne laisser entrer personne ; et après avoir embrassé tendrement son grand-père et dit adieu tristement à Morrel, elle partit. Alors Morrel, pour prouver à Noirtier qu’il avait la confiance de Valentine et connaissait tous leurs secrets, prit le dictionnaire, la plume et le papier, et plaça le tout sur une table où il y avait une lampe. — Mais d’abord, dit Morrel, permettez-moi, monsieur, de vous raconter qui je suis, comment j’aime mademoiselle Valentine, et quels sont mes desseins à son égard. — J’écoute, fit Noirtier. C’était un spectacle assez imposant que ce vieillard, inutile fardeau en apparence, et qui était devenu le seul protecteur, le seul appui, le seul juge de deux amants jeunes, beaux, forts, et entrant dans la vie. Sa figure, empreinte d’une noblesse et d’une austérité remarquables, imposait à Morrel, qui commença son récit en tremblant. Il raconta alors comment il avait connu, comment il avait aimé Valentine, et comment Valentine, dans son isolement et son malheur, avait accueilli l’offre de son dévouement. Il lui dit quelle était sa naissance, sa position, sa fortune ; et plus d’une fois, lorsqu’il interrogea le regard du paralytique, ce regard lui répondit : — C’est bien, continuez. — Maintenant, dit Morrel quand il eut fini cette première partie de son récit, maintenant que je vous ai dit, monsieur, mon amour et mes espérances, dois-je vous dire nos projets ? — Oui, fit le vieillard. — Eh bien ! voilà ce que nous avions résolu. Et alors il raconta tout à Noirtier : comment un cabriolet attendait dans l’enclos, comment il comptait enlever Valentine, la conduire chez sa sœur, l’épouser, et dans une respectueuse attente espérer le pardon de M. de Villefort. — Non, dit Noirtier. — Non ? reprit Morrel, ce n’est pas ainsi qu’il faut faire ? — Non. — Ainsi ce projet n’a point votre assentiment ? — Non. — Eh bien ! il y a un autre moyen, dit Morrel. Le regard interrogateur du vieillard demanda : lequel ? — J’irai, continua Maximilien, j’irai trouver M. Franz d’Épinay, je suis heureux de pouvoir vous dire cela en l’absence de mademoiselle de Villefort, et je me conduirai avec lui de manière à le forcer d’être un galant homme. Le regard de Noirtier continua d’interroger. — Ce que je ferai ? — Oui. — Le voici. Je l’irai trouver, comme je vous le disais ; je lui raconterai les liens qui m’unissent à mademoiselle Valentine ; si c’est un homme délicat, il prouvera sa délicatesse en renonçant de lui-même à la main de sa fiancée, et mon amitié et mon dévouement lui sont de cette heure acquis jusqu’à la mort ; s’il refuse, soit que l’intérêt le pousse, soit qu’un ridicule orgueil le fasse persister, après lui avoir prouvé qu’il contraindrait ma femme, que Valentine m’aime et ne peut aimer un autre que moi, je me battrai avec lui, en lui donnant tous les avantages, et je le tuerai ou il me tuera ; si je le tue, il n’épousera pas Valentine ; s’il me tue, je serai bien sûr que Valentine ne l’épousera pas. Noirtier considérait avec un plaisir indicible cette noble et sincère physionomie sur laquelle se peignaient tous les sentiments que sa langue exprimait, en y ajoutant par l’expression d’un beau visage tout ce que la couleur ajoute à un dessin solide et vrai. Cependant, lorsque Morrel eut fini de parler, Noirtier ferma les yeux à plusieurs reprises, ce qui était, on le sait, sa manière de dire non. — Non ? dit Morrel. Ainsi vous désapprouvez ce second projet, comme vous avez déjà désapprouvé le premier ? — Oui, je le désapprouve, fit le vieillard. — Mais que faire alors, monsieur ? demanda Morrel. Les dernières paroles de madame de Saint-Méran ont été pour que le mariage de sa petite-fille ne se fît point attendre : dois-je laisser les choses s’accomplir ? Noirtier resta immobile. — Oui, je comprends, dit Morrel, je dois attendre. — Oui. — Mais tout délai nous perdra, monsieur, reprit le jeune homme. Seule, Valentine est sans force, et on la contraindra comme un enfant. Entré ici miraculeusement pour savoir ce qui s’y passe, admis miraculeusement devant vous, je ne puis raisonnablement espérer que ces bonnes chances se renouvellent. Croyez-moi, il n’y a que l’un ou l’autre des deux partis que je vous propose, pardonnez cette vanité à ma jeunesse, qui soit le bon ; dites-moi celui des deux que vous préférez : autorisez-vous mademoiselle Valentine à se confier à mon honneur ? — Non. — Préférez-vous que j’aille trouver M. d’Épinay ? — Non. — Mais, mon Dieu ! de qui nous viendra le secours que nous attendons du ciel ? Le vieillard sourit des yeux comme il avait l’habitude de sourire quand on lui parlait du ciel. Il était toujours resté un peu d’athéisme dans les idées du vieux jacobin. — Du hasard ? reprit Morrel. — Non. — De vous ? — Oui. — De vous ? — Oui, répéta le vieillard. — Vous comprenez bien ce que je vous demande, monsieur ? Excusez mon insistance, car ma vie est dans votre réponse : notre salut nous viendra de vous ? — Oui. — Vous en êtes sûr ? — Oui. — Vous en répondez ? — Oui. Et il y avait dans le regard qui donnait cette affirmation une telle fermeté, qu’il n’y avait pas moyen de douter de la volonté, sinon de la puissance. — Oh ! merci, monsieur, merci cent fois ! Mais comment, à moins qu’un miracle du Seigneur ne vous rende la parole, le geste, le mouvement, comment pourrez-vous, vous, enchaîné dans ce fauteuil, vous, muet et immobile, comment pourrez-vous vous opposer à ce mariage ? Un sourire éclaira le visage du vieillard, sourire étrange que celui des yeux sur un visage immobile. — Ainsi, je dois attendre ? demanda le jeune homme. — Oui. — Mais le contrat ? Le même sourire reparut. — Voulez vous donc me dire qu’il ne sera pas signé ? — Oui, dit Noirtier. — Ainsi le contrat ne sera pas même signé ! s’écria Morrel. Oh ! pardonnez, monsieur ! à l’annonce d’un grand bonheur, il est bien permis de douter ; le contrat ne sera pas signé ? — Non, dit le paralytique. Malgré cette assurance, Morrel hésitait à croire. Cette promesse d’un vieillard impotent était si étrange, qu’au lieu de venir d’une force de volonté, elle pouvait émaner d’un affaiblissement des organes ; n’est-il pas naturel que l’insensé qui ignore sa folie prétende réaliser des choses au-dessus de sa puissance ? Le faible parle des fardeaux qu’il soulève, le timide des géants qu’il affronte, le pauvre des trésors qu’il manie, le plus humble paysan, au compte de son orgueil, s’appelle Jupiter. Soit que Noirtier eût compris l’indécision du jeune homme ; soit qu’il n’ajoutât pas complètement foi à la docilité qu’il avait montrée, il le regarda fixement. — Que voulez-vous, monsieur ? demanda Morrel, que je vous renouvelle ma promesse de ne rien faire ? Le regard de Noirtier demeura fixe et ferme, comme pour dire qu’une promesse ne lui suffisait pas ; puis il passa du visage à la main. — Voulez-vous que je jure, monsieur ? demanda Maximilien. — Oui, fit le paralytique avec la même solennité, je le veux. Morrel comprit que le vieillard attachait une grande importance à ce serment. Il étendit la main. — Sur mon honneur, dit-il, je vous jure d’attendre ce que vous aurez décidé pour agir contre M. d’Épinay. — Bien, fit des yeux le vieillard. — Maintenant, monsieur, demanda Morrel, ordonnez-vous que je me retire ? — Oui. — Sans revoir mademoiselle Valentine ? — Oui. Morrel fit signe qu’il était prêt à obéir. — Maintenant, continua Morrel, permettez-vous, monsieur, que votre fils vous embrasse comme l’a fait tout à l’heure votre fille ? Il n’y avait pas à se tromper dans l’expression des yeux de Noirtier. Le jeune homme posa sur le front du vieillard ses lèvres au même endroit où la jeune fille avait posé les siennes. Puis il salua une seconde fois le vieillard et sortit. Sur le carré il trouva le vieux serviteur, prévenu par Valentine ; celui-ci attendait Morrel, et le guida par les détours d’un corridor sombre qui conduisait à une petite porte donnant sur le jardin. Arrivé là, Morrel gagna la grille ; par la charmille, il fut en un instant au haut du mur ; et par son échelle, en une seconde, il fut dans l’enclos à la luzerne, où son cabriolet l’attendait toujours. Il y remonta, et brisé par tant d’émotions, mais le cœur plus libre, il rentra vers minuit rue Meslay, se jeta sur son lit et dormit comme s’il eût été plongé dans une profonde ivresse. |
|
Alexandre Dumas Le Comte de Monte-Cristo Tome 4 |