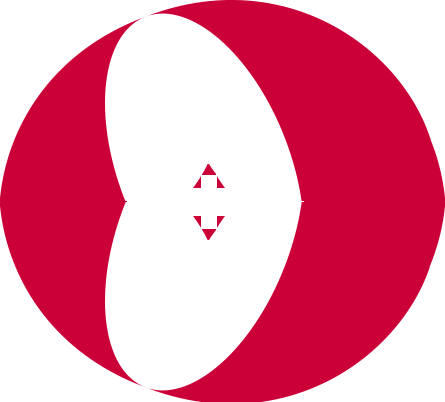| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
| ROBERT THIERRY ALONA, FILLE DU LOUP ROUGE |
| CHAPITRE VIII — Nahimi, pourquoi ne m’as-tu pas dit d’abord toute la vérité? dit, sur un ton de reproche, Eric. Cette vérité, lui-même venait seulement de l’apprendre, d’une façon brusque dont ses nerfs encore imparfaitement guéris avaient profondément ressenti l’émotion douloureuse. Il l’avait apprise quand, arrivant avec ses compagnons au camp du Loup-Rouge, le vieux guerrier avait demandé à Nahimi, d’un ton étonné: — Alona n’est-elle pas avec vous? Et quand le sorcier, angoissé, avait répondu: — Ainsi, elle ne nous a pas devancés en apportant le message? C’est donc bien elle! Il n’avait pas fallu continuer longtemps ce dialogue pour faire deviner à Eric ce qu’on lui avait caché. Et maintenant il voulait l’explication de ce poignant mystère! Nahimi la lui donna. À mesure qu’il parlait, Eric éprouvait une souffrance morale de plus en plus vive. Il comprenait que c’était de sa faute si la jeune fille était tombée dans on ne sait quel guet-apens! Car son refus, son absurde refus d’être soigné par une femme avait tenu à l’écart la timide jeune fille, qui ne lui avait pas moins prodigué ses soins dévoués. Veillant sur son repos sans en attendre de reconnaissance, il comprenait qu’elle avait toujours été là, près de lui, invisible, dépensant d’héroïques efforts et se mettant en péril chaque jour pour lui rapporter ces plantes inaccessibles qui l’avaient sauvé. Il comprenait surtout que la seule raison d’envoyer au camp un prétendu messager n’était qu’un prétexte à l’abri duquel la pauvre enfant avait pu disparaître avant d’être découverte par le convalescent au milieu de ses compagnons, en exigeant d’eux de garder son tendre secret! Il comprenait enfin que, si elle était maintenant captive de quelques féroces forbans, sinon assassinée par eux, c’était sa faute, uniquement sa faute! Une faute que, en sacrifiant sa propre vie si c’était nécessaire, il fallait réparer sans retard. — Nous devrions déjà être repartis sur les traces d’Alona! dit-il à Nahimi. Qu’attendons-nous ici? — Notre temps n’a pas été perdu, répondit l’Indien. J’ai appris des choses qui nous seront utiles. La présence des Blancs dans ces parages n’était pas ignorée du Loup-Rouge, et c’est pourquoi il nous attendait impatiemment. Ils sont nombreux, et leur but est de nous expulser de ces territoires, qu’ils veulent occuper à notre place. Mais ils n’ont pas le courage de nous attaquer ouvertement. Alors, ils ont adopté deux méthodes pour nous obliger à céder. L’une, c’est le crime qu’ils viennent d’accomplir: ils ont enlevé Alona pour avoir un otage qu’ils nous menacent d’égorger si nous ne voulons pas disparaître; l’autre, c’est de nous réduire à la famine en nous privant de notre subsistance d’hivernage, c’est-à-dire en détournant les bisons. — Détourner les bisons, s’exclama Eric, détourner des dizaines de milliers d’animaux marchant irrésistiblement vers leur but, comme le flot d’une marée montante? Comment le pourraient-ils? Nahimi allait répondre. Des cris qui s’élevaient autour d’eux l’en empêchèrent. On s’agitait, on courait dans le camp, on désignait, d’un geste éperdu, l’horizon du nord-est. L’horizon où s’allongeait, sur une ligne continue, le reflet rougeoyant d’un immense incendie! Cet incendie, c’était la réponse à la question posée par Eric. Mais au lieu de Nahimi, elle était donnée par des bandits... Les mêmes, renforcés par d’autres, avec lesquels le jeune homme avait voyagé, les premiers jours de son transport vers le Far-West. Pourquoi cet odieux crime? Et comment avait-il été exécuté? À l’époque où se passe ce récit, les régions de l’Amérique du Nord, comprises entre le Mississipi et les Montagnes Rocheuses, * étaient l’objet des convoitises d’émigrants, de toutes origines et de toutes espèces, venus chaque année de plus en plus nombreux pour s’emparer de ces territoires, plusieurs fois plus grands que la France, et qui n’avaient été jusqu’à présent que le domaine légitime des différentes peuplades Peaux-Rouges, qui l’occupaient encore librement. Ce domaine était si vaste qu’il y avait de la place pour tous. Mais les nouveaux venus le voulaient entièrement à eux pour y implanter leurs cultures, leurs industries, leurs cités, et spéculer sur tout cela en y tirant le plus d’argent possible, car posséder de l’argent était leur seule ambition, leur seul but dans la vie, pour lequel ils étaient prêts à tout sacrifier, jusqu’aux existences humaines qui se mettraient en travers de leur chemin. Même les émigrants qui se croyaient les plus honnêtes moralement étaient dévorés par cette fièvre. Au point qu’on a pu dire des Puritains, * débarquant sur les côtes du Nouveau-Monde, qu’ils «tombaient d’abord à genoux, puis sur le dos des Indiens...» * Dans ces conditions, ceux-ci étaient l’ennemi N° 1, parce que l’Indien avait le plus complet mépris, l’ignorance même de l’argent, jusque dans sa forme la plus convoitée par les Blancs, l’or, dont ils n’appréciaient d’aucune façon la valeur, parce que c’est un métal mou, inutilisable pour les besoins pratiques, très inférieur au cuivre et même à la pierre taillée, dont on fait toutes sortes d’armes et d’outils précieux. Une telle conception de l’existence faisait considérer l’Indien comme une bête nuisible, qu’il fallait détruire pour les mêmes raisons qu’on invoquait pour détruire les loups, qui menaçaient le bétail. Et si les pionniers avaient ces principes, on peut se douter de ce que pensaient les forbans, venus là pour piller les autres, quels qu’ils fussent, et s’enrichir de leurs dépouilles, par tous les moyens dont ils pouvaient disposer. Parmi ces moyens, l’incendie était un des plus efficaces, du point de vue des criminels qui l’employaient. À la période riche, ce qu’on appelait la «Prairie» était, dans son ensemble, une zone plate d’herbages s’étendant bien au-delà des horizons, et aussi inflammables que la paille. Le feu s’y propageait donc avec la vitesse d’une grande marée d’équinoxe, * formant une muraille de faible épaisseur mais d’une largeur infinie. Rien ne résistait à cette sorte de vague dévorante, si rapide que les êtres les plus rapides ne pouvaient y échapper s’ils n’avaient une avance suffisante. Heureusement pour certains d’entre eux, leurs sens subtils, odorat, ouïe, autant que vue, les avertissaient la plupart du temps quand il en était temps encore, qu’une distance de plusieurs lieus les séparait du fléau à son départ, qu’ils mettaient toute leur énergie à fuir, qu’ils étaient endurants et agiles, ce qui n’était pas le cas de tous... Ce qui n’était pas, entre autres, le cas des hommes, quand ils n’avaient que leurs jambes pour courir! La sinistre bande, dont le dénommé Pat était un des représentants les plus écoutés, avait donc, en délibérant sur les méthodes les plus avantageuses à employer contre ces Indiens qui la gênaient, conclu que l’emploi du feu était une des meilleures et décidé de la mettre à exécution, sans plus tarder. Elle avait, à leur avis, de nombreux avantages. Si, par malchance, les guerriers et même leurs femmes et leurs enfants y échappaient, du moins ils périraient tout de même, par disparition du gibier sans lequel ils ne pouvaient vivre. Ou bien, par exode de celui-ci, des bisons, notamment, vers des régions lointaines où l’on ne pourrait les suivre. En outre, cette terre brûlée serait de toute façon un désert de famine. Enfin, le mur de flammes était une barrière suffisante pour empêcher toute attaque par surprise des ennemis! — Il n’y avait plus qu’à exécuter le travail. Un cavalier de l’équipe, bien monté, s’en chargea. L’opération était simple. Au bout d’un lasso qu’il laissa traîner derrière lui, il attacha une épaisse botte d’herbes sèches où l’on mit le feu; et il lança son cheval au galop, en ayant soin de se tenir en travers du vent qui, depuis plusieurs jours, soufflait du nord-est, d’une façon régulière. La flamme se communiqua aussitôt aux herbes du bord opposé, s’y éleva en tourbillons rugissants, se développa comme un immense rideau rouge, haut de vingt pieds et couronné d’étincelles... Il n’y avait plus qu’à laisser agir les éléments naturels. La réussite de la féroce machination valut à Pat des applaudissements unanimes. Il les accueillit avec la modestie d’un spécialiste, habitué au succès. Ce n’était qu’un de plus dans sa série. Il en avait eu d’autres et, notamment, celui de la distribution de l’alcool empoisonné... |
| Robert Thierry Alona, Fille de Loup-Rouge |