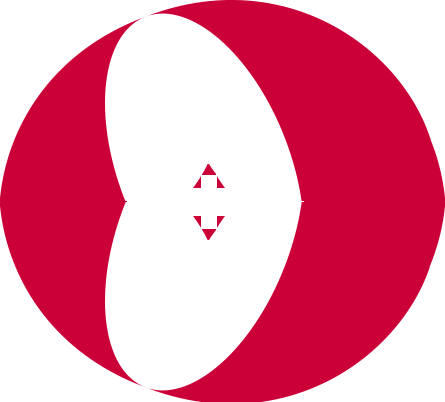| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
| ROBERT THIERRY ALONA, FILLE DU LOUP ROUGE |
| CHAPITRE IV Au Camp de la Rivière Blanche, * ce jour-là, régnait une agitation qui n’était pas celle de la vie quotidienne de la tribu. Dès les premières lueurs de l’aube, on avait démonté les tentes, laissant sur place les hauts piquets qui soutenaient les peaux pour rouler celles-ci et les placer sur les «travois», sorte de brancards dont une extrémité traînait à terre et l’autre était attachée au dos d’un cheval, que l’on confiait à un enfant, les guerriers et leurs montures devant rester libres en toute circonstance. Quelques paquets contenant des vêtements roulés, quelques coffres garnis de vivres complétaient un bagage sommaire, dont les Indiens, en déplacements perpétuels, n’aimaient pas s’embarrasser. Quand tout fut prêt, Loup-Rouge, le chef, donna l’ordre du départ. Et l’on se mit en marche. La troupe, composée de deux centaines de membres environ, appartenait au groupe ethnique des Monos, apparenté aux Comanches * qui s’étendent plus à l’est, une des plus belles peuplades indiennes, de taille moyenne, bien caractérisée par son teint café au lait, son visage fier aux traits réguliers, ses cheveux plats d’un noir bleu, que les deux sexes portaient longs, les hommes attachés en touffes formant une sorte de crinière sous la couronne de plumes, les femmes librement sur les épaules, maintenus sur le front par un bandeau de cuir rouge ou blanc. Habitant l’hiver au pied des montagnes qui forment un rempart contre le terrible vent d’ouest et où s’abrite aussi le gibier, pour la même raison, ces tribus descendaient vers la plaine au début de l’été, pour y rencontrer les bisons, au cours de leur migration saisonnière vers le nord, rencontre qui, avec celle d’automne, dans le sens contraire, était pour eux un des événements les plus importants de leur existence errante, car leur vie même en dépendait, une mauvaise campagne de chasse pouvant les réduire à la famine pour six mois. Aussi faisaient-ils précéder leur départ de cérémonies solennelles où les danses et les chants rituels alternaient. Et le contraste était grand avec le silence qu’ils observaient ensuite, dès qu’ils étaient en chemin. On avait marché ainsi sans incident la plus grande partie de la journée, lorsque le chef décida de faire un léger détour pour atteindre un petit lac dont il connaissait l’emplacement et où on ferait boire les chevaux. Il fallait pour cela remonter un peu sur les contreforts de la montagne, en coupant à travers la forêt. Comme on approchait du but, un des jeunes guerriers qui chevauchait en tête s’arrêta brusquement et fit un signe. Loup-Rouge le rejoignit aussitôt. La chose signalée valait la peine qu’on s’en occupe. Là, se dressait une cabane de troncs d’arbres nouvellement construite. Ce n’était pas une maison indienne. Ce n’était pas non plus la hutte d’un trappeur. Cela ressemblait plutôt à ces habitations permanentes qu’édifient les pionniers quand ils veulent s’établir dans une région qu’ils ont l’intention d’exploiter selon leurs méthodes. Les Indiens ne connaissaient que trop ces sortes d’occupation de territoires qui commencent par la présence d’un homme et se terminent par l’envahissement d’une armée. On délibéra un instant. Puisqu’on avait décidé d’une halte, on la prendrait ici. Mais plutôt que d’attendre, pour l’identifier, le retour de l’inconnu, que la méfiance pouvait faire s’enfuir, le chef décréta que trois de ses jeunes hommes prendraient sa piste, aussi reconnaissable que si un sentier la traçait, et iraient observer sans se faire voir. Ils partirent aussitôt, à pied. Et le reste de la troupe se dispersa, en se dissimulant, aux environs de la cabane. Loup-Rouge était resté sur son emplacement, songeur. Quelque chose l’intriguait. A côté des empreintes de l’étranger, il y avait les empreintes d’un puma. La bête était venue là, en même temps que l’homme s’y trouvait. Et il s’était passé quelque chose d’extraordinaire. L’homme n’avait pas combattu la bête, n’avait pas tenté de la détruire, ce qui est pourtant la coutume invariable des blancs. Et le puma non plus n’avait pas essayé d’attaquer ou de se défendre. Bien plus, un peu plus loin, les deux traces se mêlaient, comme si l’un eût suivi l’autre... Le chef s’approcha de la maison. Ici encore, il ne comprenait pas. Ces étrangers ont l’habitude de se barricader chez eux, de s’entourer de défenses compliquées comme si, hostiles à tous les autres, ils jugeaient tous les autres hostiles contre eux. Mais, dans les circonstances présentes, rien ne gênait l’accès de la cabane. Pourquoi? L’Indien en fit le tour. Puis, délibérément, y pénétra. Elle était à peu près vide. Il s’étonna qu’une maigre provision de vivres, un barillet de poudre, un sac de balles fussent restée là, à la portée du premier venu, comme si l’inconnu se fût considéré parfaitement isolé, à vingt lieues à la ronde. Il est vrai qu’il y avait de cela dans sa situation. Mais un peu seulement. Et un rôdeur est toujours possible dans n’importe quelle solitude, puisqu’il y était bien venu lui-même! Un imperceptible frôlement derrière lui fit se retourner le chef. Il reconnut sa fille, Alona. Elle avait seize ans à peine et elle était sa préférée à cause de son affectueuse espièglerie. Chez les Monos, les femmes avaient beaucoup plus d’indépendance, d’autorité même que chez la plupart des tribus, et la jeune fille ne faisait pas exception à la règle, bien au contraire. Avec une curiosité d’écureuil, à la fois prudente et osée, elle pénétra dans la cabane, en fit le tour en ouvrant de grands yeux surpris et malicieux. Son père la repoussa doucement. — Ta place n’est pas ici, lui dit-il; l’étranger peut revenir brusquement. Il a des armes qui portent loin, et... Elle ne le laissa pas achever. Mais, fixant sur lui un profond regard, où luisait cet instinct subtil des êtres restés près de la Nature: — L’étranger n’est pas un ennemi, déclara-t-elle. Sans se départir de son impassibilité, le chef éprouva un léger étonnement en entendant cette réponse. Et comme la jeune fille continuait de le regarder avec une tranquille assurance, il lui demanda: — Comment peux-tu le savoir? Tu ne l’as jamais vu, je pense? Tu ne sais ni qui il est, ni d’où il vient. — Je sais comme toi, père, sans l’avoir vu que c’est un Visage Pâle, répliqua-t-elle. Mais il est également certain qu’il ne nous veut pas de mal, puisqu’il a confiance en nous! — Qui t’a dit cela? — Personne. Mais c’est aisé à deviner... Il n’a pris aucun soin de se mettre en garde contre nous. S’il voulait nous attaquer ou nous nuire, il commencerait par se barricader, comme font ses frères de race, dans les fortins qu’ils bâtissent le long des pistes de l’Ouest. Et ceux-là ne sont jamais seuls, pour être sûrs d’être toujours les plus forts! — Il peut être un des hors-la-loi qui vivent solitaires comme les loups, en guerre contre tous, quels qu’ils soient. — Alors, il se cacherait dans une tanière au lieu de construire sa cabane à la vue de tous. Tu dis qu’il peut revenir, père. Mais c’est nous qui l’attendons chez lui. S’il fallait combattre, il ne pourrait nous surprendre. Et c’est lui qui serait le premier frappé! Elle n’avait pas fini de parler qu’une sorte de lointain appel se fit entendre dans l’immense silence de la forêt.  Cela ressemblait au cri, trois fois répété, de l’aigle pêcheur. Mais l’oreille exercée de Loup-Rouge reconnut que c’était seulement l’imitation du cri de l’aigle et que c’était un de ses guerriers qui le proférait. Il répondit par un appel semblable. Et, se tenant quand même sur ses gardes, il attendit, dans une paisible immobilité, l’homme qui l’avait ainsi averti de sa venue. Après un long moment d’attente, le guerrier apparut. C’était bien un de ceux de la tribu. Il l’affirma de loin par un signe de reconnaissance. Et quand il fut tout près, il dit: — Le Visage Pâle qui était seul n’y viendra plus jamais, sans doute. Nous avons trouvé son corps étendu sans vie au pied d’un amas de roches dont l’une avait basculé sous son poids en le précipitant dans le vide. — Sans vie? répéta Loup-Rouge. — Il nous a semblé car nous n’avons pas senti son cœur battre. Cependant l’aspect de son visage nous a laissé des doutes. Mais il fallait t’avertir tout de suite, et je n’ai pas voulu attendre. J’ai couru aussi vite que j’ai pu. — Que font tes frères? — Ils essaient de ranimer l’étranger. S’ils n’y réussissent pas, ils reviendront. — En abandonnant le corps? Le jeune guerrier hésita. — Quel qu’il soit, on ne peut le laisser sans sépulture. D’autant plus que déjà les fauves sont venus rôder autour de lui. — S’ils ne l’ont pas touché, c’est que la vie est en lui encore! dit vivement le chef. — Ou que quelqu’un l’a protégé. — Quelqu’un? De nouveau, le jeune homme demeura indécis. — C’est une chose étrange, murmura-t-il enfin. Toute la nuit, les loups ont tourné autour. Mais il est visible qu’ils ont été repoussés par un puma qui, toute la nuit aussi, est resté près du corps comme pour le veiller. Loup-Rouge demeura silencieux, réfléchissant. Alors, Alona, qui un peu à l’écart avait écouté l’entretien, se rapprocha: — Winnego, demanda-t-elle, ce puma, l’as-tu vu? — Non, il a dû s’enfuir à notre approche. Mais juste à ce moment seulement. Et peut-être nous observait-il sans que nous nous en doutions, car nous ne nous sommes plus occupés de lui dès que nous avons découvert l’homme. — C’est vrai que c’est une chose étrange, murmura pensivement la jeune fille. — Elle n’a rien d’étrange, intervint brusquement le chef. Ce n’est pas la première fois qu’elle arrive. Le puma n’attaque pas l’homme. Il préfère les chevaux et les chiens! — Il n’attaque pas l’homme, insista Alona, mais de là à le protéger! — Tu parles de choses que tu ignores, interrompit Loup-Rouge avec un peu d’impatience. Et puis, je t’ai dit que ta place n’était pas ici. Va rejoindre tes sœurs! Elle fit une moue d’enfant contrariée, mais tout de même s’éloigna. Les autres femmes, qui n’avaient pas osé intervenir, l’interrogèrent avidement. Et bientôt, malgré la règle du silence, un bourdonnement de conversations animées s’éleva. Ce n’est qu’à l’approche du soir que les deux compagnons de Winnego furent de retour. Ils n’étaient pas seuls. Ils portaient une civière hâtivement faite de branches de pins, sur laquelle un corps inerte était allongé. Mais sur l’impassibilité naturelle de la race rouge, l’événement avait fait sensation. Toute la tribu s’était rassemblée autour des nouveaux venus et les femmes n’étaient pas au dernier rang. Il fallut que Loup-Rouge, qui, lui aussi, s’était avancé mais avec une solennelle lenteur, les écartât. — Vivant? demanda-t-il aux porteurs. — Nous avons réussi à faire revenir le souffle dans sa poitrine, répondit l’un d’eux. Mais il n’a pas repris connaissance, bien que par deux fois ses yeux se soient rouverts et nous aient regardés, sans qu’il paraisse comprendre. — Quelles blessures? L’Indien souleva et inclina légèrement la tête de l’homme pour découvrir une longue plaie sanglante qui, partant de la base de l’oreille, s’étendait jusqu’au sommet du crâne. — Nahimi! appela Loup-Rouge. C’était le sorcier, l’homme-médecine, de la tribu. Il s’avança, considéra la blessure, secoua la tête: — Je ne peux rien faire, déclara-t-il. Le destin doit parler. Une longue nuit s’est écoulée, puis un jour encore, et il n’a pas repris conscience. C’est un mauvais signe. Quand une blessure comme celle-ci ne tue pas sur le coup, ou bien le blessé ne tarde pas à revenir à lui et alors sa guérison est prompte, malgré l’apparence de la plaie. Ou bien son sommeil se prolonge et c’est pour toujours. — Mais est-ce pour toujours, selon toi, Nahimi? — Si l’homme n’est pas éveillé demain avec le premier rayon de l’aurore, c’est pour toujours, dit le sorcier. Il se retira sans rien ajouter. Il avait dit tout ce qu’il avait à dire, tout ce qu’il pouvait dire, honnêtement, dans sa science barbare qui avait bien des lacunes, mais aussi bien des subtiles intuitions, pour ainsi dire, animales. Il savait que son pouvoir était dépassé. Insister était vain. Le chef cependant demeurait là, pris entre deux sentiments contraires. L’inconnu appartenait à cette race haïe qu’il ne connaissait lui-même que par le mal qu’il avait vu faire. Mais il était là, désarmé, sans défense, livré, vaincu à ses adversaires et on ne peut avoir de la haine pour un vaincu. Nahimi avait raison. C’était maintenant l’affaire du destin et il n’y avait qu’à attendre son jugement. Il dispersa d’un geste l’assistance, ordonna aux porteurs: — Allez l’étendre dans sa case et qu’il y dorme en paix. Jusqu’à demain, s’il doit en être ainsi. Sinon, jusqu’à la nuit sans fin... Les guerriers reprirent la civière avec son fardeau. Loup-Rouge regarda une dernière fois l’affreuse plaie. — Vous avez donc trouvé de l’eau dans la montagne pour le laver? demanda-t-il. — Nous n’avons pas trouvé d’eau et nous n’avons pu faire aucun pansement. Mais nous avons remarqué comme toi que la blessure avait été longuement nettoyée, humectée, séchée, mouillée encore... Comme celles que portent les bêtes et qu’elles soignent elles-mêmes en les léchant sans répit... Le chef ne répondit pas. Ils emportèrent le corps.  La nuit. Eric repose, de ce sommeil des évanouis, où plus rien de la sensation ni de la pensée n’existe. Plus rien, sinon peut-être le rêve, le vague souvenir du rêve. Dans un temps qui ne se mesure plus, il a l’imprécis sentiment d’avoir trois ou quatre fois ouvert les yeux, d’avoir vu, tout près, une face penchée... Quelle face?... C’est un rêve, rien qu’un rêve... Une face aux yeux flamboyants et pourtant sans menace, une face fauve, au souffle ardent de bête. En même temps, un apaisement caressant de cette souffrance qu’il éprouve derrière la tête... Mais non, ce n’est pas une bête sauvage, ce sont des visages d’hommes... Mais non, ce ne sont pas des visages d’hommes! Oh! quel doux visage anxieux, aux profonds yeux noirs. Et sur sa souffrance, quel inexprimable caresse de mains fraîches... si fraîches... Vivre! |
| Robert Thierry Alona, Fille de Loup-Rouge |