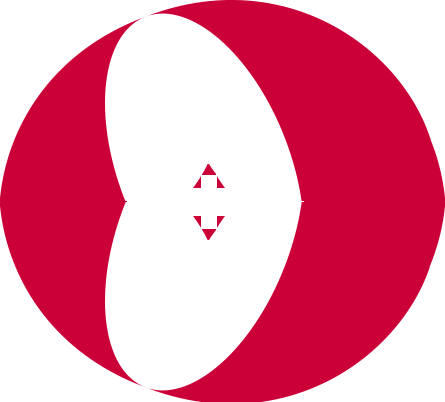| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
| ROBERT THIERRY ALONA, FILLE DU LOUP ROUGE |
| CHAPITRE II À la vive allure de son attelage, la malle-poste poursuit depuis plusieurs jours sa route à travers une série de territoires qui sont de plus en plus l’image de la solitude vierge * telle qu’elle existait des centaines d’années auparavant quand l’homme blanc ignorait encore l’existence d’un monde nouveau, * de l’autre côté des mers. Si les grossiers compagnons d’Eric se plaignent et s’inquiètent de cet isolement au sein de la nature, le jeune homme, à mesure qu’il va s’en enchante de plus en plus. Parti le cœur lourd d’amertume pour fuir la société qui n’a pas voulu le comprendre, ou l’a trahi, il éprouve maintenant l’immense soulagement de ceux qui ont souffert et qui se plongent dans la vie simple et naturelle. Tout serait pour le mieux s’il était vraiment seul. Mais les quelques échantillons de l’espèce humaine avec lesquels il est obligé de rester en contact ne sont pas faits pour lui donner une meilleure opinion! Ce sont de véritables bandits qui n’ont en tête que deux préoccupations dont ils s’entretiennent entre eux tout le long du jour: le désir de gagner de l’argent par n’importe quels moyens, y compris les plus malhonnêtes qu’ils jugent les meilleurs et les plus rapides, et leur terreur des Indiens qu’ils voudraient exterminer tous! À les entendre, la région où ils pénètrent maintenant est la plus dangereuse du parcours. C’est ce que les pionniers * ont appelé la Prairie, qui n’est pas seulement une vaste plaine paraissant infinie, mais qui apparaît telle aux yeux des voyageurs parce que la malle-poste passe naturellement aux endroits où la circulation lui est la plus facile et évite autant qu’elle peut les vallées profondes et les hautes collines. Le stage vient justement de remonter vers le nord pour rejoindre une zone où une route semble lui avoir été d’avance toute tracée par des ingénieurs savants qui ne sont autres que les troupeaux de bisons! Une importante partie de ceux-ci, plusieurs millions, parcourt en effet toute cette région deux fois par an dans sa migration vers l’Ouest et son retour, tandis qu’une autre immense horde fait un déplacement semblable du nord au sud. Et leur chemin est si bien calculé par leur instinct qu’un peu plus tard, quand la première ligne ferrée sera construite vers le Far-West, elle n’aura qu’à suivre la route des bisons, la meilleure qu’on puisse choisir. — En ce moment, il est encore trop tôt dans l’année pour qu’on rencontre ces énormes troupeaux, explique à Eric le conducteur de la diligence. Et il faut s’en réjouir, car ces masses, dont tous les individus se touchent, peuvent défiler pendant des heures ou même une journée entière. Et malheur à ceux qui sont pris dans cette gigantesque marée! * — À en croire ce qui se dit, ce ne sont pas les bisons qui sont à craindre, mais leurs chasseurs. C’est ici le territoire où errent les Indiens Pawnees et, plus loin, les Sioux... — Des bêtes fauves plus féroces que des loups! affirme à chaque instant Pat d’une voix où l’accent de haine essaie de masquer la terreur sans y parvenir. A-t-il quelques raisons personnelles de parler ainsi? Depuis le lâche attentat qu’il a commis avec les autres, contre le groupe paisible des Creeks, il n’est pas tranquille. Les Creeks ne sont pas particulièrement alliés aux Pawnees et les distances qui les séparent sont grandes. Mais si les tribus des Plaines se querellent parfois, elles se retrouvent unies contre les envahisseurs, et dans ces conditions-là, leur éloignement réciproque ne les empêche pas d’agir... Témoin ce qui se passe depuis trois jours... Depuis trois jours, chaque fois qu’on fait halte, un bruit étrange que le roulement de la voiture a empêché d’entendre parvient aux oreilles. C’est un grondement rythmé, monotone, tenace, coupé de courts intervalles, un bruit qui finit par devenir hallucinant à force d’être persévérant et qui semble venir de tous les côtés à la fois. Eric s’en étonne lui-même. Et les autres voyageurs pâlissent et échangent entre eux des regards effrayés. — Le tambour de guerre! murmure l’un d’eux. De quoi s’agit-il? Est-ce contre nous? — Rien d’impossible, déclare avec plus de calme l’un des «scouts», * un des guides qui accompagnent à cheval la diligence et qui, moins vil que les occupants de la voiture bien qu’ennemi des Indiens, a combattu jusqu’alors loyalement contre eux et connaît leurs coutumes. C'est pas encore question de guerre, ajoute-t-il, si seulement d’avertissement. Des bords de l’Arkansas à la North Platte, * ils sont en train d’annoncer, aussi vite que par le télégraphe, une nouvelle dont je ne comprends pas le sens. Je ne serais pas étonné s’il y était question de nous. — Parbleu, dit Pat, ces buveurs de sang veulent notre scalp, * la chose est sûre! — Je vous en avais prévenus, observe Eric. — Il est certain que les coups de fusil de l’autre jour étaient inopportuns, reconnaît le scout. Avec les Indiens, il ne faut pas attaquer quand on n’est pas le plus fort! — Nous étions les plus forts, réplique brutalement l’homme à la tignasse rouge. — Contre les Creeks, peut-être. Mais nous ne sommes pas même une vingtaine. Et si j’ai un conseil à vous donner, c’est, si nous rencontrons des Sioux ou des Pawnees, de commencer par filer doux et de n’ouvrir le feu que s’il faut nous défendre... Sans quoi... Le cavalier n’achève pas sa phrase dont le sens est clair. Pat grommelle quelques mots indistincts. Eric, qui l’observe et ne peut le considérer qu’avec dégoût, remarque son perfide et lâche sourire tandis qu’il s’adresse à son voisin, seul à l’entendre. Mais la diligence s’est remise en route et de nouveau gronde le bruit lointain des tambours. Ce n’est que dans la journée du lendemain qu’une nouvelle phase de la situation semble devoir s’annoncer. La piste a pénétré dans une vallée assez large, mais cependant encaissée entre deux collines dont on côtoie celle de gauche, la moins élevée. Tout paraît désert et les éclaireurs qui, selon la coutume, chevauchent assez loin en avant, n’ont rien signalé. L’avance qu’ils ont prise déplaît d’ailleurs à Pat qui inspecte avec une crainte non dissimulée la crête du coteau. Son inquiétude n’est peut-être pas sans raison car, surgissant de cette crête, la haute silhouette d’un guerrier indien à cheval, coiffé de la haute parure de plumes d’aigle, * paraît tout à coup. Il porte une longue lance. Des peintures écarlates sont visibles sur son visage, sur son torse nu. Il n’a pas du tout l’air paisible des Creeks. Immobile, il considère un long voiture qui passe... Puis il fait un signe et, comme produits par leur sol de la colline, d’autres guerriers semblables à la ligne paraissent, se groupent... Le «boss», * autrement dit celui des deux scouts qui est le plus particulièrement chargé de la conduite du groupe et s’il le faut de son commandement, est revenu rapidement près de la diligence. Malgré l’habitude qu’il en a, sa vigilance a été surprise. Ces tribus de plaine sont si habiles à se cacher quand elles le veulent qu’il n’a pas soupçonné la présence des nouveaux venus. D’ailleurs, cela n’aurait rien changé aux événements. Cette fois, il ne conseille pas, il ordonne: — Défense absolue de tirer! L’avertissement n’est pas inutile. Pat et les autres ont saisi fébrilement leurs carabines et sont prêts à s’en servir. Cependant, ils savent bien que s’ils commettent un meurtre, il ne restera pas impuni et cette crainte est pour eux le commencement d’une sagesse. * Le «boss» a peut-être raison: le chien qui ne peut mordre doit s’aplatir devant le plus fort. Avec moins de lâcheté, le scout pense la même chose. Et il est d’autant plus résolu à ne pas engager les hostilités que, selon toutes les apparences, ceux, qu’il appelle par habitude «les ennemis» ont une incontestable supériorité. En nombre, d’abord. Ils sont une quarantaine, tous bien montés sur ces poneys demi-sauvages de la Prairie, rapides et infatigables. Et ils sont bien armés quoique ne possédant aucune arme à feu. Leurs longues flèches, projetées de leur arc en corne de bison fondue d’une puissance extraordinaire, valent n’importe quel fusil de cette époque et sont lancées d’une main si sûre qu’elles atteignent toujours leur but. Habitue aux tactiques des plaines, * le «boss» est prêt à faire toutes les concessions. Les Indiens se sont groupés autour de celui qui paraît leur chef et, tandis que la malle-poste passe maintenant au-dessous d’eux, ils continuent de rester à peu près immobiles. Alors, interprétant à sa façon leur attitude, le guide-chef qui a mis son cheval au pas pour laisser passer l’attelage de mules et prendre, à l’arrière-garde, la place devenue maintenant la plus périlleuse, fait un geste solennel et compliqué. Un geste connu de toutes les tribus et faisant partie du langage par signes * grâce auquel tous se comprennent, bien que parlant une langue différente. Plaçant d’abord la main droite sur sa poitrine, puis l’élevant, la paume ouverte au-dessus de sa tête, il exprime ce qui est un salut pacifique. Ensuite, abandonnant les guides sur le cou de sa monture, il porte les deux mains, l’index et le médius levé, de chaque côté de la tête. Et c’est le signe du loup. Enfin, l’index droit levé, il le place devant son front. Et c’est le signe de l’homme. Ces trois mouvements sont ceux par lesquels les Pawnees se reconnaissent et se désignent. La phrase complète a en somme pour sens: «Pawnees, la paix est entre nous et je vous salue!» Puis il attend anxieusement la réponse. Si le chef indien répond par le signe de salut en y ajoutant celui de l’homme blanc — les mains exécutant une sorte de cercle au-dessus de la tête, ce qui exprime que les blancs sont coiffés de chapeaux — tout ira bien, car si la trêve est gardée de côté et d’autre, on peut être sûr que jamais un guerrier rouge ne la rompra le premier. Si, au contraire, il frappe ses deux poings l’un contre l’autre, c’est une nette déclaration de guerre. Et alors, on peut s’attendre au pire! Moment de pénible incertitude! Mais quoi? Le chef pawnee n’a fait ni le geste de paix, ni le geste de guerre. Toujours immobile, impassible comme une statue il suit de ses yeux d’aigle le convoi qui s’éloigne. Contre toute attente, il n’a pas répondu. Qu’est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l’Indien, averti par les battements du tambour partis du village creek où à eu lieu l’attentat, s’est tenu prêt à exercer une impitoyable vengeance s’il rencontrait sur son chemin ceux qui avaient eu la lâcheté de le commettre.  À l’approche de la diligence, il avait rassemblé quelques-uns de ses guerriers, s’était mis à l’affût de l’ennemi. Au moindre petit geste de menace, d’hostilité, il allait se jeter sur lui, le punir avec la rigueur de cette loi de la Prairie qui s’est répétée de siècles en siècles: œil pour œil, sang pour sang... * Et voici qu’au lieu d’une attaque, ou tout au moins d’une provocation, on lui adressait un témoignage d’alliance, presque d’amitié! Il n’avait pas compris. Ce n’est pas l’usage entre tribus de se saluer avant de se battre. On y met plus de franchise. A son tour, c’est lui qui se demande: Qu’est-ce que cela signifie? Mais déjà la diligence est loin. Sur l’ordre du boss, les mules ont repris le galop et le convoi s’éloigne avec rapidité, suivi maintenant, et non plus précédé, par les deux scouts. — Ils viennent! Ils nous poursuivent! crient de l’impériale des voix angoissées. C’est vrai, mais le guide qui s’est retourné recommande une fois de plus le calme. Il a compris qu’il ne s’agissait pas d’une poursuite, mais d’une sorte d’escorte de surveillance pour connaître les intentions des Blancs. — Encore une fois, déclare le «boss», nous sommes sûrs d’être massacrés si nous faisons le moindre geste hostile. Rien ne nous y oblige. Au contraire, et pour montrer à ces gens que notre neutralité est sincère, plions-nous à la coutume adoptée dans la Prairie par ceux qui ne veulent être ni amis intimes, ni ennemis déclarés. Laissons sur notre route un présent quelconque, avec un signe qui témoignera de nos bonnes intentions. C’est une façon de dire qu’on ne veut de mal à personne, mais qu’on ne tient pas à continuer les relations! — Très bonne idée, s’écrie Pat avec un empressement qui exprime sans doute la peur qu’il a eue. J’ai là un petit baril de rhum que je sacrifie volontiers à cette entente cordiale. Qu’en pensez-vous «boss»? Mais Eric proteste: — Ces pauvres Indiens ont déjà trop tendance à céder à la tentation de l’alcool. N’y a-t-il pas un moyen de conciliation moins ignoble? Pourtant, le boss qui, au fond, n’a aucune sympathie pour les Peaux-Rouges, hausse les épaules: — Bah! dit-il, ils n’en mourront pas! Et s’ils cuvent un jour ou deux leur eau-de-feu, * nous n’en serons que plus tranquilles. Laissons faire! Eric est seul; il ne peut rien empêcher. Son mépris pour ses concitoyens ne fait que s’accentuer un peu plus. Deux jours plus tard, ce n’est pas du mépris, c’est la plus farouche haine qu’il éprouve. Ce sentiment lui est venu peu à peu, d’abord par de vagues soupçons d’une chose imprécise dont il n’avait guère de preuves, puis en cherchant à en savoir plus long, en devinant progressivement ce qu’il n’avait pas osé comprendre, en découvrant enfin une horrible vérité dont l’aveu s’était fait devant lui. Cela avait commencé à l’étape du soir. Le boss, comme d’usage, avait organisé le campement dont il avait l’entière responsabilité chaque fois que, n’ayant pu atteindre le relai fortifié où les hommes trouvaient un abri plus ou moins sommaire et où se faisait l’échange des chevaux et des mules, il fallait s’installer en pleine solitude. En ces cas-là, lorsqu’il s’agissait d’un «train», c’est-à-dire d’un convoi de nombreux chariots d’émigrants, on plaçait en cercle les lourds véhicules, puis hommes et bêtes se groupaient à l’intérieur de ce rempart. Avec la diligence, cette «fortification» sommaire ne pouvait être envisagée. Habituellement, on tirait alors de l’intérieur tous les bagages, tentes de toile ou de cuir roulées, caissons divers, sacs de vivres, paquets de vêtements, etc... On rangeait le tout en forme de barricade circulaire et une partie des voyageurs s’y parquaient autour d’un feu de camp, tandis que les autres se hissaient puis s’allongeaient comme ils pouvaient sur l’impériale, leur fusil chargé à côté d’eux, pour veiller sur le salut de tous. Avant de prendre cette disposition, et tant qu’il restait une lueur de jour ou un rougeoiement de foyer, quelques paroles s’échangeaient, commentant les événements de la journée. Ce soir-là, Buck Taylor, * le guide, s’est attardé plus que d’habitude pour examiner les environs du camp. Et comme Eric lui en demande la raison, il avoue que, tout de même, il s’étonne qu’on n’ait pas eu la moindre nouvelle des Indiens rencontrés la veille. — C’est contre leurs habitudes, déclare-t-il. Quand on a fait un échange pacifique avec eux, ils oublient rarement d’en accuser en quelque sorte réception * par quelque manifestation de reconnaissance... Tandis que le boss fait cette remarque, Eric s’étonne d’entendre Pat chuchoter à ses voisins des mots qu’il ne comprend pas, mais qu’il accompagne d’un ricanement si étrange, sinistre, que le jeune homme y pense toute la journée du lendemain... Mais à la halte suivante, sur une nouvelle observation du guide, Eric, dans les mêmes circonstances, surprend l’effroyable aveu du bandit: — Ce n’est pas de l’ivresse de l’alcool qu’ils dorment. C’est d’un sommeil bien plus profond car, dans le baril dont je leur ai si généreusement fait cadeau, il y avait bien du rhum, comme j’ai dit, mais j’y avais mélangé ce qu’il faut de strychnine... Et soyez tranquilles! Ils ne se réveilleront plus! |
| Robert Thierry Alona, Fille de Loup-Rouge |