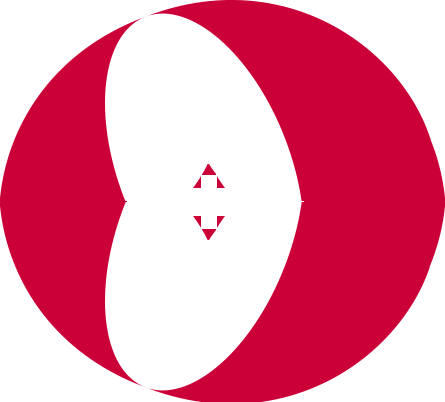| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
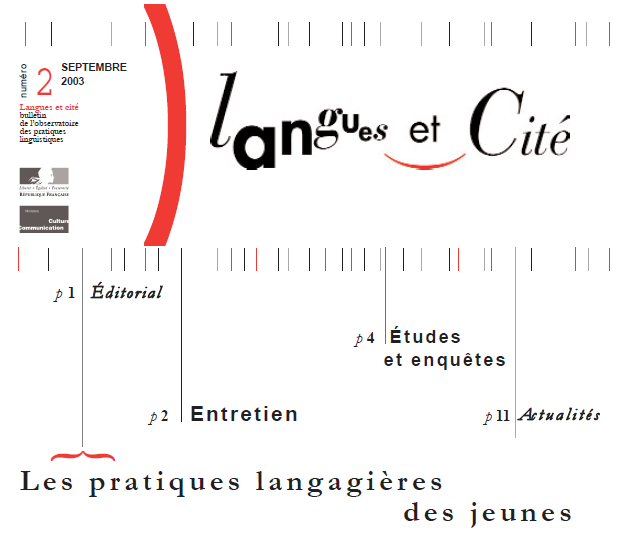 |
040 Langues et cité, n° 2 : les pratiques langagières des jeunes Bulletin de l’observatoire des pratiques linguistiques |
| 005 |
| Quelles pratiques linguistiques régionales chez des élèves de zones suburbaines en Bretagne gallo ? C’est la question à laquelle a répondu une recherche menée au sein du Centre de Recherche sur la Diversité Linguistique de la Francophonie (EA 3207) de l’université de Haute-Bretagne (Rennes 2) en 2001, avec le soutien de la D.G.L.F.L.F. Depuis quelques années, notre équipe s’est intéressée à la continuation des contacts gallofrançais dans les régionalismes du français (notamment chez des jeunes, y compris urbains). Il est donc apparu pertinent d’analyser ces régionalismes chez des enfants de zones suburbaines, c’est-à-dire banlieues de grandes villes au contact des zones rurales environnantes (par ex. Rennes) ou villes moyennes (par ex. Dol, Loudéac). En zone rennaise, on découvre ainsi des formes régionales chez de nombreux enfants (rin « rien », clancher « fermer », goule « gueule », il tombit « il tomba (passé simple gallo) », par exemple). Des prononciations locales sont attestées, surtout par jeu. Un test montre que 60% des collégiens interrogés à Bruz (ceinture péri-urbaine de Rennes), et 40% à Cesson (banlieue « chic » de Rennes), ont au moins des compétences passives quant aux formes régionales, certains mots recueillant jusqu’à 95% de compréhension. Les enfants indiquent des variables auxquelles, selon eux, sont corrélées les formes régionales : locuteur populaire, rural, âgé. Mais ils renvoient toujours la norme linguistique ailleurs (tel ce fils de médecin qui attribue un « langage soutenu » à un personnage d’un siècle passé) ou amalgament le régionalisme dans un ensemble « hors norme » (j’suis benèze est attribué au « langage des jeunes » par rapport à la langue normée supposée des adultes). L’insécurité linguistique est marquée : seulement 45% à Cesson et 20% à Bruz estiment qu’on « parle bien français » dans la région, plus de 50% estimant clairement qu’on y « parle français à notre façon » et 45% (à Bruz) ou 10% (à Cesson) qu’on y parle « mal ». Ce chiffre est à relier aux 40% d’élèves de Bruz qui citent le patois ou gallo comme parlé dans la région (0% à Cesson). Les formes et compétences régionales attestées partout, souvent inconscientes ou stigmatisées, sont surtout présentes à la jonction rural/urbain. La ville a un rôle moteur dans la perte des compétences et formes régionales de Haute Bretagne, ainsi que dans la stigmatisation des formes linguistiques locales, réinterprétées en traits sociaux dévalorisés. Ce constat pourrait ouvrir une réflexion sur des stratégies pédagogiques adaptées. |
| Philippe BLANCHET, Professeur des universités, Université Rennes 2 |
| Les pratiques langagières des jeunes |