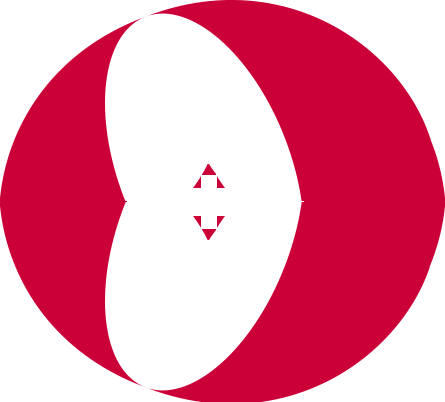| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
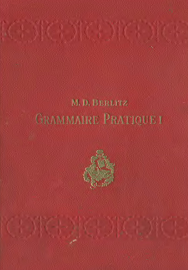 |
036 Livre M.D. Berlitz Grammaire Pratique I LES VERBES, appris par la conversation 1913 |
| page-111 |
| LE PARTICIPE. |
|
II. LE PARTICIPE PASSÉ.*) Le participe passé français est soumis à deux règles principales, suivant qu’il est employé: *) Le participe passé français est dérivé du participe du parfait passif latin (participium perfectum passivum); aussi lorsqu’il sert à exprimer un état passif, il s’accorde, conformément à son origine, avec le sujet du verbe. Ex.: «Il est aimé, elle |
|
1° sans auxiliaire ou avec l’auxiliaire être, 2° avec
l’auxiliaire avoir ou avec le verbe pronominal. 1° PARTICIPE PASSÉ. a) sans auxiliaire, b) avec Vauxiliaire être. a) Le participe passé employé sans auxiliaire s’accorde, comme un adjectif, en genre ------------------- * cont.) est aimée, nous sommes aimés» (= amatus, amatà amati sumus). C'est également à cause de son origine que le participe des verbes intransitifs conjugues avec être, comme venir, aller, etc., s'accorde avec le sujet du verbe. Ex.: «II est venu, elle est allée, nous sommes venus, elles sont allées» etc. En dehors de l'état passif, le participe passé français sert aussi à former les temps composés des verbes actifs conjugués avec avoir. Cette forme grammaticale, quoique peu usitée en latin, est ce-pèndant, comme la précédente, empruntée à cette langue: dans l’origine, en effet. «J’ûz lu le li\re» voulait dire: «habeo librum lectum» (= je possède le livre lu); aussi le participe s'est-il accordé avec le régime direct dont il était, en quelque sorte, l’adjectif. Cette forme grammaticale remonte à l’époque la plus brillante de la littérature latine; on la trouve notamment dans Cicéron: «habeo per-spectum. habeo cognitum, satis dictum habeo», quelquefois même avec un complément direct: «habeo absolutum epos, bellum diis indictum habuit, rem cognitam habeo», etc., ce qui équivaut presque identiquement aux temps simples: «perspexi, cognovi, dixi, absolvi, indixii», etc. Le participe passé ne servit donc tout d'abord |
|
et en nombre avec le substantif ou le pronom auquel il
se rapporte. Ex.: «Un homme blessé; une femme blessée.
— Des livres déchirés; des robes déchirées. Que de remparts détruits! que de villes forcées! Que de moissons de gloire en courant amassées! (BOILEAU.) REMARQUE a. — Quand les participes excepté, supposé, attendu, vu, approuvé, oui, passé, compris, ------------------- * cont.) qu'à modifier le complément direct du verbe avoir, c'est-à-dire à indiquer la manière d’être de ce complément, laquelle était subordonnée à l'idée principale de possession, marquée par avoir. L'emploi de cette tournure de phrase ne tarda pas à se généraliser, mais l'idée de possession ne conserva Î)as l'importance prédominante qu'elle avait dans 'origine, et, peu à peu, elle se confondit avec l’idée de l’action marquée par le participe. C'est ainsi que, dans la plupart des langues modernes, le veroe avoir finit par devenir un simple verbe auxiliaire servant à former les temps composés des verbes actifs (comparez le grec ancien wpa<pa avec le grec moderne ÏP0^1)* Chez les anciens écrivains français, le participe passé conjugué avec avoir, est indifféremment variable ou invariable. Ex.: J'ai vendue la maison, ou J'ai vendu la maison. — Nous avons admirée la vertu, ou Nous avons admiré la vertu. Et Chrêmes qui m'avait promise Sa fille, et puis s'en était dédit. (Tr. de Térence.) Ce n'est que vers le milieu du XVII. siècle que des règles fixes ont été établies et ont déterminé les cas où le participe passé varie ou reste invariable. |
| y compris, non compris, sont placés, devant un nom, ils sont employés comme prépositions, et, par conséquent, invariables. Mais s'ils suivent le substantif, ils sont employés comme adjectifs et s'accordent avec le substantif qu'ils qualifient. |
| Ex.: |
|
INVARIABLE. Excepté deux pages, j’ai lu le premier volume. Supposé ces dispositions justes. Attendu cette décision du sénat la proposition fut retirée. Vu les articles de la loi. Approuvé récriture ci-dessus. Oui les deux avocats dans leurs conclusions. Passé dix heures je ne vous attendrai plus. Il gagne deux cent francs par mois, y compris la nourriture et le logement. |
|
VARIABLE. Ces deux pages exceptées, j’ai lu votre livre. Ce sont des faits supposés. Il a enfin obtenu cette place attendue depuis si longtemps. Les choses vues de loin paraissent superbes. Les ouvrages approuvés par P Académie ont du succès. MM. Gilbert et Moreau ouïs dans leurs conclusions. Il y a dix ans passés qu'il est en Amérique. Elle gagne dix francs par semaine, la nourriture comprise. |
|
REMARQUE b. — Les participes passés joint et inclus dans les locutions ci-joint et ci-inclus, sont invariables, parce qu'ils sont employés adverbialement: 1° Quand le nom qui suit n’est précédé ni de l'article ni d'un ad jectif déterminatif. Vous trouverez ci-joint ou ci-inclus copie de sa lettre. |
|
2° Lorsque placés avant un nom précédé de l'article ou
d’un adjectif déterminatif, ils commencent la phrase. Ci-joint ou ci-inclus les copies de ses lettres (= ci-joint sont les copies .. etc.) |
| Mais ils sont considérés comme adjectifs et varient: |
|
1° Lorsqu’ils suivent le substantif. Vous trouverez la copie de l’acte ci-jointe ou ci-incluse. |
|
2° Lorsqu’ils précèdent un substantif déterminé,
c’est-à-dire accompagné de l’article. Vous trouverez ci-jointe ou ci-incluse la copie de sa lettre. |
|
REMARQUE c. — Le participe passé sans auxiliaire, mis
au commencement d'une phrase, doit toujours se
rapporter, d'une manière précise et sans équivoque, à
un nom ou à un pronom placé plus loin, soit comme
sujet, soit comme complément. Dans cette phrase:
«Obligé d'entreprendre un long voyage, je crois que
mon père sera très affecté de notre séparation», rien
n'indique si c'est le père ou le fils qui est «obligé
d'entreprendre un long voyage». Pour faire disparaître
l'équivoque, il faut dire: «Mon père, obligé
d'entreprendre un long voyage, sera sans doute très
affecté de notre séparation.» b) Lorsque le participe passé est employé avec être, dans les temps des verbes passifs ou des verbes neutres qui se conjuguent avec cet |
|
auxiliaire, il s’accorde en genre et en nombre avec le
sujet du verbe. Ex. : «La vigne fut apportée en Gaule
par les Grecs d’Asie Mineure. — L’Amérique fut
découverte par Christophe Colomb en 1492. — C’est par
le roi David que les Psaumes ont été composés. — Cette
dame est sortie. — Nous sommes venus. — Elles sont
montées au sommet de la tour Eiffel.» etc. 2° PARTICIPE PASSÉ. à) avec avoiry b) avec un verbe pronominal. a) Le participe passé conjugué avec avoir s’accorde en genre et en nombre avec son régime direct, quand il est précédé de ce régime Ex. : «L’homme que nous avons vu. — Les dames que vous avez rencontrées. — Les chanteurs qu’elles ont entendus. — Les lettres qu’ils ont écrites.» etc. Il s’ensuit que le participe conjugué avec avoir reste invariable: 1° Quand le régime direct le suit. Ex.: «Il a puni beaucoup d’élèves aujourd’hui. — Ils ont vendu leur hôtel. — Elles ont fondé une grande maison de commerce.» etc. |
|
2° Quand il n’y a pas de régime direct.*) Ex.: «Elles
ont dormi longtemps. — Ils ont succédé à leur père. —
Nous avons chanté et dansé. — Elles ont compris. — Ils
ont chassé aujourd’hui.» etc. b) Les participes des verbes pronominaux, bien que conjugués avec être, suivent la règle des participes conjugués avec avoir, c’est-à-dire s’accordent avec le régime direct, si ce régime précède le participe. La raison en est que, dans ces verbes, l’auxiliaire être est mis pour avoir. Ex. : «Nous nous sommes amusés (= nous avons amusé nous)»: le participe s’accorde avec le régime direct qui le précède. — «Vous vous êtes partagé ces fruits (= vous avez partagé ces fruits à vous)»: le régime direct fruits suit le participe, donc ce dernier est invariable. — «Ils se sont parlé (= ils ont parlé à eux)»: il n’y a pas de régime direct, donc le participe est invariable. REMARQUE. — Mais les verbes essentiellement pronominaux (c'est-à-dire qui ne peuvent s'employer sans deux pronoms) ayant toujours pour régime direct leur second pronom, il s'ensuit que leur participe s'accorde toujours. Ex.: «Ils se sont repentis *) Il résulte de cette règle que le participe passé des verbes intransitifs conjugués avec avoir est toujours invariable. |
|
de leurs fautes. — Vous vous êtes emparés de la ville.
— S'étaient-elles abstenues de vous faire une visite
?» etc. Le verbe s’arroger fait seul exception, parce que, quoiqu'il soit toujours pronominal, il n'a pas son second pronom pour régime direct. Ex.: «Ils se sont arrogé des droits qu'ils ne possédaient pas (= ils ont arrogé des droits à eux)»: le régime direct droits étant placé après le participe, ce dernier est invariable. Tous les participes passés se rapportent aux deux règles générales établies ci-dessus; mais l’application n'en étant pas toujours facile, nous ♦examinerons, dans le prochain chapitre, les principales difficultés qui peuvent se présenter. OBSERVATIONS GÉNÉRALES sur l’emploi de certains participes. L PARTICIPES CONJUGUÉS AVEC AVOIR Qui RESTENT TOUJOURS INVARIABLES. Quelques participes conjugués avec avoir restent toujours invariables, savoir: |
|
1° Le participe d’un verbe impersonnel.*) Les peines qu’il a fallu. Les pluies qu’il avait fait. Les guerres qu’il y a eu. |
| *) Il est également invariable quand le verbe impersonnel se conjugue avec être. Ex.: «Il est arrivé |
|
REMARQUE. —' Il ne s’agit évidemment pas de pluies
faites ni de guerres eues par quelqu’un; aussi le
pronom conjonctif que, qui précède le verbe, n’en est
pas le régime direct. Ces verbes sont dans ce cas de
véritables gallicismes, marquant seulement
l'existence, et leurs participes n'ayant pas de régime
direct restent invariables. 2° Le participe placé entre deux que. La guerre que j’avais prédit qu’il en résulterait La lettre que nous avions présumé que vous recevriez est enfin arrivée. REMARQUE. — La raison en est que le participe entre deux que a généralement pour complément direct la proposition qui suit. En effet, j'avais prédit quoi? qu’il en résulterait la guerre. — J'avais présumé quoi? que vous recevriez la lettre. Il est bien entendu que si le premier que est le régime direct du participe, celui-ci s'accorde avec le régime direct qui le précède. Ex.: «C'est votre sœur elle-même que j’ai prévenue que je sortais.» Ici, le participe varie parce qu'il est précédé de son complément direct que, mis pour sœur ; la proposition que je sortais n'est -------------- * cont. de grands malheurs. — Il s’est glissé une erreur.» Dans le premier exemple, le participe s'accorde avec son sujet il, qui est du masculin et du singulier; dans le second il s'accorde avec son complément direct se, qui précède, et qui est du masculin et du singulier, puisqu'il représente le mot il. |
|
pas régime indirect, c'est comme s'il y avait de ce
que je sortais. D'ailleurs, les phrases où se trouve un participe passé entre deux que sont peu harmonieuses, et on ne les emploie que le plus rarement possible. |
|
3° Le participe ayant pour complément direct /'
représentant un membre de phrase. Cette difficulté est beaucoup plus grande que je ne l'avais pensé. Il se sont conduits comme nous l'avions dit. La famine arriva ainsi que Joseph l'avait prédit. |
| REMARQUE. — La raison en est que l', signifiant cela, est du masculin singulier et ne saurait, par conséquent, rendre variable le participe dont il est le complément direct. C’est comme s’il y avait dans les exemples ci-dessus: Cette difficulté est beaucoup plus grande que je n’avais pensé qu'elle était grande. — Ils se sont conduits comme nous avions dit qu’ils se conduiraient, etc. |
|
4° Le participe ayant pour complément un mot avant
lequel il y a une préposition sous-entendue. Je regrette les nombreuses années que j’ai vécu*) sans pouvoir m’instruire. Les soixante-douze ans que Louis XIV a régné. |
| *) Cependant il y a un cas où le verbe neutre vivre exprime Faction et devient transitif: c’est quand on emploie certaines locutions mises en vogue par quelques écrivains modernes, telles que: vivre la vie, vivre des années heureuses. On dit: J’ai vécu votre vie, et l'on doit, par conséquent écrire: votre |
| REMARQUE. — La raison en est que le mot en question n’a que l’apparence d’un régime direct, mais est en réalité un régime indirect. C’est comme s’il y avait dans les deux exemples ci-déssus: Les années pendant lesquelles j’ai vécu . . . Les soixante-douze ans pendant lesquels Louis XIV a régné. |
|
5° Les participes pu, dû, voulu, permis, lorsqu’il y a
après eux un verbe exprimé ou sous-entendu. Je lui ai rendu tous les services que j’ai pu (= pu lui rendre). Avez-vous réellement fait tous les efforts que vous avez dû (= dû faire)? On peut dire qu’il a obtenu tous les succès qu’il a voulu (= voulu obtenir). Il a fait des dépenses que ses richesses lui ont permis (= permis de faire). |
|
--------------- * cont. vie, que j'ai vécue avec vous. — C'est la joie et la douleur mises en commun, c'est toute la vie qu'on a vécue (GEORGE SAND). Il en est de même des participes passés des verbes coûter et valoir qui, tout en étant des verbes neutres se conjuguant avec l'auxiliaire avoir, deviennent verbes transitifs et, par conséquent, susceptibles d'accord, quand ils sont employés au sens figuré. Or coûter est pris activement quand il signifie causer, occasionner; le verbe valoir l'est aussi quand il signifie procurer, rapporter. Les peines que cette affaire m'a coûtées (= m’a causées). — Les honneurs que cette place m'a valus (= m’a procurés), etc. Toutefois, les grammairiens ne sont pas d'accord sur la variabilité de ces deux derniers participes. La plupart les font varier, quand ils sont employés, au |
|
sens figuré, comme verbes transitifs, ainsi que
l’exige la logique; quelques-uns veulent, au
contraire, que coûté et valu soient toujours
invariables. Le Dictionnaire de l’Académie est de
cette dernière opinion pour le participe coûté ; il
est muet sur la variabilité ou l’invariabilité du
participe valu. Pourtant, nous pensons que lorsque les deux verbes coûter et valoir prennent une signification active, c’est-à-dire sont employés au figuré, ils doivent subir les accidents grammaticaux des verbes dont ils tiennent lieu. C’est ainsi, d’ailleurs, que les auteurs classiques emploient ces deux participes: «Vous n’avez pas oublié les soins que vous m’avez coûtés depuis votre enfance.» (FÉNELON.) «Que de soins m’eût coûtés cette tête charmante!» (RACINE.) «Si vous saviez toutes les salutations que mon habit m’a values.» (J. J. ROUSSEAU.) De même, le verbe peser est verbe intransitif et son participe passé invariable quand il signifie avoir le poids de. Ex.: «Cette caisse ne pèse plus les dix kilogramme» qu’elle a pesé.» Mais il devient verbe transitif et son participe passé varie quand il signifie faire l’action de peser. Ex.: «Vos marchandises sont prêtes, je les ai pesées moi-même.» |
|
M.D. Berlitz Grammaire Pratique I |