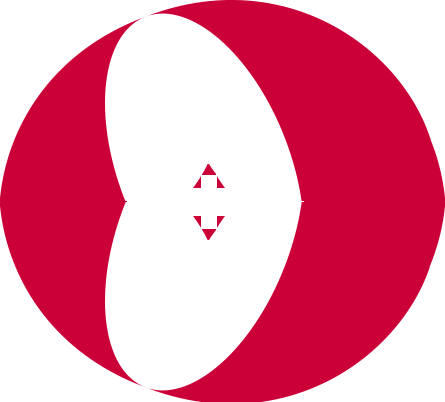| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
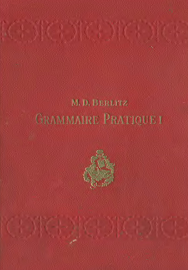 |
036 Livre M.D. Berlitz Grammaire Pratique I LES VERBES, appris par la conversation 1913 |
| page-103 |
| LE SUBJONCTIF. EMPLOI |
|
CORRESPONDANCE DES TEMPS, DU SUBJONCTIF AVEC CEUX DE
L’INDICATIF ET DU CONDITIONNEL. 1° Quand le verbe d’une proposition principale, régissant le subjonctif, est au présent, au futur ou à l'impératif, on met ordinairement le verbe de la proposition subordonnée au présent du subjonctif, pour exprimer une action présente ou future, et au passé, pour exprimer une action passée. Ex.: |
| - Présent ou futur. |
|
Je souhaite qu’il vienne. Nous souhaiterons que vous veniez. Souhaite qu’ils viennent. |
| - Passé. |
|
Je souhaite qu’il soit venu. Je souhaiterai que vous soyez venu. Souhaite qu’ils soient venus. |
| REMARQUE a. — Après le présent et le futur de l'indicatif, on emploie Yimparfait du subjonctif au lieu du présent, et le plus-que-parfait au lieu du passé, quand la phrase subordonnée a, dans sa dépendance, quelque expression conditionnelle. Dans ce cas l'imparfait du subjonctif équivaut au conditionnel présent, et le plus-que-parfait au conditionnel passé. Ex.: |
| - Présent ou futur. |
|
Je ne crois pas que vous fissiez votre devoir
maintenant, si l'on ne vous y obligeait. Je ne croirai pas que vous fissiez... |
| - Passé. |
|
Je ne crois pas que vous eussiez fait votre devoir
hier, si l'on ne vous y eût obligé. Je ne croirai pas que vous eussiez fait . . . |
|
Dans ces exemples, que vous fissiez signifie: que vous
feriez; que vous eussiez fait signifie que vous auriez
fait. REMARQUE b. — On emploie encore Pimparfait ou le plus-que-parfait du subjonctif après un verbe au présent ou au futur, quand la proposition où se trouve le subjonctif peut être remplacée par une interrogation faite au moyen d'un passé ou d'un |
|
plus-que-parfait. Ex.: «Scarron était plaisant, mais
j’ai peine à croire qu’il fût gai» (= était-il gai?).
— Croyez-vous que la lettre eut été ouverte et lue
avant d'avoir été remise? (= avait-elle été ouverte et
lue?) REMARQUE c. — Au futur antérieur de l’indicatif correspond le passé du subjonctif. Ex.: «Si vous attendez qu’il ait appris sa leçon vous ne pourrez plus partir aujourd’hui.» (= Quand il aura appris sa leçon vous ne pourrez plus partir.) 2° Quand le verbe de la proposition principale est à Vun des passés ou au conditionnel, on doit mettre le verbe de la proposition subordonnée à Y imparfait du subjonctif, pour exprimer une action présente ou future, et au plus-que-parfait pour exprimer une action passée. Ex.: |
| - Présent ou futur. |
|
Je voulais Je voulus J’ai voulu J’avais voulu J’eus voulu Je voudrais J’aurais voulu |
| qu’il vînt aujourd'hui, demain, etc. |
| - Passé. |
|
Je voulais Je voulus J’ai voulu J’avais voulu J’eus voulu Je voudrais J’aurais voulu |
| qu’il fût venu hier. |
|
REMARQUE a. — Après un passé indéfini, on emploie le
présent du subjonctif, au lieu de Y imparfait, dans la
phrase subordonnée pour exprimer une action qui a lieu
dans tous les temps. Ex. : «La raison a été donnée à
l'homme, pour qu'il puisse discerner le bien d'avec le
mal. — Je n'ai employé aucune fiction qui ne soit une
image sensible, de la vérité.» etc. L'imparfait du
subjonctif signifierait le contraire de ce que l'on
veut dire; que l'homme a pu discerner le bien d'avec
le mal, et qu’il ne peut plus, etc. . . . REMARQUE b. — Après le passé indéfini, on emploie beaucoup plus souvent le passé du subjonctif que le plus-que-parfait. Ex.: «Il a fallu qu’il se soit donné bien de la peine. — Je n’ai jamais trouvé personne qui m’ait assez aimé pour vouloir me déplaire en me disant la vérité.» etc. La deuxième règle que nous venons d’indiquer ci-dessus n’est rien moins qu’observée; on emploie le moins souvent possible l’imparfait et le plus-que-parfait du subjonctif, dont les terminaisons en asse, assiez, isse, issiez, etc., choquent si désagréablement l’oreille. Dans le style écrit, on emploie d’autres tours de langage, généralement l’infinitif; il arrive même, dans la conversation usuelle, que, le souci de l’euphonie l’emportant sur la grammaire, on remplace presque toujours l’imparfait du subjonctif par |
| le présent.*) On n’oserait jamais dire, sans se couvrir de ridicule: «Je voudrais bien que vous passassiez chez mon tailleur, que vous lui demandassiez ma note et que vous la payassiez!» |
| *) On trouve quelquefois cette licence même chez les auteurs: «Ce n’est pas assez de s’occuper des gens du peuple, sous un point de vue d’utilité; il faudrait qu’ils participent aux jouissances de l’imagination et du cœur. (Mme. de Staël.) — Il m’aurait battu jusqu’à ce que je parle. George Sand.)» |
|
M.D. Berlitz Grammaire Pratique I |