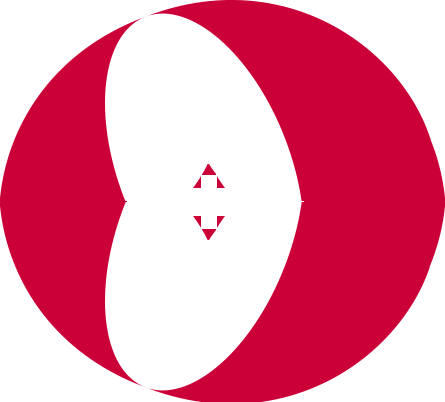| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
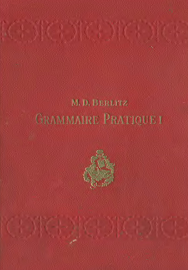 |
036 Livre M.D. Berlitz Grammaire Pratique I LES VERBES, appris par la conversation 1913 |
| page-98 |
| LE SUBJONCTIF. EMPLOI |
|
IIIÈME PARTIE. Le subjonctif dans les propositions relatives. 1° Dans les propositions relatives quand on parle de quelque chose d’incertain, il faut employer le subjonctif; mais, quand on parle de quelque chose de positif, c'est l’indicatif qui est exigé. Ex.: «Je cherche un professeur qui puisse m'apprendre le français en six mois» (= je ne sais pas s'il existe un tel professeur; il est possible qu’il en existe un, mais il est possible aussi qu’il n'en existe pas). — «Je cherche un professeur qui peut m'apprendre le français en six mois» (= je sais que ce professeur existe, je le connais et je le cherche; il n’y a pas de doute sur son existence). — «J'irai habiter cet été une campagne qui me |
|
soit agréable» (= je ne sais pas où est cette
campagne, j'ignore même si je trouverai une campagne).
— «J'irai habiter cet été une campagne qui m'est
agréable» (= je connais déjà cette campagne, je sais
qu’elle est agréable, je n'ai aucun doute). — «Vous
désirez une place où vous n'ayez rien à faire» (= vous
ne connaissez pas encore la place que vous désirez,
vous ne savez pas si elle existe). — «Vous désirez une
place où vous n'aurez rien à faire» (= vous connaissez
cette place, vous savez que vous n'y aurez rien à
faire). 2° Lorsque la proposition relative dépend d'une expression négative ou restrictive ou interrogative équivalant à une négation, on emploie le subjonctif. Exemples : LA NÉGATION: «Il n'y a pas d'homme qui le connaisse aussi bien que vous. — Je n'ai rien fait qui soit contraire aux lois. — Ils ne connaissent personne qui puisse en faire autant.» etc. LA RESTRICTION: «Il y a peu de rois qui sachent chercher la véritable gloire. — Il n'y a guère d'hommes qui veuillent le suivre.» etc. L’INTERROGATION ÉQUIVALANT X LA NÉGATION: «Y a-t-il un ennemi qui ne soit en état de nuire. — Y a-t-il un homme qui puisse dire qu'il est toujours heureux.» etc. |
|
3° On met au subjonctif le verbe de la proposition
relative quand elle dépend d’un superlatif ou d’autres
expressions analogues (telles que: le seul, l’unique,
le premier, le dernier, etc.). Ex.: «La plus haute
maison que vous ayez vue à Berlin est celle de M. X. —
C’est la plus belle campagne où l’on puisse passer
l’été. — Mon voisin est le meilleur homme que je
connaisse. — Une prompte fuite est le seul espoir qui
leur soit resté. — Voici l’unique route qui conduise
au village que vous cherchez. — C’est une des
premières épîtres que Saint Paul ait écrites. — Cette
visite est la dernière chose que vous leur deviez.»
etc. REMARQUE a. — Cependant on emploie l’indicatif après un superlatif ou d’autres mots analogues, quand on parle d'une chose évidente — dont personne ne peut douter — qui a été vue ou comptée. Ex.: «Son nom est la seule chose qu’il m'a dite. — Washington est le premier président que les États-Unis ont eu. — Les Français furent les seuls qui réussirent dans ce genre d'éloquence (VOLTAIRE). — Voilà, sans doute, la moindre de vos qualités; mais, madame, c'est la seule dont j’ai pu parler avec quelque connaissance (RACINE).» REMARQUE b. — Il va sans dire que quand la proposition relative ne dépend pas du superlatif mais d'un autre membre de la phrase, on emploie l'indicatif. Ex.: «Le soleil est le plus grand des corps que l’on aperçoit dans le ciel.» Le relatif |
| que, ne se rapporte pas au superlatif le plus grand, mais au régime des corps qui le suit. De même dans cette phrase de Le Sage: «Une des premières personnes que je rencontrai dans les rues de Grenade fut le seigneur don Fernand.» Le relatif que se rapporte, au mot personnes et non pas à premières. |
|
M.D. Berlitz Grammaire Pratique I |