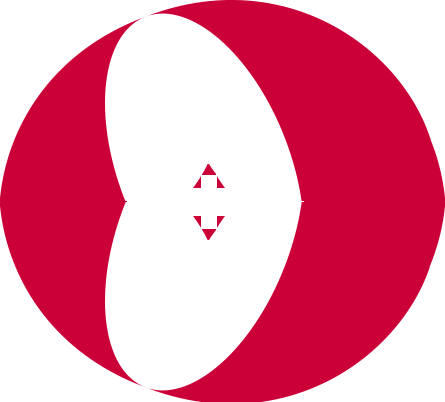| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
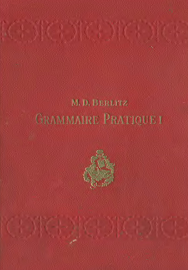 |
036 Livre M.D. Berlitz Grammaire Pratique I LES VERBES, appris par la conversation 1913 |
| page-87 |
| LE SUBJONCTIF. EMPLOI |
|
1ÈRE PARTIE. On emploie le subjonctif (avec la conjonction que): 1° Après les expressions de sentiment, c’est à-dire qui indiquent: LA JOIE: — «Je suis heureux que vous ayez réussi. — Votre père est bien aise que nous fassions cette visite. — Ils sont charmés que vous songiez à eux. — Votre oncle se réjouit que vous ne l'ayez pas oublié. — Elle est contente qu’on la fasse étudier.» etc. LE REGRET : — «Je regrette que vous me parliez ainsi. — Il est fâché que vous l'ayez négligé, et se plaint que vous lui donniez si rarement de vos nouvelles. — Elle est désolée que vous ne puissiez lui rendre ce service.» etc. LA HONTE: — «Mon cousin a honte que |
|
Louis se conduise de cette façon. — Je rougis que vous
vous soyez oublié à ce point. — Ils sont mortifiés que
Charles soit parti sans les voir. — Quant à lui, il
est honteux que son fils commette de pareilles
erreurs.» LA SURPRISE: — «Je suis surpris que vous me parliez sur ce ton. — Ils s’étonnent que vous ayez pu le faire. — C’est étonnant que nous ne soyons pas encore arrivés. — Êtes-vous surprise que nous parlions français ? — Vous vous étonnez qu’ils aillent aussi souvent à la campagne.» etc. LA PEUR: — «Je crains qu’il ne vienne. — Nous avons peur qu’elles ne soient malades. — Il redoute que vous ne paissiez réussir. — Vous êtes effrayé que votre sœur ne soit gravement malade. — Je tremble que cet oubli ne le mette en colère. — Partez vite, de peur qu’il ne vous retienne plus longtemps. — Il ne revient plus ici, de crainte que vous ne le fassiez travailler.» etc. REMARQUE a. — Après les verbes indiquant la joie, la surprise, le regret (avec la seule exception du verbe regretter), on emploie quelquefois la locution de ce que, suivie de Vindicatif, afin de mettre le fait plus en évidence que le sentiment. Ex.: «Nous sommes heureux de ce qu’elle est arrivée.» C’est le fait de son arrivée que nous voulons mettre en évidence. — «Nous sommes heureux qu’elle soit |
|
arrivée.» C’est le sentiment de notre bonheur que nous
voulons mettre en évidence. Le verbe se plaindre s’emploie quelquefois avec la conjonction que (dans le sens de de ce que), Ex.: «Je me plains que vous avez hasardé dans votre préface des choses sur lesquelles vous deviez auparavant me consulter.» REMARQUE b. — Après une expression indiquant une idée de crainte, on fait précéder du mot ne le verbe de la proposition subordonnée; ce ne n’est pas la négation, c’est simplement un mot explétif qui a été conservé du latin (timeo ne veniat.) Ex.: «Je crains qu’il ne vienne» = je pense qu’il viendra, mais je ne le désire pas. — «Je crains qu’il ne vienne pas» = je pense qu’il ne viendra pas, mais je désire qu’il vienne. Toutefois, on n’emploie pas le ne, quand la proposition principale est négative, comme: «Je ne crains pas qu’il vienne», ou bien quand elle est interrogative et fait supposer que la réponse sera négative, comme: «Pouvez-vous craindre que je vous fasse des reproches, si vous vous conduisez bien?» Il est certain que la réponse à cette question sera négative, c’est pour cela que le mot ne n’est pas employé après craindre. 2° Après une expression indiquant: a) LA VOLONTÉ — «Je veux que vous fassiez cela. — Nous désirons que vous soyez toujours sages et appliqués. — Il préfère que George finisse cela avant de partir. — Elle demande que nous venions le plus tôt possible. |
|
— Ordonnez-vous qu’ils soient enfermés? — Nous
exigeons que ce compte soit réglé immédiatement. —
Votre mère permet que vous restiez à Paris un mois de
plus. — Le professeur défend qu’on écrive en anglais
pendant les classes de français.» etc. b) L’OBJET DE LA VOLONTÉ, c’est-à-dire le but: — «Venez ici, afin que je vous dise ce que je pense. — Ils s’efforcent de faire des progrès, pour que leurs parents soient contents d’eux. — Ses frères travaillent beaucoup, de façon que Charles puisse rester au collège. — Conduisez-vous toujours bien, de manière que vous soyez estimé. — Je ferai marcher mon cheval de sorte que vous arriviez à temps.» etc. REMARQUE. — Quand les expressions de sorte que, de manière que, de façon que n’indiquent pas un but à atteindre, mais un résultat atteint (au passé elles expriment généralement un résultat, au futur elles expriment un but), on ne les fait pas suivre du subjonctif, mais de l'indicatif. Ex.: — Ces élèves se conduisent de manière que leurs maîtres n’ont que des compliments à leur faire. — Vous avez lu de façon que je n’ai pas pu vous comprendre. — La réception était superbe, de sorte que tout le monde n’a eu que des éloges à en faire. 3° Après une expression indiquant: a) LA CONDITION (c’est-à-dire après les |
|
expressions pourvu que, à condition que*) supposé
que**) au cas que, à moins que, pour peu que, si tant
est que, soit que . . . soit que, et d’autres
analogues): — «J'irai à la campagne demain, pourvu
qu'il fasse beau. — Supposé que nous arrivions à onze
heures du soir à Marseille que ferions-nous? — J'irai
volontiers à votre maison de campagne, à condition que
vous veniez m'attendre à la gare. — Il vous écrira la
semaine prochaine au cas que vous soyez encore à
Toulouse. — Venez me chercher ce soir à moins qu'il ne
pleuve. — Pour peu que vous désiriez aller au théâtre,
je vous accompagnerai. — Je payerai cette somme, si
tant est qu'elle soit réellement due. — Nous irons
vous faire une visite, soit que vous restiez en ville,
soit que vous alliez à la campagne.» etc. *) A condition que se trouve aussi avec Vindicatif et le conditionnel. **) Supposer que exprimant une condition régit le subjonctif, mais quand il exprime une pensée, il régit le mode que le verbe penser régirait dans le même cas. Ex.: «Supposons que vous soyez à Paris, iriez-vous au musée du Louvre?» = si vous étiez à Paris, iriez-vous au musée du Louvre? — «Je suppose bien qu’un Français sait parler sa langue» = je pense bien qu’un Français sait parler sa langue, etc. |
|
REMARQUE a. — Comme nous l’avons indiqué en traitant
du conditionnel, la conjonction si gouverne
l'imparfait ou le présent de Vindicatif, mais la
conjonction que, remplaçant si, régit le subjonctif.
Ex.: «Si vous voulez revenir ici et que vous ayez
besoin d'argent, écrivez-moi immédiatement. — Si vous
avez des amis et que vous désiriez les conserver,
montrez-vous toujours digne de leur estime.» etc. REMARQUE b. — On peut remplacer le plus-que-parfait de Vindicatif et le conditionnel par le plus-que-parfait du subjonctif; on peut donc dire: «S'il eût été en Italie, il se fût mieux porté,» ou bien: «S'il avait été en Italie, il se serait mieux porté. — S’il eût eu du travail, il eût gagné de l'argent,» ou bien: «S'il avait eu du travail, il aurait gagné de l'argent.» etc. b) LA CONCESSION (c'est-à-dire après les expressions quoique, quoi que, bien que, malgré que, quelque, quel que, si que, qui que, encore que, et d'autres analogues). — Ex.: «Quoique cet homme ait la figure pâle, il se porte bien. — Quoi que vous fassiez, je serai toujours votre ami. — Ils iront à Paris avec vous, bien que vous ayez refusé de les accompagner à Londres. — Quelque fort qu'il soit, il n’en viendra pas à bout. — Quels que soient nos efforts, nous n'espérons pas être les premiers de la classe — Si faibles qu'ils puissent vous paraître, ils ne vous craignent pas. — Qui que |
|
vous soyez y je suis trop occupé pour vous écouter. —
Elle est contente de son sort, encore que sa sœur soit
plus riche qu'elle. REMARQUE a. — Malgré que ne s'emploie qu'avec le verbe avoir. «Malgré qu’il en ait, nous connaissons son secret.» — (Acad.) REMARQUE b. — Tout . . . que marque la concession d'un fait certain et régit l'indicatif. «Tout riche qu'il est, il est avare» indique qu'il est certainement riche, mais que, malgré cela, il est avare. Si que admet seulement la possibilité et régit conséquemment le subjonctif, ainsi qu'il est dit plus haut. «Si riche qu'il soit, il est avare» veut dire qu'il est possible qu'il soit riche, mais que, malgré cela, il est avare. 4° Après une expression indiquant: LA NÉGATION OU L'INCERTITUDE (c'est-à-dire avec des verbes comme douter, nier, ne pas dire, ne pas croire, ne pas savoir *) ignorer, contester [verbes de la parole et de la pensée], etc., ainsi qu'après les expressions ne . . . pas, non pas que, non . . . quey ce n’est pas que, sans . . . que, bien loin . . . que, jamais . . . que, et d'autres expressions analogues). Ex.: *) Après ne pas savoir et ignorer, on emploie souvent la conjonction si à la place de que; dans ce cas, il faut naturellement l'indicatif, de même qu'avec ne pas ignorer qui équivaut à savoir. |
|
Je doute que**) vous puissiez faire ce travail. — Il nie que cela soit arrivé. — Nous contestons que leur travail vaille mieux que le nôtre. — On ne nie pas que les voyages ne soient très utiles. — Votre frère ne croit pas que vous réussissiez dans cette entreprise. — Je vous raconte cette histoire, non que j'en aie été le héros ou le témoin, mais parce qu'elle m'a été rapportée par une personne qui, jamais que je sache, n'a menti. — Ce n'est pas qu'il soit timide, mais il n'ose entrer dans un salon sans que sa soeur aille à sa rencontre. — II y a plus de quarante ans que je dis de la prose, sans que j'en susse rien (MOLIÈRE). — Bien loin que cette nouvelle me fasse plaisir, j'en éprouve, au contraire, beaucoup de chagrin. etc. REMARQUE a. — Lorsqu'il n'y a, dans l'esprit de la personne qui parle, aucune incertitude sur la réalité de l'action dont il s'agit, on emploie l'indicatif avec les verbes de la parole et de la pensée (penser, croire, dire, etc.) pris négativement. Ex.: «Je ne crois pas que Dieu est méchant» = il n'y a pas d'incertitude, parce qu'il ne peut pas **) Après ne pas douter on met ne dans la proposition subordonnée. Ex.: «Je ne doute pas que mon successeur «'ait autant de talent que moi. — Il ne doute pas que vous ne soyez leur complice. — Nous ne doutons pas qu'il «'arrive.» etc. |
|
être méchant. — «Il ne dit pas que la neige est noire»
= elle ne peut pas être noire, etc. REMARQUE b. — Mais quand les verbes qui marquent la parole ou la pensée sont employés interrogativement, ou expriment une condition on emploie Vindicatif ou le subjonctif suivant les cas: Si vous doutez vous-même, si vous n'êtes pas certain, vous employez le subjonctif ; au contraire, vous employez Vindicatif, si vous êtes certain du fait énoncé, et que vous désiriez seulement connaître la réponse de la personne à qui vous parlez. Ex.: «Croyez-vous que M. X. soit arrivé?» = je ne sais pas si M. X. est arrivé ou non, et je désire le savoir. — «Croyez-vous que M. X. est arrivé?» = je sais qu'il est arrivé, mais je veux savoir si la personne à qui je fais la question le sait. Les conjonctions avant que, jusqu’à ce que, en attendant que, qui marquent l'antériorité, et par conséquent expriment une incertitude (le fait n'étant pas encore arrivé) régissent le subjonctif, mais les autres conjonctions de temps pendant que, durant que, après que, qui marquent une chose arrivée, régissent l'indicatif. Ex.: «Ne partez pas avant que je vous le dise. — Lisez ce journal en attendant que je revienne. — Battez le fer pendant qu’il est chaud. — Vous verrez M. X. après qu'il aura dîné.» etc. |
|
M.D. Berlitz Grammaire Pratique I |