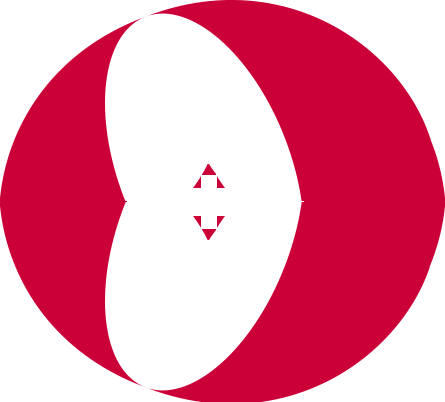| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
 |
Alexandre Dumas Le Comte de Monte-Cristo 6 volumes C. Lévy, 1889. TROISIÈME VOLUME |
|
I LES CONVIVES. (cont.) — Pardieu ! reprit Beauchamp. — Et qu’en dit-on dans le monde ? — Dans quel monde ? Nous avons beaucoup de mondes en l’an de grâce 1838. — Eh ! dans le monde critico-politique, dont vous êtes un des lions. — Mais on dit que c’est chose fort juste, et que vous semez assez de rouge pour qu’il pousse un peu de bleu. — Allons, allons, pas mal, dit Lucien : pourquoi n’êtes-vous pas des nôtres, mon cher Beauchamp ? ayant de l’esprit comme vous en avez, vous feriez fortune en trois ou quatre ans. — Aussi, je n’attends qu’une chose pour suivre votre conseil : c’est un ministère qui soit assuré pour six mois. Maintenant, un seul mot, mon cher Albert, car aussi bien faut-il que je laisse respirer le pauvre Lucien. Déjeunons-nous ou dînons-nous ? J’ai la Chambre, moi. Tout n’est pas rose, comme vous le voyez, dans notre métier. — On déjeunera seulement ; nous n’attendons plus que deux personnes, et l’on se mettra à table aussitôt qu’elles seront arrivées. — Et quelles sortes de personnes attendez-vous à déjeuner ? dit Beauchamp. — Un gentilhomme et un diplomate, reprit Albert. — Alors c’est l’affaire de deux petites heures pour le gentilhomme et de deux grandes heures pour le diplomate. Je reviendrai au dessert. Gardez-moi des fraises, du café et des cigares. Je mangerai une côtelette à la Chambre. — N’en faites rien, Beauchamp, car le gentilhomme fût-il un Montmorency, et le diplomate un Metternich, nous déjeunerons à dix heures et demie précises ; en attendant faites comme Debray, goûtez mon xérès et mes biscuits. — Allons donc, soit, je reste. Il faut absolument que je me distraie ce matin. — Bon, vous voilà comme Debray ! Il me semble cependant que lorsque le ministère est triste l’opposition doit être gaie. — Ah ! voyez-vous, cher ami, c’est que vous ne savez point ce qui me menace. J’entendrai ce matin un discours de M. Danglars à la Chambre des députés, et ce soir, chez sa femme, une tragédie d’un pair de France. Le diable emporte le gouvernement constitutionnel ! Et puisque nous avions le choix, à ce qu’on dit, comment avons-nous choisi celui-là ? — Je comprends ; vous avez besoin de faire provision d’hilarité. — Ne dites donc pas de mal des discours de M. Danglars, dit Debray : il vote pour vous, il fait de l’opposition. — Voilà, pardieu, bien le mal ! aussi j’attends que vous l’envoyiez discourir au Luxembourg pour en rire tout à mon aise. — Mon cher, dit Albert à Beauchamp, on voit bien que les affaires d’Espagne sont arrangées, vous êtes ce matin d’une aigreur révoltante. Rappelez-vous donc que la chronique parisienne parle d’un mariage entre moi et mademoiselle Eugénie Danglars. Je ne puis donc pas, en conscience, vous laisser mal parler de l’éloquence d’un homme qui doit me dire un jour : « Monsieur le vicomte, vous savez que je donne deux millions à ma fille. » — Allons donc ! dit Beauchamp, ce mariage ne se fera jamais. Le roi a pu le faire baron, il pourra le faire pair, mais il ne le fera point gentilhomme, et le comte de Morcerf est une épée trop aristocratique pour consentir, moyennant deux pauvres millions, à une mésalliance. Le vicomte de Morcerf ne doit épouser qu’une marquise. — Deux millions ! c’est cependant joli ! reprit Morcerf. — C’est le capital social d’un théâtre de boulevard ou d’un chemin de fer du jardin des Plantes à la Râpée. — Laissez-le dire, Morcerf, reprit nonchalamment Debray, et mariez-vous. Vous épousez l’étiquette d’un sac, n’est-ce pas ? eh bien, que vous importe ! mieux vaut alors sur cette étiquette un blason de moins et un zéro de plus ; vous avez sept merlettes dans vos armes, vous en donnerez trois à votre femme et il en restera encore quatre. C’est une de plus qu’a M. de Guise, qui a failli être roi de France, et dont le cousin germain était empereur d’Allemagne. — Ma foi, je crois que vous avez raison, Lucien, répondit distraitement Albert. — Et certainement ! D’ailleurs tout millionnaire est noble comme un bâtard, c’est-à-dire qu’il peut l’être. — Chut ! ne dites pas cela, Debray, reprit en riant Beauchamp, car voici Château-Renaud qui, pour vous guérir de votre manie de paradoxer, vous passera au travers du corps l’épée de Renaud de Montauban, son ancêtre. — Il dérogerait alors, répondit Lucien, car je suis vilain et très vilain. — Bon ! s’écria Beauchamp, voilà le ministère qui chante du Béranger, où allons-nous, mon Dieu ? — M. de Château-Renaud ! M. Maximilien Morrel ! dit le valet de chambre, en annonçant deux nouveaux convives. — Complets alors ! dit Beauchamp, et nous allons déjeuner ; car, si je ne me trompe, vous n’attendiez plus que deux personnes, Albert ? — Morrel ! murmura Albert surpris ; Morrel ! qu’est-ce que cela ? Mais avant qu’il eût achevé, M. de Château-Renaud, beau jeune homme de trente ans, gentilhomme des pieds à la tête, c’est-à-dire avec la figure d’un Guiche et l’esprit d’un Mortemart, avait pris Albert par la main. — Permettez-moi, mon cher, lui dit-il, de vous présenter M. le capitaine de spahis Maximilien Morrel, mon ami, et de plus mon sauveur. Au reste, l’homme se présente assez bien par lui même. Saluez mon héros, vicomte. Et il se rangea pour démasquer ce grand et noble jeune homme au front large, à l’œil perçant, aux moustaches noires, que nos lecteurs se rappellent avoir vu à Marseille, dans une circonstance assez dramatique pour qu’ils ne l’aient point encore oublié. Un riche uniforme, demi-français, demi-oriental, admirablement porté faisait valoir sa large poitrine décorée de la croix de la Légion d’honneur, et ressortir la cambrure hardie de sa taille. Le jeune officier s’inclina avec une politesse d’élégance ; Morrel était gracieux dans chacun de ses mouvements, parce qu’il était fort. — Monsieur, dit Albert avec une affectueuse courtoisie, M. le baron de Château-Renaud savait d’avance tout le plaisir qu’il me procurait en me faisant faire votre connaissance ; vous êtes de ses amis, Monsieur, soyez des nôtres. — Très bien, dit Château-Renaud, et souhaitez, mon cher vicomte, que le cas échéant il fasse pour vous ce qu’il a fait pour moi. — Et qu’a-t-il donc fait ? demanda Albert. — Oh ! dit Morrel, cela ne vaut pas la peine d’en parler, et Monsieur exagère. — Comment ! dit Château-Renaud, cela ne vaut pas la peine d’en parler ! La vie ne vaut pas la peine qu’on en parle !… En vérité, c’est par trop philosophique ce que vous dites là, mon cher monsieur Morrel… Bon pour vous qui exposez votre vie tous les jours, mais pour moi qui l’expose une fois par hasard… — Ce que je vois de plus clair dans tout cela, baron, c’est que M. le capitaine Morrel vous a sauvé la vie. — Oh ! mon Dieu, oui, tout bonnement, reprit Château-Renaud. — Et à quelle occasion ? demanda Beauchamp. — Beauchamp, mon ami, vous saurez que je meurs de faim, dit Debray, ne donnez donc pas dans les histoires. — Eh bien, mais, dit Beauchamp, je n’empêche pas qu’on se mette à table, moi… Château-Renaud nous racontera cela à table. — Messieurs, dit Morcerf, il n’est encore que dix heures un quart, remarquez bien cela, et nous attendons un dernier convive. — Ah ! c’est vrai, un diplomate, reprit Debray. — Un diplomate, ou autre chose, je n’en sais rien, ce que je sais, c’est que pour mon compte je l’ai chargé d’une ambassade qu’il a si bien terminée à ma satisfaction, que si j’avais été roi, je l’eusse fait à l’instant même chevalier de tous mes ordres, eussé-je eu à la fois la disposition de la Toison-d’Or et de la Jarretière. — Alors, puisqu’on ne se met point encore à table, dit Debray, versez-vous un verre de xérès comme nous avons fait, et racontez-nous cela, baron. — Vous savez tous que l’idée m’était venue d’aller en Afrique. — C’est un chemin que vos ancêtres vous ont tracé, mon cher Château-Renaud, répondit galamment Morcerf. — Oui, mais je doute que cela fût, comme eux, pour délivrer le tombeau du Christ. — Et vous avez raison, Beauchamp, dit le jeune aristocrate ; c’était tout bonnement pour faire le coup de pistolet en amateur. Le duel me répugne, comme vous savez, depuis que deux témoins, que j’avais choisis pour accommoder une affaire, m’ont forcé de casser le bras à un de mes meilleurs amis… eh pardieu ! à ce pauvre Franz d’Épinay, que vous connaissez tous. — Ah oui ! c’est vrai, dit Debray, vous vous êtes battu dans le temps… À quel propos ? — Le diable m’emporte si je m’en souviens ! dit Château-Renaud ; mais ce que je me rappelle parfaitement, c’est qu’ayant honte de laisser dormir un talent comme le mien, j’ai voulu essayer sur les Arabes des pistolets neufs dont on venait de me faire cadeau. En conséquence je m’embarquai pour Oran ; d’Oran je gagnai Constantine, et j’arrivai juste pour voir lever le siège. Je me mis en retraite comme les autres. Pendant quarante-huit heures je supportai assez bien la pluie le jour, la neige la nuit ; enfin, dans la troisième matinée, mon cheval mourut de froid. Pauvre bête ! accoutumée aux couvertures et au poêle de l’écurie… un cheval arabe qui seulement s’est trouvé un peu dépaysé en rencontrant dix degrés de froid en Arabie. — C’est pour cela que vous voulez m’acheter mon cheval anglais, dit Debray ; vous supposez qu’il supportera mieux le froid que votre arabe. — Vous vous trompez, car j’ai fait vœu de ne plus retourner en Afrique. — Vous avez donc eu bien peur ? demanda Beauchamp. — Ma foi, oui, je l’avoue, répondit Château-Renaud ; et il y avait de quoi ! Mon cheval était donc mort ; je faisais ma retraite à pied ; six Arabes vinrent au galop pour me couper la tête, j’en abattis deux de mes deux coups de fusil, deux de mes deux coups de pistolet, mouches pleines ; mais il en restait deux, et j’étais désarmé. L’un me prit par les cheveux, c’est pour cela que je les porte courts maintenant, on ne sait pas ce qui peut arriver, l’autre m’enveloppa le cou de son yatagan, et je sentais déjà le froid aigu du fer, quand monsieur, que vous voyez, chargea à son tour sur eux, tua celui qui me tenait par les cheveux d’un coup de pistolet, et fendit la tête de celui qui s’apprêtait à me couper la gorge d’un coup de sabre. Monsieur s’était donné pour tâche de sauver un homme ce jour-là, le hasard a voulu que ce fût moi ; quand je serai riche, je ferai faire par Klagmann ou par Marochetti une statue du Hasard. — Oui, dit en souriant Morrel ; c’était le 5 septembre, c’est-à-dire l’anniversaire d’un jour où mon père fut miraculeusement sauvé ; aussi, autant qu’il est en mon pouvoir, je célèbre tous les ans ce jour-là par quelque action… — Héroïque, n’est-ce pas ? interrompit Château-Renaud ; bref, je fus l’élu, mais ce n’est pas tout. Après m’avoir sauvé du fer, il me sauva du froid, en me donnant, non pas la moitié de son manteau, comme faisait saint Martin, mais en me le donnant tout entier ; puis de la faim, en partageant avec moi, devinez quoi ? — Un pâté de chez Félix ? demanda Beauchamp. — Non pas, son cheval, dont nous mangeâmes chacun un morceau de grand appétit : c’était dur. — Le cheval ? demanda en riant Morcerf. — Non, le sacrifice, répondit Château-Renaud. Demandez à Debray s’il sacrifierait son anglais pour un étranger ? — Pour un étranger, non, dit Debray, mais pour un ami, peut-être. — Je devinai que vous deviendriez le mien, monsieur le baron, dit Morrel ; d’ailleurs, j’ai déjà eu l’honneur de vous le dire, héroïsme ou non, sacrifice ou non, ce jour-là je devais une offrande à la mauvaise fortune en récompense de la faveur que nous avait faite autrefois la bonne. |
|
Alexandre Dumas Le Comte de Monte-Cristo |