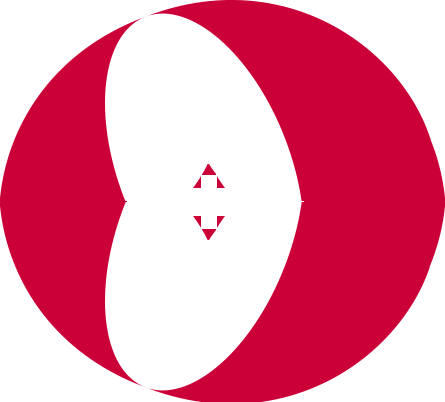| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
 |
031 Proust À la recherche du temps perdu 1. Du côté de chez Swann 1927 |
| Page 121 |
| Je trouvais important qu’elle ne partît pas avant que j’eusse pu la
regarder suffisamment, car je me rappelais que depuis des années je
considérais sa vue comme éminemment désirable, et je ne détachais pas
mes yeux d’elle, comme si chacun de mes regards eût pu matériellement
emporter et mettre en réserve en moi le souvenir du nez proéminent, des
joues rouges, de toutes ces particularités qui me semblaient autant de
renseignements précieux, authentiques et singuliers sur son visage.
Maintenant que me le faisaient trouver beau toutes les pensées que j’y
rapportais — et peut-être surtout, forme de l’instinct de conservation
des meilleures parties de nous-mêmes, ce désir qu’on a toujours de ne
pas avoir été déçu — la replaçant (puisque c’était une seule personne
qu’elle et cette duchesse de Guermantes que j’avais évoquée jusque-là)
hors du reste de l’humanité dans laquelle la vue pure et simple de son
corps me l’avait fait un instant confondre, je m’irritais en entendant
dire autour de moi : « Elle est mieux que Mme Sazerat, que Mlle Vinteuil
», comme si elle leur eût été comparable. Et mes regards s’arrêtant à
ses cheveux blonds, à ses yeux bleus, à l’attache de son cou et omettant
les traits qui eussent pu me rappeler d’autres visages, je m’écriais
devant ce croquis volontairement incomplet : « Qu’elle est belle !
Quelle noblesse ! Comme c’est bien une fière Guermantes, la descendante
de Geneviève de Brabant, que j’ai devant moi ! » Et l’attention avec
laquelle j’éclairais son visage l’isolait tellement, qu’aujourd’hui si
je repense à cette cérémonie, il m’est impossible de revoir une seule
des personnes qui y assistaient sauf elle et le suisse qui répondit
affirmativement quand je lui demandai si cette dame était bien Mme de
Guermantes. Mais elle, je la revois, surtout au moment du défilé dans la
sacristie qu’éclairait le soleil intermittent et chaud d’un jour de vent
et d’orage, et dans laquelle Mme de Guermantes se trouvait au milieu de
tous ces gens de Combray dont elle ne savait même pas les noms, mais
dont l’infériorité proclamait trop sa suprématie pour qu’elle ne
ressentît pas pour eux une sincère bienveillance, et auxquels du reste
elle espérait imposer davantage encore à force de bonne grâce et de
simplicité. Aussi, ne pouvant émettre ces regards volontaires, chargés
d’une signification précise, qu’on adresse à quelqu’un qu’on connaît,
mais seulement laisser ses pensées distraites s’échapper incessamment
devant elle en un flot de lumière bleue qu’elle ne pouvait contenir,
elle ne voulait pas qu’il pût gêner, paraître dédaigner ces petites gens
qu’il rencontrait au passage, qu’il atteignait à tous moments. Je revois
encore, au-dessus de sa cravate mauve, soyeuse et gonflée, le doux
étonnement de ses yeux auxquels elle avait ajouté sans oser le destiner
à personne, mais pour que tous pussent en prendre leur part, un sourire
un peu timide de suzeraine qui a l’air de s’excuser auprès de ses
vassaux et de les aimer. Ce sourire tomba sur moi qui ne la quittais pas
des yeux. Alors me rappelant ce regard qu’elle avait laissé s’arrêter
sur moi, pendant la messe, bleu comme un rayon de soleil qui aurait
traversé le vitrail de Gilbert le Mauvais, je me dis : « Mais sans doute
elle fait attention à moi. » Je crus que je lui plaisais, qu’elle
penserait encore à moi quand elle aurait quitté l’église, qu’à cause de
moi elle serait peut-être triste le soir à Guermantes. Et aussitôt je
l’aimai, car s’il peut quelquefois suffire pour que nous aimions une
femme qu’elle nous regarde avec mépris comme j’avais cru qu’avait fait
Mlle Swann et que nous pensions qu’elle ne pourra jamais nous
appartenir, quelquefois aussi il peut suffire qu’elle nous regarde avec
bonté comme faisait Mme de Guermantes et que nous pensions qu’elle
pourra nous appartenir. Ses yeux bleuissaient comme une pervenche
impossible à cueillir et que pourtant elle m’eût dédiée ; et le soleil,
menacé par un nuage mais dardant encore de toute sa force sur la place
et dans la sacristie, donnait une carnation de géranium aux tapis rouges
qu’on y avait étendus par terre pour la solennité, et sur lesquels
s’avançait en souriant Mme de Guermantes, et ajoutait à leur lainage un
velouté rose, un épiderme de lumière, cette sorte de tendresse, de
sérieuse douceur dans la pompe et dans la joie qui caractérisent
certaines pages de Lohengrin, certaines peintures de Carpaccio, et qui
font comprendre que Baudelaire ait pu appliquer au son de la trompette
l’épithète de délicieux. Combien depuis ce jour, dans mes promenades du côté de Guermantes, il me parut plus affligeant encore qu’auparavant de n’avoir pas de dispositions pour les lettres, et de devoir renoncer à être jamais un écrivain célèbre. Les regrets que j’en éprouvais, tandis que je restais seul à rêver un peu à l’écart, me faisaient tant souffrir, que pour ne plus les ressentir, de lui-même par une sorte d’inhibition devant la douleur, mon esprit s’arrêtait entièrement de penser aux vers, aux romans, à un avenir poétique sur lequel mon manque de talent m’interdisait de compter. Alors, bien en dehors de toutes ces préoccupations littéraires et ne s’y rattachant en rien, tout d’un coup un toit, un reflet de soleil sur une pierre, l’odeur d’un chemin me faisaient arrêter par un plaisir particulier qu’ils me donnaient, et aussi parce qu’ils avaient l’air de cacher, au delà de ce que je voyais, quelque chose qu’ils m’invitaient à venir prendre et que malgré mes efforts je n’arrivais pas à découvrir. Comme je sentais que cela se trouvait en eux, je restais là, immobile, à regarder, à respirer, à tâcher d’aller avec ma pensée au delà de l’image ou de l’odeur. Et s’il me fallait rattraper mon grand-père, poursuivre ma route, je cherchais à les retrouver en fermant les yeux ; je m’attachais à me rappeler exactement la ligne du toit, la nuance de la pierre qui, sans que je pusse comprendre pourquoi, m’avaient semblé pleines, prêtes à s’entr’ouvrir, à me livrer ce dont elles n’étaient qu’un couvercle. Certes ce n’était pas des impressions de ce genre qui pouvaient me rendre l’espérance que j’avais perdue de pouvoir être un jour écrivain et poète, car elles étaient toujours liées à un objet particulier dépourvu de valeur intellectuelle et ne se rapportant à aucune vérité abstraite. Mais du moins elles me donnaient un plaisir irraisonné, l’illusion d’une sorte de fécondité et par là me distrayaient de l’ennui, du sentiment de mon impuissance que j’avais éprouvés chaque fois que j’avais cherché un sujet philosophique pour une grande œuvre littéraire. Mais le devoir de conscience était si ardu — que m’imposaient ces impressions de forme, de parfum ou de couleur — de tâcher d’apercevoir ce qui se cachait derrière elles, que je ne tardais pas à me chercher à moi-même des excuses qui me permissent de me dérober à ces efforts et de m’épargner cette fatigue. Par bonheur mes parents m’appelaient, je sentais que je n’avais pas présentement la tranquillité nécessaire pour poursuivre utilement ma recherche, et qu’il valait mieux n’y plus penser jusqu’à ce que je fusse rentré, et ne pas me fatiguer d’avance sans résultat. Alors je ne m’occupais plus de cette chose inconnue qui s’enveloppait d’une forme ou d’un parfum, bien tranquille puisque je la ramenais à la maison, protégée par le revêtement d’images sous lesquelles je la trouverais vivante, comme des poissons que, les jours où on m’avait laissé aller à la pêche, je rapportais dans mon panier, couverts par une couche d’herbe qui préservait leur fraîcheur. Une fois à la maison je songeais à autre chose et ainsi s’entassaient dans mon esprit (comme dans ma chambre les fleurs que j’avais cueillies dans mes promenades ou les objets qu’on m’avait donnés) une pierre où jouait un reflet, un toit, un son de cloche, une odeur de feuilles, bien des images différentes sous lesquelles il y a longtemps qu’est morte la réalité pressentie que je n’ai pas eu assez de volonté pour arriver à découvrir. Une fois pourtant — où notre promenade s’étant prolongée fort au delà de sa durée habituelle, nous avions été bien heureux de rencontrer à mi-chemin du retour, comme l’après-midi finissait, le docteur Percepied qui passait en voiture à bride abattue, nous avait reconnus et fait monter avec lui — j’eus une impression de ce genre et ne l’abandonnai pas sans un peu l’approfondir. On m’avait fait monter près du cocher, nous allions comme le vent parce que le docteur avait encore avant de rentrer à Combray à s’arrêter à Martinville-le-Sec chez un malade à la porte duquel il avait été convenu que nous l’attendrions. Au tournant d’un chemin j’éprouvai tout à coup ce plaisir spécial qui ne ressemblait à aucun autre, à apercevoir les deux clochers de Martinville, sur lesquels donnait le soleil couchant et que le mouvement de notre voiture et les lacets du chemin avaient l’air de faire changer de place, puis celui de Vieuxvicq qui, séparé d’eux par une colline et une vallée, et situé sur un plateau plus élevé dans le lointain, semblait pourtant tout voisin d’eux. En constatant, en notant la forme de leur flèche, le déplacement de leurs lignes, l’ensoleillement de leur surface, je sentais que je n’allais pas au bout de mon impression, que quelque chose était derrière ce mouvement, derrière cette clarté, quelque chose qu’ils semblaient contenir et dérober à la fois. Les clochers paraissaient si éloignés et nous avions l’air de si peu nous rapprocher d’eux, que je fus étonné quand, quelques instants après, nous nous arrêtâmes devant l’église de Martinville. Je ne savais pas la raison du plaisir que j’avais eu à les apercevoir à l’horizon et l’obligation de chercher à découvrir cette raison me semblait bien pénible ; j’avais envie de garder en réserve dans ma tête ces lignes remuantes au soleil et de n’y plus penser maintenant. Et il est probable que si je l’avais fait, les deux clochers seraient allés à jamais rejoindre tant d’arbres, de toits, de parfums, de sons, que j’avais distingués des autres à cause de ce plaisir obscur qu’ils m’avaient procuré et que je n’ai jamais approfondi. Je descendis causer avec mes parents en attendant le docteur. Puis nous repartîmes, je repris ma place sur le siège, je tournai la tête pour voir encore les clochers qu’un peu plus tard j’aperçus une dernière fois au tournant d’un chemin. Le cocher, qui ne semblait pas disposé à causer, ayant à peine répondu à mes propos, force me fut, faute d’autre compagnie, de me rabattre sur celle de moi-même et d’essayer de me rappeler mes clochers. Bientôt, leurs lignes et leurs surfaces ensoleillées, comme si elles avaient été une sorte d’écorce, se déchirèrent, un peu de ce qui m’était caché en elles m’apparut, j’eus une pensée qui n’existait pas pour moi l’instant avant, qui se formula en mots dans ma tête, et le plaisir que m’avait fait tout à l’heure éprouver leur vue s’en trouva tellement accru que, pris d’une sorte d’ivresse, je ne pus pas penser à autre chose. À ce moment et comme nous étions déjà loin de Martinville, en tournant la tête je les aperçus de nouveau, tout noirs cette fois, car le soleil était déjà couché. Par moments les tournants du chemin me les dérobaient, puis ils se montrèrent une dernière fois et enfin je ne les vis plus. |
| Proust À la recherche du temps perdu 1. Du côté de chez Swann |