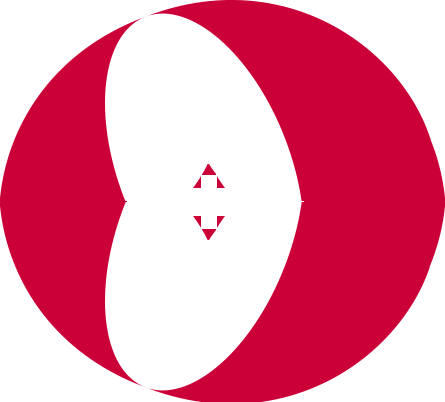| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
 |
031 Proust À la recherche du temps perdu 1. Du côté de chez Swann 1927 |
| Page 104 |
| Je ne quittais pas ma mère des yeux, je savais que quand on serait à
table, on ne me permettrait pas de rester pendant toute la durée du
dîner et que, pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait
pas l’embrasser à plusieurs reprises devant le monde, comme si ç’avait
été dans ma chambre. Aussi je me promettais, dans la salle à manger,
pendant qu’on commencerait à dîner et que je sentirais approcher
l’heure, de faire d’avance de ce baiser qui serait si court et furtif,
tout ce que j’en pouvais faire seul, de choisir avec mon regard la place
de la joue que j’embrasserais, de préparer ma pensée pour pouvoir grâce
à ce commencement mental de baiser consacrer toute la minute que
m’accorderait maman à sentir sa joue contre mes lèvres, comme un peintre
qui ne peut obtenir que de courtes séances de pose, prépare sa palette,
et a fait d’avance de souvenir, d’après ses notes, tout ce pour quoi il
pouvait à la rigueur se passer de la présence du modèle. Mais voici
qu’avant que le dîner fût sonné mon grand-père eut la férocité
inconsciente de dire : « Le petit a l’air fatigué, il devrait monter se
coucher. On dîne tard du reste ce soir. » Et mon père, qui ne gardait
pas aussi scrupuleusement que ma grand’mère et que ma mère la foi des
traités, dit : « Oui, allons, va te coucher. » Je voulus embrasser
maman, à cet instant on entendit la cloche du dîner. « Mais non, voyons,
laisse ta mère, vous vous êtes assez dit bonsoir comme cela, ces
manifestations sont ridicules. Allons, monte ! » Et il me fallut partir
sans viatique ; il me fallut monter chaque marche de l’escalier, comme
dit l’expression populaire, à « contre-cœur », montant contre mon cœur
qui voulait retourner près de ma mère parce qu’elle ne lui avait pas, en
m’embrassant, donné licence de me suivre. Cet escalier détesté où je
m’engageais toujours si tristement, exhalait une odeur de vernis qui
avait en quelque sorte absorbé, fixé, cette sorte particulière de
chagrin que je ressentais chaque soir, et la rendait peut-être plus
cruelle encore pour ma sensibilité parce que, sous cette forme
olfactive, mon intelligence n’en pouvait plus prendre sa part. Quand
nous dormons et qu’une rage de dents n’est encore perçue par nous que
comme une jeune fille que nous nous efforçons deux cents fois de suite
de tirer de l’eau ou que comme un vers de Molière que nous nous répétons
sans arrêter, c’est un grand soulagement de nous réveiller et que notre
intelligence puisse débarrasser l’idée de rage de dents de tout
déguisement héroïque ou cadencé. C’est l’inverse de ce soulagement que
j’éprouvais quand mon chagrin de monter dans ma chambre entrait en moi
d’une façon infiniment plus rapide, presque instantanée, à la fois
insidieuse et brusque, par l’inhalation — beaucoup plus toxique que la
pénétration morale — de l’odeur de vernis particulière à cet escalier.
Une fois dans ma chambre, il fallut boucher toutes les issues, fermer
les volets, creuser mon propre tombeau, en défaisant mes couvertures,
revêtir le suaire de ma chemise de nuit. Mais avant de m’ensevelir dans
le lit de fer qu’on avait ajouté dans la chambre parce que j’avais trop
chaud l’été sous les courtines de reps du grand lit, j’eus un mouvement
de révolte, je voulus essayer d’une ruse de condamné. J’écrivis à ma
mère en la suppliant de monter pour une chose grave que je ne pouvais
lui dire dans ma lettre. Mon effroi était que Françoise, la cuisinière
de ma tante, qui était chargée de s’occuper de moi quand j’étais à
Combray, refusât de porter mon mot. Je me doutais que pour elle, faire
une commission à ma mère quand il y avait du monde lui paraîtrait aussi
impossible que pour le portier d’un théâtre de remettre une lettre à un
acteur pendant qu’il est en scène. Elle possédait à l’égard des choses
qui peuvent ou ne peuvent pas se faire un code impérieux, abondant,
subtil et intransigeant sur des distinctions insaisissables ou oiseuses
(ce qui lui donnait l’apparence de ces lois antiques qui, à côté de
prescriptions féroces comme de massacrer les enfants à la mamelle,
défendent avec une délicatesse exagérée de faire bouillir le chevreau
dans le lait de sa mère, ou de manger dans un animal le nerf de la
cuisse). Ce code, si l’on en jugeait par l’entêtement soudain qu’elle
mettait à ne pas vouloir faire certaines commissions que nous lui
donnions, semblait avoir prévu des complexités sociales et des
raffinements mondains tels que rien dans l’entourage de Françoise et
dans sa vie de domestique de village n’avait pu les lui suggérer ; et
l’on était obligé de se dire qu’il y avait en elle un passé français
très ancien, noble et mal compris, comme dans ces cités manufacturières
où de vieux hôtels témoignent qu’il y eut jadis une vie de cour, et où
les ouvriers d’une usine de produits chimiques travaillent au milieu de
délicates sculptures qui représentent le miracle de saint Théophile ou
les quatre fils Aymon. Dans le cas particulier, l’article du code à
cause duquel il était peu probable que sauf le cas d’incendie Françoise
allât déranger maman en présence de M. Swann pour un aussi petit
personnage que moi, exprimait simplement le respect qu’elle professait
non seulement pour les parents — comme pour les morts, les prêtres et
les rois — mais encore pour l’étranger à qui on donne l’hospitalité,
respect qui m’aurait peut-être touché dans un livre mais qui m’irritait
toujours dans sa bouche, à cause du ton grave et attendri qu’elle
prenait pour en parler, et davantage ce soir où le caractère sacré
qu’elle conférait au dîner avait pour effet qu’elle refuserait d’en
troubler la cérémonie. Mais pour mettre une chance de mon côté, je
n’hésitai pas à mentir et à lui dire que ce n’était pas du tout moi qui
avais voulu écrire à maman, mais que c’était maman qui, en me quittant,
m’avait recommandé de ne pas oublier de lui envoyer une réponse
relativement à un objet qu’elle m’avait prié de chercher ; et elle
serait certainement très fâchée si on ne lui remettait pas ce mot. Je
pense que Françoise ne me crut pas, car, comme les hommes primitifs dont
les sens étaient plus puissants que les nôtres, elle discernait
immédiatement, à des signes insaisissables pour nous, toute vérité que
nous voulions lui cacher ; elle regarda pendant cinq minutes l’enveloppe
comme si l’examen du papier et l’aspect de l’écriture allaient la
renseigner sur la nature du contenu ou lui apprendre à quel article de
son code elle devait se référer. Puis elle sortit d’un air résigné qui
semblait signifier : « C’est-il pas malheureux pour des parents d’avoir
un enfant pareil ! » Elle revint au bout d’un moment me dire qu’on n’en
était encore qu’à la glace, qu’il était impossible au maître d’hôtel de
remettre la lettre en ce moment devant tout le monde, mais que, quand on
serait au rince-bouche, on trouverait le moyen de la faire passer à
maman. Aussitôt mon anxiété tomba ; maintenant ce n’était plus comme
tout à l’heure pour jusqu’à demain que j’avais quitté ma mère, puisque
mon petit mot allait, la fâchant sans doute (et doublement parce que ce
manège me rendrait ridicule aux yeux de Swann), me faire du moins entrer
invisible et ravi dans la même pièce qu’elle, allait lui parler de moi à
l’oreille ; puisque cette salle à manger interdite, hostile, où, il y
avait un instant encore, la glace elle-même — le « granité » — et les
rince-bouche me semblaient receler des plaisirs malfaisants et
mortellement tristes parce que maman les goûtait loin de moi, s’ouvrait
à moi et, comme un fruit devenu doux qui brise son enveloppe, allait
faire jaillir, projeter jusqu’à mon cœur enivré l’attention de maman
tandis qu’elle lirait mes lignes. Maintenant je n’étais plus séparé
d’elle ; les barrières étaient tombées, un fil délicieux nous
réunissait. Et puis, ce n’était pas tout : maman allait sans doute venir
! L’angoisse que je venais d’éprouver, je pensais que Swann s’en serait bien moqué s’il avait lu ma lettre et en avait deviné le but ; or, au contraire, comme je l’ai appris plus tard, une angoisse semblable fut le tourment de longues années de sa vie, et personne aussi bien que lui peut-être n’aurait pu me comprendre ; lui, cette angoisse qu’il y a à sentir l’être qu’on aime dans un lieu de plaisir où l’on n’est pas, où l’on ne peut pas le rejoindre, c’est l’amour qui la lui a fait connaître, l’amour auquel elle est en quelque sorte prédestinée, par lequel elle sera accaparée, spécialisée ; mais quand, comme pour moi, elle est entrée en nous avant qu’il ait encore fait son apparition dans notre vie, elle flotte en l’attendant, vague et libre, sans affectation déterminée, au service un jour d’un sentiment, le lendemain d’un autre, tantôt de la tendresse filiale ou de l’amitié pour un camarade. ─ Et la joie avec laquelle je fis mon premier apprentissage quand Françoise revint me dire que ma lettre serait remise, Swann l’avait bien connue aussi, cette joie trompeuse que nous donne quelque ami, quelque parent de la femme que nous aimons, quand arrivant à l’hôtel ou au théâtre où elle se trouve, pour quelque bal, redoute, ou première où il va la retrouver, cet ami nous aperçoit errant dehors, attendant désespérément quelque occasion de communiquer avec elle. Il nous reconnaît, nous aborde familièrement, nous demande ce que nous faisons là. Et comme nous inventons que nous avons quelque chose d’urgent à dire à sa parente ou amie, il nous assure que rien n’est plus simple, nous fait entrer dans le vestibule et nous promet de nous l’envoyer avant cinq minutes. Que nous l’aimons — comme en ce moment j’aimais Françoise — l’intermédiaire bien intentionné qui d’un mot vient de nous rendre supportable, humaine et presque propice la fête inconcevable, infernale, au sein de laquelle nous croyions que des tourbillons ennemis, pervers et délicieux entraînaient loin de nous, la faisant rire de nous, celle que nous aimons. Si nous en jugeons par lui, le parent qui nous a accosté et qui est lui aussi un des initiés des cruels mystères, les autres invités de la fête ne doivent rien avoir de bien démoniaque. Ces heures inaccessibles et suppliciantes où elle allait goûter des plaisirs inconnus, voici que par une brèche inespérée nous y pénétrons ; voici qu’un des moments dont la succession les aurait composées, un moment aussi réel que les autres, même peut-être plus important pour nous, parce que notre maîtresse y est plus mêlée, nous nous le représentons, nous le possédons, nous y intervenons, nous l’avons créé presque : le moment où on va lui dire que nous sommes là, en bas. Et sans doute les autres moments de la fête ne devaient pas être d’une essence bien différente de celui-là, ne devaient rien avoir de plus délicieux et qui dût tant nous faire souffrir, puisque l’ami bienveillant nous a dit : « Mais elle sera ravie de descendre ! Cela lui fera beaucoup plus de plaisir de causer avec vous que de s’ennuyer là-haut. » Hélas ! Swann en avait fait l’expérience, les bonnes intentions d’un tiers sont sans pouvoir sur une femme qui s’irrite de se sentir poursuivie jusque dans une fête par quelqu’un qu’elle n’aime pas. Souvent, l’ami redescend seul. Ma mère ne vint pas, et sans ménagements pour mon amour-propre (engagé à ce que la fable de la recherche dont elle était censée m’avoir prié de lui dire le résultat ne fût pas démentie) me fit dire par Françoise ces mots : « Il n’y a pas de réponse » que depuis j’ai si souvent entendu des concierges de « palaces » ou des valets de pied de tripots, rapporter à quelque pauvre fille qui s’étonne : « Comment, il n’a rien dit, mais c’est impossible ! Vous avez pourtant bien remis ma lettre. C’est bien, je vais attendre encore. » Et — de même qu’elle assure invariablement n’avoir pas besoin du bec supplémentaire que le concierge veut allumer pour elle, et reste là, n’entendant plus que les rares propos sur le temps qu’il fait échangés entre le concierge et un chasseur qu’il envoie tout d’un coup, en s’apercevant de l’heure, faire rafraîchir dans la glace la boisson d’un client — ayant décliné l’offre de Françoise de me faire de la tisane ou de rester auprès de moi, je la laissai retourner à l’office, je me couchai et je fermai les yeux en tâchant de ne pas entendre la voix de mes parents qui prenaient le café au jardin. Mais au bout de quelques secondes, je sentis qu’en écrivant ce mot à maman, en m’approchant, au risque de la fâcher, si près d’elle que j’avais cru toucher le moment de la revoir, je m’étais barré la possibilité de m’endormir sans l’avoir revue, et les battements de mon cœur de minute en minute devenaient plus douloureux parce que j’augmentais mon agitation en me prêchant un calme qui était l’acceptation de mon infortune. Tout à coup mon anxiété tomba, une félicité m’envahit comme quand un médicament puissant commence à agir et nous enlève une douleur : je venais de prendre la résolution de ne plus essayer de m’endormir sans avoir revu maman, de l’embrasser coûte que coûte, bien que ce fût avec la certitude d’être ensuite fâché pour longtemps avec elle, quand elle remonterait se coucher. Le calme qui résultait de mes angoisses finies me mettait dans une allégresse extraordinaire, non moins que l’attente, la soif et la peur du danger. J’ouvris la fenêtre sans bruit et m’assis au pied de mon lit ; je ne faisais presque aucun mouvement afin qu’on ne m’entendît pas d’en bas. Dehors, les choses semblaient, elles aussi, figées en une muette attention à ne pas troubler le clair de lune, qui doublant et reculant chaque chose par l’extension devant elle de son reflet, plus dense et concret qu’elle-même, avait à la fois aminci et agrandi le paysage comme un plan replié jusque-là, qu’on développe. Ce qui avait besoin de bouger, quelque feuillage de marronnier, bougeait. Mais son frissonnement minutieux, total, exécuté jusque dans ses moindres nuances et ses dernières délicatesses, ne bavait pas sur le reste, ne se fondait pas avec lui, restait circonscrit. Exposés sur ce silence qui n’en absorbait rien, les bruits les plus éloignés, ceux qui devaient venir de jardins situés à l’autre bout de la ville, se percevaient détaillés avec un tel « fini » qu’ils semblaient ne devoir cet effet de lointain qu’à leur pianissimo, comme ces motifs en sourdine si bien exécutés par l’orchestre du Conservatoire que, quoiqu’on n’en perde pas une note, on croit les entendre cependant loin de la salle du concert, et que tous les vieux abonnés — les sœurs de ma grand’mère aussi quand Swann leur avait donné ses places — tendaient l’oreille comme s’ils avaient écouté les progrès lointains d’une armée en marche qui n’aurait pas encore tourné la rue de Trévise. Je savais que le cas dans lequel je me mettais était de tous celui qui pouvait avoir pour moi, de la part de mes parents, les conséquences les plus graves, bien plus graves en vérité qu’un étranger n’aurait pu le supposer, de celles qu’il aurait cru que pouvaient produire seules des fautes vraiment honteuses. Mais dans l’éducation qu’on me donnait, l’ordre des fautes n’était pas le même que dans l’éducation des autres enfants, et on m’avait habitué à placer avant toutes les autres (parce que sans doute il n’y en avait pas contre lesquelles j’eusse besoin d’être plus soigneusement gardé) celles dont je comprends maintenant que leur caractère commun est qu’on y tombe en cédant à une impulsion nerveuse. Mais alors on ne prononçait pas ce mot, on ne déclarait pas cette origine qui aurait pu me faire croire que j’étais excusable d’y succomber ou même peut-être incapable d’y résister. Mais je les reconnaissais bien à l’angoisse qui les précédait comme à la rigueur du châtiment qui les suivait ; et je savais que celle que je venais de commettre était de la même famille que d’autres pour lesquelles j’avais été sévèrement puni, quoique infiniment plus grave. Quand j’irais me mettre sur le chemin de ma mère au moment où elle monterait se coucher, et qu’elle verrait que j’étais resté levé pour lui redire bonsoir dans le couloir, on ne me laisserait plus rester à la maison, on me mettrait au collège le lendemain, c’était certain. Eh bien ! dussé-je me jeter par la fenêtre cinq minutes après, j’aimerais encore mieux cela. Ce que je voulais maintenant c’était maman, c’était lui dire bonsoir, j’étais allé trop loin dans la voie qui menait à la réalisation de ce désir pour pouvoir rebrousser chemin. J’entendis les pas de mes parents qui accompagnaient Swann ; et quand le grelot de la porte m’eut averti qu’il venait de partir, j’allai à la fenêtre. Maman demandait à mon père s’il avait trouvé la langouste bonne et si M. Swann avait repris de la glace au café et à la pistache. « Je l’ai trouvée bien quelconque, dit ma mère ; je crois que la prochaine fois il faudra essayer d’un autre parfum. » — « Je ne peux pas dire comme je trouve que Swann change, dit ma grand’tante, il est d’un vieux ! » Ma grand’tante avait tellement l’habitude de voir toujours en Swann un même adolescent, qu’elle s’étonnait de le trouver tout à coup moins jeune que l’âge qu’elle continuait à lui donner. Et mes parents du reste commençaient à lui trouver cette vieillesse anormale, excessive, honteuse et méritée des célibataires, de tous ceux pour qui il semble que le grand jour qui n’a pas de lendemain soit plus long que pour les autres, parce que pour eux il est vide, et que les moments s’y additionnent depuis le matin sans se diviser ensuite entre des enfants. « Je crois qu’il a beaucoup de soucis avec sa coquine de femme qui vit au su de tout Combray avec un certain monsieur de Charlus. C’est la fable de la ville. » Ma mère fit remarquer qu’il avait pourtant l’air bien moins triste depuis quelque temps. « Il fait aussi moins souvent ce geste qu’il a tout à fait comme son père de s’essuyer les yeux et de se passer la main sur le front. Moi je crois qu’au fond il n’aime plus cette femme. » ─ « Mais naturellement il ne l’aime plus, répondit mon grand-père. J’ai reçu de lui il y a déjà longtemps une lettre à ce sujet, à laquelle je me suis empressé de ne pas me conformer, et qui ne laisse aucun doute sur ses sentiments, au moins d’amour, pour sa femme. Hé bien ! vous voyez, vous ne l’avez pas remercié pour l’asti », ajouta mon grand-père en se tournant vers ses deux belles-sœurs. « Comment, nous ne l’avons pas remercié ? je crois, entre nous, que je lui ai même tourné cela assez délicatement », répondit ma tante Flora. « Oui, tu as très bien arrangé cela : je t’ai admirée », dit ma tante Céline. ─ « Mais toi, tu as été très bien aussi. » ─ « Oui, j’étais assez fière de ma phrase sur les voisins aimables. » ─ « Comment, c’est cela que vous appelez remercier ! s’écria mon grand-père. J’ai bien entendu cela, mais du diable si j’ai cru que c’était pour Swann. Vous pouvez être sûres qu’il n’a rien compris. » ─ « Mais voyons, Swann n’est pas bête, je suis certaine qu’il a apprécié. Je ne pouvais cependant pas lui dire le nombre de bouteilles et le prix du vin ! » Mon père et ma mère restèrent seuls, et s’assirent un instant ; puis mon père dit : « Hé bien ! si tu veux, nous allons monter nous coucher. » ─ « Si tu veux, mon ami, bien que je n’aie pas l’ombre de sommeil ; ce n’est pas cette glace au café si anodine qui a pu pourtant me tenir si éveillée ; mais j’aperçois de la lumière dans l’office et puisque la pauvre Françoise m’a attendue, je vais lui demander de dégrafer mon corsage pendant que tu vas te déshabiller. » Et ma mère ouvrit la porte treillagée du vestibule qui donnait sur l’escalier. Bientôt, je l’entendis qui montait fermer sa fenêtre. J’allai sans bruit dans le couloir ; mon cœur battait si fort que j’avais de la peine à avancer, mais du moins il ne battait plus d’anxiété, mais d’épouvante et de joie. Je vis dans la cage de l’escalier la lumière projetée par la bougie de maman. Puis je la vis elle-même, je m’élançai. À la première seconde, elle me regarda avec étonnement, ne comprenant pas ce qui était arrivé. Puis sa figure prit une expression de colère, elle ne me disait même pas un mot, et en effet pour bien moins que cela on ne m’adressait plus la parole pendant plusieurs jours. Si maman m’avait dit un mot, ç’aurait été admettre qu’on pouvait me reparler et d’ailleurs cela peut-être m’eût paru plus terrible encore, comme un signe que devant la gravité du châtiment qui allait se préparer, le silence, la brouille, eussent été puérils. Une parole, c’eût été le calme avec lequel on répond à un domestique quand on vient de décider de le renvoyer ; le baiser qu’on donne à un fils qu’on envoie s’engager alors qu’on le lui aurait refusé si on devait se contenter d’être fâché deux jours avec lui. Mais elle entendit mon père qui montait du cabinet de toilette où il était allé se déshabiller, et, pour éviter la scène qu’il me ferait, elle me dit d’une voix entrecoupée par la colère : « Sauve-toi, sauve-toi, qu’au moins ton père ne t’ait vu ainsi attendant comme un fou ! » Mais je lui répétais : « Viens me dire bonsoir », terrifié en voyant que le reflet de la bougie de mon père s’élevait déjà sur le mur, mais aussi usant de son approche comme d’un moyen de chantage et espérant que maman, pour éviter que mon père me trouvât encore là si elle continuait à refuser, allait me dire : « Rentre dans ta chambre, je vais venir. » Il était trop tard, mon père était devant nous. Sans le vouloir, je murmurai ces mots que personne n’entendit : « Je suis perdu ! » |
| Proust À la recherche du temps perdu 1. Du côté de chez Swann |