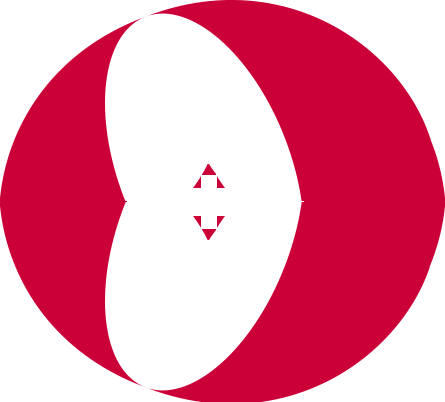| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
 |
030 Madame de La Fayette La Princesse de Clèves |
| Quatrième partie (1) |
|
Le cardinal de Lorraine s’était rendu maître
absolu de l’esprit de la reine mère : le
vidame de Chartres n’avait plus aucune part
dans ses bonnes graces, et l’amour qu’il
avait pour madame de Martigues et pour la
liberté l’avait même empêché de sentir cette
perte autant qu’elle méritait d’être sentie.
Ce cardinal, pendant les dix jours de la
maladie du roi, avait eu le loisir de former
ses desseins, et de faire prendre à la reine
des résolutions conformes à ce qu’il avait
projeté ; de sorte que, sitôt que le roi fut
mort, la reine ordonna au connétable de
demeurer aux Tournelles, auprès du corps du
feu roi, pour faire les cérémonies
ordinaires. Cette commission l’éloignait de
tout, et lui ôtait la liberté d’agir. Il
envoya un courrier au roi de Navarre, pour
le faire venir en diligence, afin de
s’opposer ensemble à la grande élévation où
il voyait que MM. de Guise allaient
parvenir. On donna le commandement des
armées au duc de Guise, et les finances au
cardinal de Lorraine : la duchesse de
Valentinois fut chassée de la cour : on fit
revenir le cardinal de Tournon, ennemi
déclaré du connétable, et le chancelier
Olivier, ennemi déclaré de la duchesse de
Valentinois : enfin la cour changea
entièrement de face. Le duc de Guise prit le
même rang que les princes du sang à porter
le manteau du roi aux cérémonies des
funérailles : lui et ses frères furent
entièrement les maîtres, non-seulement par
le crédit du cardinal sur l’esprit de la
reine, mais parce que cette princesse crut
qu’elle pourrait les éloigner s’ils lui
donnaient de l’ombrage, et qu’elle ne
pourrait éloigner le connétable, qui était
appuyé des princes du sang. Lorsque les cérémonies du deuil furent achevées, le connétable vint au Louvre, et fut reçu du roi avec beaucoup de froideur. Il voulut lui parler en particulier, mais le roi appela MM. de Guise, et lui dit devant eux qu’il lui conseillait de se reposer ; que les finances et le commandement des armées étaient donnés ; et que, lorsqu’il aurait besoin de ses conseils, il l’appellerait auprès de sa personne. Il fut reçu de la reine mère encore plus froidement que du roi, et elle lui fit même des reproches de ce qu’il avait dit au feu roi que ses enfants ne lui ressemblaient point. Le roi de Navarre arriva, et ne fut pas mieux reçu. Le prince de Condé, moins endurant que son frère, se plaignit hautement ; ses plaintes furent inutiles : on l’éloigna de la cour sous le prétexte de l’envoyer en Flandre signer la ratification de la paix. On fit voir au roi de Navarre une fausse lettre du roi d’Espagne, qui l’accusait de faire des entreprises sur ses places ; on lui fit craindre pour ses terres ; enfin on lui inspira le dessein de s’en aller en Béarn. La reine lui en fournit un moyen, en lui donnant la conduite de madame Élisabeth, et l’obligea même à partir devant cette princesse ; et ainsi il ne demeura personne à la cour qui pût balancer le pouvoir de la maison de Guise. Quoique ce fût une chose fâcheuse pour M. de Clèves de ne pas conduire madame Élisabeth, néanmoins il ne put s’en plaindre, par la grandeur de celui qu’on lui préférait ; mais il regrettait moins cet emploi par l’honneur qu’il en eût reçu, que parce que c’était une chose qui éloignait sa femme de la cour, sans qu’il parût qu’il eût dessein de l’en éloigner. Peu de jours après la mort du roi, on résolut d’aller à Rheims pour le sacre. Sitôt qu’on parla de ce voyage, madame de Clèves, qui avait toujours demeuré chez elle, feignant d’être malade, pria son mari de trouver bon qu’elle ne suivît point la cour, et qu’elle s’en allât à Coulommiers prendre l’air et songer à sa santé. Il lui répondit qu’il ne voulait point pénétrer si c’était la raison de sa santé qui l’obligeait à ne pas faire le voyage, mais qu’il consentait qu’elle ne le fît point. Il n’eut pas de peine à consentir à une chose qu’il avait déjà résolue. Quelque bonne opinion qu’il eût de la vertu de sa femme, il voyait bien que la prudence ne voulait pas qu’il l’exposât plus long-temps à la vue d’un homme qu’elle aimait. M. de Nemours sut bientôt que madame de Clèves ne devait pas suivre la cour : il ne put se résoudre à partir sans la voir ; et, la veille du départ, il alla chez elle aussi tard que la bienséance le pouvait permettre, afin de la trouver seule. La fortune favorisa son intention. Comme il entra dans la cour, il trouva madame de Nevers et madame de Martigues qui en sortaient, et qui lui dirent qu’elles l’avaient laissée seule. Il monta avec une agitation et un trouble qui ne se peut comparer qu’à celui qu’eut madame de Clèves, quand on lui dit que M. de Nemours venait pour la voir. La crainte qu’elle eut qu’il ne lui parlât de sa passion, l’appréhension de lui répondre trop favorablement, l’inquiétude que cette visite pouvait donner à son mari, la peine de lui en rendre compte ou de lui cacher toutes ces choses, se présentèrent en un moment à son esprit, et lui firent un si grand embarras qu’elle prit la résolution d’éviter la chose du monde qu’elle souhaitait peut-être le plus. Elle envoya une de ses femmes à M. de Nemours, qui était dans son anti-chambre, pour lui dire qu’elle venait de se trouver mal, et qu’elle était bien fâchée de ne pouvoir recevoir l’honneur qu’il lui voulait faire. Quelle douleur pour ce prince de ne pas voir madame de Clèves, et de ne la pas voir parce qu’elle ne voulait pas qu’il la vît ! Il s’en allait le lendemain ; il n’avait plus rien à espérer du hasard ; il ne lui avait rien dit depuis cette conversation de chez madame la dauphine, et il avait lieu de croire que la faute d’avoir parlé au vidame avait détruit toutes ses espérances ; enfin, il s’en allait avec tout ce qui peut aigrir une vive douleur. Sitôt que madame de Clèves fut un peu remise du trouble que lui avait donné la pensée de la visite de ce prince, toutes les raisons qui la lui avaient fait refuser disparurent ; elle trouva même qu’elle avait fait une faute ; et, si elle eût osé, ou qu’il eût encore été assez à temps, elle l’aurait fait rappeler. Mesdames de Nevers et de Martigues, en sortant de chez elle, allèrent chez la reine dauphine ; M. de Clèves y était. Cette princesse leur demanda d’où elles venaient ; elles lui dirent qu’elles venaient de chez M. de Clèves, où elles avaient passé une partie de l’après-dînée avec beaucoup de monde, et qu’elles n’y avaient laissé que M. de Nemours. Ces paroles, qu’elles croyaient si indifférentes, ne l’étaient pas pour M. de Clèves, quoiqu’il dût bien s’imaginer que M. de Nemours pouvait trouver souvent des occasions de parler à sa femme. Néanmoins, la pensée qu’il était chez elle, qu’il y était seul, et qu’il lui pouvait parler de son amour, lui parut dans ce moment une chose si nouvelle et si insupportable, que la jalousie s’alluma dans son cœur avec plus de violence qu’elle n’avait encore fait. Il lui fut impossible de demeurer chez la reine ; il s’en revint, ne sachant pas même pourquoi il revenait, et s’il avait dessein d’aller interrompre M. de Nemours. Sitôt qu’il approcha de chez lui, il regarda s’il ne verrait rien qui lui pût faire juger si ce prince y était encore : il sentit du soulagement en voyant qu’il n’y était plus, et il trouva de la douceur à penser qu’il ne pouvait y avoir demeuré long-temps. Il s’imagina que ce n’était peut-être pas M. de Nemours dont il devait être jaloux ; et, quoiqu’il n’en doutât point, il cherchait à en douter : mais tant de choses l’en auraient persuadé, qu’il ne demeurait pas long-temps dans cette incertitude qu’il desirait. Il alla d’abord dans la chambre de sa femme ; et, après lui avoir parlé quelque temps de choses indifférentes, il ne put s’empêcher de lui demander ce qu’elle avait fait, et qui elle avait vu : elle lui en rendit compte. Comme il vit qu’elle ne lui nommait point M. de Nemours, il lui demanda en tremblant si c’était tout ce qu’elle avait vu, afin de lui donner lieu de nommer ce prince, et de n’avoir pas la douleur qu’elle lui en fît une finesse. Comme elle ne l’avait point vu, elle ne le lui nomma point, et M. de Clèves reprenant la parole avec un ton qui marquait son affliction : Et M. de Nemours, lui dit-il, ne l’avez-vous point vu, ou l’avez-vous oublié ? Je ne l’ai point vu, en effet, répondit-elle ; je me trouvais mal, et j’ai envoyé une de mes femmes lui faire des excuses. Vous ne vous trouviez donc mal que pour lui, reprit M. de Clèves, puisque vous avez vu tout le monde ? Pourquoi des distinctions pour M. de Nemours ? Pourquoi ne vous est-il pas comme un autre ? Pourquoi faut-il que vous craigniez sa vue ? Pourquoi lui laissez-vous voir que vous la craignez ? Pourquoi lui faites-vous connaître que vous vous servez du pouvoir que sa passion vous donne sur lui ? Oseriez-vous refuser de le voir, si vous ne saviez bien qu’il distingue vos rigueurs de l’incivilité ? Mais pourquoi faut-il que vous ayez des rigueurs pour lui ? D’une personne comme vous, madame, tout est des faveurs hors l’indifférence. Je ne croyais pas, reprit madame de Clèves, quelque soupçon que vous ayez sur M. de Nemours, que vous pussiez me faire des reproches de ne l’avoir pas vu. Je vous en fais pourtant, madame, répliqua-t-il, et ils sont bien fondés : Pourquoi ne le pas voir, s’il ne vous a rien dit ? Mais, madame, il vous a parlé ; si son silence seul vous avait témoigné sa passion, elle n’aurait pas fait en vous une si grande impression ; vous n’avez pu me dire la vérité tout entière, vous m’en avez caché la plus grande partie ; vous vous êtes repentie même du peu que vous m’avez avoué, et vous n’avez pas eu la force de continuer. Je suis plus malheureux que je ne l’ai cru, et je suis le plus malheureux de tous les hommes. Vous êtes ma femme, je vous aime comme ma maîtresse, et je vous en vois aimer un autre ! cet autre est le plus aimable de la cour, et il vous voit tous les jours, il sait que vous l’aimez. Et j’ai pu croire, s’écria-t-il, que vous surmonteriez la passion que vous avez pour lui ! Il faut que j’aie perdu la raison, pour avoir cru qu’il fût possible. Je ne sais, reprit tristement madame de Clèves, si vous avez eu tort de juger favorablement d’un procédé aussi extraordinaire que le mien ; mais je ne sais si je ne me suis trompée d’avoir cru que vous me feriez justice ? N’en doutez pas, madame, répliqua M. de Clèves ; vous vous êtes trompée ; vous avez attendu de moi des choses aussi impossibles que celles que j’attendais de vous. Comment pouviez-vous espérer que je conservasse de la raison ? Vous aviez donc oublié que je vous aimais éperdûment, et que j’étais votre mari ? L’un des deux peut porter aux extrémités ; que ne peuvent point les deux ensemble ! Hé ! que ne sont-ils point aussi, continua-t-il ! Je n’ai que des sentiments violents et incertains dont je ne suis pas le maître : je ne me trouve plus digne de vous ; vous ne me paraissez plus digne de moi ; je vous adore, je vous hais ; je vous offense, je vous demande pardon ; je vous admire, j’ai honte de vous admirer ; enfin, il n’y a plus en moi ni de calme ni de raison. Je ne sais comment j’ai pu vivre depuis que vous me parlâtes à Coulommiers, et depuis le jour que vous apprîtes de madame la dauphine que l’on savait votre aventure. Je ne saurais démêler par où elle a été sue, ni ce qui se passa entre M. de Nemours et vous sur ce sujet : vous ne me l’expliquerez jamais, et je ne vous demande point de me l’expliquer : je vous demande seulement de vous souvenir que vous m’avez rendu le plus malheureux homme du monde. M. de Clèves sortit de chez sa femme après ces paroles, et partit le lendemain sans la voir ; mais il lui écrivit une lettre pleine d’affliction, d’honnêteté et de douceur. Elle y fit une réponse si touchante et si remplie d’assurances de sa conduite passée, et de celle qu’elle aurait à l’avenir, que, comme ses assurances étaient fondées sur la vérité, et que c’était en effet ses sentiments, cette lettre fit de l’impression sur M. de Clèves, et lui donna quelque calme ; joint que M. de Nemours allant trouver le roi, aussi-bien que lui, il avait le repos de savoir qu’il ne serait pas au même lieu que madame de Clèves. Toutes les fois que cette princesse parlait à son mari, la passion qu’il lui témoignait, l’honnêteté de son procédé, l’amitié qu’elle avait pour lui, et ce qu’elle lui devait, faisaient des impressions dans son cœur qui affaiblissaient l’idée de M. de Nemours ; mais ce n’était que pour quelque temps ; et cette idée revenait bientôt plus vive et plus présente qu’auparavant. Les premiers jours du départ de ce prince, elle ne sentit quasi pas son absence ; ensuite elle lui parut cruelle : depuis qu’elle l’aimait, il ne s’était point passé de jour qu’elle n’eût craint ou espéré de le rencontrer ; et elle trouva une grande peine à penser qu’il n’était plus au pouvoir du hasard de faire qu’elle le rencontrât. Elle s’en alla à Coulommiers, et, en y allant, elle eut soin d’y faire porter de grands tableaux qu’elle avait fait copier sur des originaux qu’avait fait faire madame de Valentinois pour sa belle maison d’Annet. Toutes les actions remarquables qui s’étaient passées du règne du roi étaient dans ces tableaux. Il y avait entre autres le siége de Metz, et tous ceux qui s’y étaient distingués étaient peints fort ressemblants : M. de Nemours était de ce nombre, et c’était peut-être ce qui avait donné envie à madame de Clèves d’avoir ces tableaux. Madame de Martigues, qui n’avait pu partir avec la cour, lui promit d’aller passer quelques jours à Coulommiers. La faveur de la reine, qu’elles partageaient ne leur avait point donné d’envie ni d’éloignement l’une de l’autre : elles étaient amies, sans néanmoins se confier leurs sentiments. Madame de Clèves savait que madame de Martigues aimait le vidame ; mais madame de Martigues ne savait pas que madame de Clèves aimât M. de Nemours, ni qu’elle en fût aimée. La qualité de nièce du vidame rendait madame de Clèves plus chère à madame de Martigues, et madame de Clèves l’aimait aussi comme une personne qui avait une passion aussi-bien qu’elle, et qui l’avait pour l’ami intime de son amant. Madame de Martigues vint à Coulommiers, comme elle l’avait promis à madame de Clèves : elle la trouva dans une vie fort solitaire. Cette princesse avait même cherché le moyen d’être dans une solitude entière, et de passer les soirs dans les jardins, sans être accompagnée de ses domestiques. Elle venait dans ce pavillon où M. de Nemours l’avait écoutée ; elle entrait dans le cabinet qui était ouvert sur le jardin. Ses femmes et ses domestiques demeuraient dans l’autre cabinet, ou sous le pavillon, et ne venaient point à elle qu’elle ne les appelât. Madame de Martigues n’avait jamais vu Coulommiers : elle fut surprise de toutes les beautés qu’elle y trouva, et sur-tout de l’agrément de ce pavillon ; madame de Clèves et elle y passaient tous les soirs. La liberté de se trouver seules, la nuit, dans le plus beau lieu du monde, ne laissait pas finir la conversation entre deux jeunes personnes qui avaient des passions violentes dans le cœur ; et, quoiqu’elles ne s’en fissent point de confidence, elles trouvaient un grand plaisir à se parler. Madame de Martigues aurait eu de la peine à quitter Coulommiers, si, en le quittant, elle n’eût dû aller dans un lieu où était le vidame : elle partit pour aller à Chambort, où la cour était alors. Le sacre avait été fait à Rheims par le cardinal de Lorraine, et l’on devait passer le reste de l’été dans le château de Chambort, qui était nouvellement bâti. La reine témoigna une grande joie de revoir madame de Martigues ; et, après lui en avoir donné plusieurs marques, elle lui demanda des nouvelles de madame de Clèves et de ce qu’elle faisait à la campagne. M. de Nemours et M. de Clèves étaient alors chez cette reine. Madame de Martigues, qui avait trouvé Coulommiers admirable, en conta toutes les beautés, et elle s’étendit extrêmement sur la description de ce pavillon de la forêt, et sur le plaisir qu’avait madame de Clèves de s’y promener seule une partie de la nuit. M. de Nemours, qui connaissait assez le lieu pour entendre ce qu’en disait madame de Martigues, pensa qu’il n’était pas impossible qu’il y pût voir madame de Clèves sans être vu que d’elle. Il fit quelques questions à madame de Martigues, pour s’en éclaircir encore ; et M. de Clèves, qui l’avait toujours regardé pendant que madame de Martigues avait parlé, crut voir dans ce moment ce qui lui passait dans l’esprit. Les questions que fit ce prince le confirmèrent encore dans cette pensée : en sorte qu’il ne douta point qu’il n’eût dessein d’aller voir sa femme. Il ne se trompait pas dans ses soupçons : ce dessein entra si fortement dans l’esprit de M. de Nemours, qu’après avoir passé la nuit à songer aux moyens de l’exécuter, dès le lendemain matin, il demanda congé au roi, pour aller à Paris, sur quelque prétexte qu’il inventa. M. de Clèves ne douta point du sujet de ce voyage ; mais il résolut de s’éclaircir de la conduite de sa femme, et de ne pas demeurer dans une cruelle incertitude. Il eut envie de partir en même-temps que M. de Nemours, et de venir lui-même, caché, découvrir quel succès aurait ce voyage ; mais, craignant que son départ ne parût extraordinaire, et que M. de Nemours, en étant averti, ne prît d’autres mesures, il résolut de se fier à un gentilhomme qui était à lui, dont il connaissait la fidélité et l’esprit. Il lui conta dans quel embarras il se trouvait : il lui dit quelle avait été jusqu’alors la vertu de madame de Clèves, et lui ordonna de partir sur les pas de M. de Nemours, de l’observer exactement, de voir s’il n’irait point à Coulommiers, et s’il n’entrerait point la nuit dans le jardin. |
|
Madame de La Fayette La Princesse de Clèves |