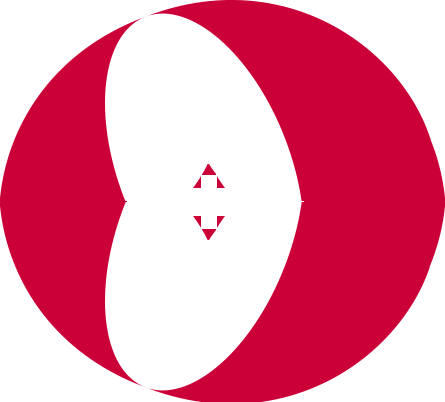| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
 |
030 Madame de La Fayette La Princesse de Clèves |
| Troisième partie (2) |
|
Madame de Clèves entra dans cet expédient ;
et d’autant plus qu’elle pensa qu’elle
enverrait querir M. de Nemours pour ravoir
la lettre même, afin de la faire copier mot
à mot, et d’en faire à-peu-près imiter
l’écriture ; et elle crut que la reine y
serait infailliblement trompée. Sitôt
qu’elle fut chez elle, elle conta à son mari
l’embarras de madame la dauphine, et le pria
d’envoyer chercher M. de Nemours. On le
chercha ; il vint en diligence. Madame de
Clèves lui dit tout ce qu’elle avait déja
appris à son mari, et lui demanda la lettre
; mais M. de Nemours répondit qu’il l’avait
déja rendue au vidame de Chartres, qui avait
eu tant de joie de la ravoir, et de se
trouver hors du péril qu’il aurait couru,
qu’il l’avait renvoyée à l’heure même à
l’amie de madame de Thémines. Madame de
Clèves se retrouva dans un nouvel embarras ;
et enfin, après avoir bien consulté, ils
résolurent de faire la lettre de mémoire.
Ils s’enfermèrent pour y travailler : on
donna ordre à la porte de ne laisser entrer
personne, et on renvoya tous les gens de M.
de Nemours. Cet air de mystère et de
confidence n’était pas d’un médiocre charme
pour ce prince et même pour madame de
Clèves. La présence de son mari et les
intérêts du vidame de Chartres la
rassuraient en quelque sorte sur ses
scrupules : elle ne sentait que le plaisir
de voir M. de Nemours ; elle en avait une
joie pure et sans mélange qu’elle n’avait
jamais sentie : cette joie lui donnait une
liberté et un enjouement dans l’esprit, que
M. de Nemours ne lui avait jamais vus, et
qui redoublaient son amour. Comme il n’avait
point eu encore de si agréables moments, sa
vivacité en était augmentée ; et, quand
madame de Clèves voulut commencer à se
souvenir de la lettre et à l’écrire, ce
prince, au lieu de lui aider sérieusement,
ne faisait que l’interrompre et lui dire des
choses plaisantes. Madame de Clèves entra
dans le même esprit de gaieté ; de sorte
qu’il y avait déja long-temps qu’ils étaient
enfermés, et on était déja venu deux fois de
la part de la reine dauphine pour dire à
madame de Clèves de se dépêcher, qu’ils
n’avaient pas encore fait la moitié de la
lettre. M. de Nemours était bien aise de faire durer un temps qui lui était si agréable, et oubliait les intérêts de son ami. Madame de Clèves ne s’ennuyait pas, et oubliait aussi les intérêts de son oncle. Enfin, à peine à quatre heures la lettre était-elle achevée ; et elle était si mal, et l’écriture dont on la fit copier ressemblait si peu à celle que l’on avait eu dessein d’imiter, qu’il eût fallu que la reine n’eût guère pris de soin d’éclaircir la vérité pour ne la pas connaître : aussi n’y fut-elle pas trompée. Quelque soin que l’on prît de lui persuader que cette lettre s’adressait à M. de Nemours, elle demeura convaincue, non-seulement qu’elle était au vidame de Chartres, mais elle crut que la reine dauphine y avait part, et qu’il y avait quelque intelligence entre eux. Cette pensée augmenta tellement la haine qu’elle avait pour cette princesse, qu’elle ne lui pardonna jamais, et qu’elle la persécuta jusqu’à ce qu’elle l’eût fait sortir de France. Pour le vidame de Chartres, il fut ruiné auprès d’elle ; et, soit que le cardinal de Lorraine se fût déjà rendu maître de son esprit, ou que l’aventure de cette lettre, qui lui fit voir qu’elle était trompée, lui aidât à démêler les autres tromperies que le vidame lui avait déja faites, il est certain qu’il ne put jamais se raccommoder sincèrement avec elle. Leur liaison se rompit ; et elle le perdit ensuite à la conjuration d’Amboise où il se trouva embarrassé. Après qu’on eut envoyé la lettre à madame la dauphine, M. de Clèves et M. de Nemours s’en allèrent. Madame de Clèves demeura seule, et, sitôt qu’elle ne fut plus soutenue par cette joie que donne la présence de ce que l’on aime, elle revint comme d’un songe ; elle regarda avec étonnement la prodigieuse différence de l’état où elle était le soir, d’avec celui où elle se trouvait alors : elle se remit devant les yeux l’aigreur et la froideur qu’elle avait fait paraître à M. de Nemours, tant qu’elle avait cru que la lettre de madame de Thémines s’adressait à lui ; quel calme et quelle douceur avaient succédé à cette aigreur, sitôt qu’il l’avait persuadée que cette lettre ne le regardait pas. Quand elle pensait qu’elle s’était reproché comme un crime, le jour précédent, de lui avoir donné des marques de sensibilité que la seule compassion pouvait avoir fait naître, et que, par son aigreur, elle lui avait fait paraître des sentiments de jalousie qui étaient des preuves certaines de passion, elle ne se reconnaissait plus elle-même. Quand elle pensait encore que M. de Nemours voyait bien qu’elle connaissait son amour ; qu’il voyait bien aussi que, malgré cette connaissance, elle ne l’en traitait pas plus mal en présence même de son mari ; qu’au contraire, elle ne l’avait jamais regardé si favorablement ; qu’elle était cause que M. de Clèves l’avait envoyé querir, et qu’ils venaient de passer une après-dînée ensemble en particulier, elle trouvait qu’elle était d’intelligence avec M. de Nemours ; qu’elle trompait le mari du monde qui méritait le moins d’être trompé ; et elle était honteuse de paraître si peu digne d’estime aux yeux même de son amant. Mais ce qu’elle pouvait moins supporter que tout le reste, était le souvenir de l’état où elle avait passé la nuit, et les cuisantes douleurs que lui avait causées la pensée que M. de Nemours aimait ailleurs, et qu’elle était trompée. Elle avait ignoré jusqu’alors les inquiétudes mortelles de la défiance et de la jalousie ; elle n’avait pensé qu’à se défendre d’aimer M. de Nemours, et elle n’avait point encore commencé à craindre qu’il en aimât une autre. Quoique les soupçons que lui avait donnés cette lettre fussent effacés, ils ne laissèrent pas de lui ouvrir les yeux sur le hasard d’être trompée, et de lui donner des impressions de défiance et de jalousie qu’elle n’avait jamais eues. Elle fut étonnée de n’avoir point encore pensé combien il était peu vraisemblable qu’un homme comme M. de Nemours, qui avait toujours fait paraître tant de légèreté parmi les femmes, fût capable d’un attachement sincère et durable. Elle trouva qu’il était presque impossible qu’elle pût être contente de sa passion : mais, quand je le pourrais être, disait-elle, qu’en veux-je faire ? Veux-je la souffrir ? Veux-je y répondre ? Veux-je m’engager dans une galanterie ? Veux-je manquer à M. de Clèves ? Veux-je me manquer à moi-même ? et veux-je enfin m’exposer aux cruels repentirs et aux mortelles douleurs que donne l’amour ? Je suis vaincue et surmontée par une inclination qui m’entraîne malgré moi : toutes mes résolutions sont inutiles ; je pensai hier tout ce que je pense aujourd’hui, et je fais aujourd’hui tout le contraire de ce que je résolus hier : il faut m’arracher de la présence de M. de Nemours ; il faut m’en aller à la campagne, quelque bizarre que puisse paraître mon voyage ; et, si M. de Clèves s’opiniâtre à l’empêcher ou à en vouloir savoir les raisons, peut-être lui ferai-je le mal, et à moi-même aussi, de les lui apprendre. Elle demeura dans cette résolution, et passa tout le soir chez elle, sans aller savoir de madame la dauphine ce qui était arrivé de la fausse lettre du vidame. Quand M. de Clèves fut revenu, elle lui dit qu’elle voulait aller à la campagne, qu’elle se trouvait mal, et qu’elle avait besoin de prendre l’air. M. de Clèves, à qui elle paraissait d’une beauté qui ne lui persuadait pas que ses maux fussent considérables, se moqua d’abord de la proposition de ce voyage, et lui répondit qu’elle oubliait que les noces des princesses et le tournoi s’allaient faire, et qu’elle n’avait pas trop de temps pour se préparer à y paraître avec la même magnificence que les autres femmes. Les raisons de son mari ne la firent pas changer de dessein ; elle le pria de trouver bon que, pendant qu’il irait à Compiègne avec le roi, elle allât à Coulommiers, qui était une belle maison à une journée de Paris, qu’ils faisaient bâtir avec soin. M. de Clèves y consentit ; elle y alla dans le dessein de n’en pas revenir sitôt, et le roi partit pour Compiègne, où il ne devait être que peu de jours. M. de Nemours avait eu bien de la douleur de n’avoir point revu madame de Clèves depuis cette après-dînée qu’il avait passée avec elle si agréablement, et qui avait augmenté ses espérances. Il avait une impatience de la revoir qui ne lui donnait point de repos, de sorte que, quand le roi revint à Paris, il résolut d’aller chez sa sœur, la duchesse de Mercœur, qui était à la campagne, assez près de Coulommiers. Il proposa au vidame d’y aller avec lui, qui accepta aisément cette proposition, et M. de Nemours la fit dans l’espérance de voir madame de Clèves, et d’aller chez elle avec le vidame. Madame de Mercœur les reçut avec beaucoup de joie, et ne pensa qu’à les divertir et à leur donner tous les plaisirs de la campagne. Comme ils étaient à la chasse à courir le cerf, M. de Nemours s’égara dans la forêt. En s’enquérant du chemin qu’il devait tenir pour s’en retourner, il sut qu’il était proche de Coulommiers. À ce mot de Coulommiers, sans faire aucune réflexion, et sans savoir quel était son dessein, il alla à toute bride du côté qu’on le lui montrait. Il arriva dans la forêt, et se laissa conduire au hasard par des routes faites avec soin, qu’il jugea bien qui conduisaient vers le château. Il trouva, au bout de ces routes, un pavillon dont le dessous était un grand salon accompagné de deux cabinets, dont l’un était ouvert sur un jardin de fleurs qui n’était séparé de la forêt que par des palissades, et le second donnait sur une grande allée du parc. Il entra dans le pavillon ; et il se serait arrêté à en regarder la beauté, sans qu’il vît venir par cette allée du parc, monsieur et madame de Clèves, accompagnés d’un grand nombre de domestiques. Comme il ne s’était pas attendu à trouver M. de Clèves, qu’il avait laissé auprès du roi, son premier mouvement le porta à se cacher : il entra dans le cabinet qui donnait sur le jardin de fleurs, dans la pensée d’en ressortir par une porte qui était ouverte sur la forêt ; mais, voyant que madame de Clèves et son mari s’étaient assis sous le pavillon, que leurs domestiques demeuraient dans le parc, et qu’ils ne pouvaient venir à lui sans passer dans le lieu où étaient monsieur et madame de Clèves, il ne put se refuser le plaisir de voir cette princesse, ni résister à la curiosité d’écouter sa conversation avec un mari qui lui donnait plus de jalousie qu’aucun de ses rivaux. Il entendit que M. de Clèves disait à sa femme : Mais pourquoi ne voulez-vous point revenir à Paris ? Qui vous peut retenir à la campagne ? Vous avez depuis quelque temps un goût pour la solitude, qui m’étonne et qui m’afflige, parce qu’il nous sépare. Je vous trouve même plus triste que de coutume, et je crains que vous n’ayez quelque sujet d’affliction. Je n’ai rien de fâcheux dans l’esprit, répondit-elle, avec un air embarrassé ; mais le tumulte de la cour est si grand, et il y a toujours un si grand monde chez vous, qu’il est impossible que le corps et l’esprit ne se lassent, et que l’on ne cherche du repos. Le repos, répliqua-t-il, n’est guère propre pour une personne de votre âge. Vous êtes, chez vous et dans la cour, d’une sorte à ne vous pas donner de lassitude, et je craindrais plutôt que vous ne fussiez bien aise d’être séparée de moi. Vous me feriez une grande injustice d’avoir cette pensée, reprit-elle avec un embarras qui augmentait toujours ; mais je vous supplie de me laisser ici. Si vous y pouviez demeurer j’en aurais beaucoup de joie, pourvu que vous y demeurassiez seul, et que vous voulussiez bien n’y avoir point ce nombre infini de gens qui ne vous quittent quasi jamais. Ah ! madame ! s’écria M. de Clèves, votre air et vos paroles me font voir que vous avez des raisons pour souhaiter d’être seule, que je ne sais point, et je vous conjure de me les dire. Il la pressa long-temps de les lui apprendre sans pouvoir l’y obliger ; et, après qu’elle se fut défendue d’une manière qui augmentait toujours la curiosité de son mari, elle demeura dans un profond silence, les yeux baissés ; puis, tout d’un coup, prenant la parole et le regardant : Ne me contraignez point, lui dit-elle, à vous avouer une chose que je n’ai pas la force de vous avouer, quoique j’en aye eu plusieurs fois le dessein. Songez seulement que la prudence ne veut pas qu’une femme de mon âge, et maîtresse de sa conduite, demeure exposée au milieu de la cour. Que me faites-vous envisager, madame, s’écria M. de Clèves ! je n’oserais vous le dire de peur de vous offenser. Madame de Clèves ne répondit point ; et son silence achevant de confirmer son mari dans ce qu’il avait pensé : Vous ne me dites rien, reprit-il, et c’est me dire que je ne me trompe pas. Hé bien ! monsieur, lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, je vais vous faire un aveu que l’on n’a jamais fait à son mari ; mais l’innocence de ma conduite et de mes intentions m’en donne la force. Il est vrai que j’ai des raisons de m’éloigner de la cour, et que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je n’ai jamais donné nulle marque de faiblesse, et je ne craindrais pas d’en laisser paraître, si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour, ou si j’avais encore madame de Chartres pour aider à me conduire. Quelque dangereux que soit le parti que je prends, je le prends avec joie pour me conserver digne d’être à vous. Je vous demande mille pardons, si j’ai des sentiments qui vous déplaisent, du moins je ne vous déplairai jamais par mes actions. Songez que, pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d’amitié et plus d’estime pour un mari que l’on en a jamais eu. Conduisez-moi, ayez pitié de moi, et aimez-moi encore si vous pouvez. M. de Clèves était demeuré, pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même, et il n’avait pas songé à faire relever sa femme. Quand elle eut cessé de parler, qu’il jeta les yeux sur elle, qu’il la vit à ses genoux, le visage couvert de larmes, et d’une beauté si admirable, il pensa mourir de douleur, et l’embrassant en la relevant : Ayez pitié de moi, vous-même, madame, lui dit-il, j’en suis digne, et pardonnez si, dans les premiers moments d’une affliction aussi violente qu’est la mienne, je ne réponds pas comme je dois à un procédé comme le vôtre. Vous me paraissez plus digne d’estime et d’admiration que tout ce qu’il y a jamais eu de femmes au monde ; mais aussi je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais été. Vous m’avez donné de la passion dès le premier moment que je vous ai vue ; vos rigueurs et votre possession n’ont pu l’éteindre : elle dure encore : je n’ai jamais pu vous donner de l’amour, et je vois que vous craignez d’en avoir pour un autre. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte ? depuis quand vous plaît-il ? qu’a-t-il fait pour vous plaire ? quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur ? Je m’étais consolé en quelque sorte de ne l’avoir pas touché, par la pensée qu’il était incapable de l’être ; cependant un autre fait ce que je n’ai pu faire ; j’ai tout ensemble la jalousie d’un mari et celle d’un amant ; mais il est impossible d’avoir celle d’un mari après un procédé comme le vôtre. Il est trop noble pour ne me pas donner une sûreté entière ; il me console même comme votre amant. La confiance et la sincérité que vous avez pour moi sont d’un prix infini : vous m’estimez assez pour croire que je n’abuserai pas de cet aveu. Vous avez raison, madame, je n’en abuserai pas, et je ne vous en aimerai pas moins. Vous me rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme ait donnée à son mari : mais, madame, achevez, et apprenez-moi qui est celui que vous voulez éviter. Je vous supplie de ne me le point demander, répondit-elle ; je suis résolue de ne vous le pas dire, et je crois que la prudence ne veut pas que je vous le nomme. Ne craignez point, madame, reprit M. de Clèves ; je connais trop le monde, pour ignorer que la considération d’un mari n’empêche pas que l’on ne soit amoureux de sa femme. On doit haïr ceux qui le sont, et non pas s’en plaindre ; et, encore une fois, madame, je vous conjure de m’apprendre ce que j’ai envie de savoir. Vous m’en presseriez inutilement, répliqua-t-elle ; j’ai de la force pour taire ce que je crois ne pas devoir dire. L’aveu que je vous ai fait n’a pas été par faiblesse ; et il faut plus de courage pour avouer cette vérité que pour entreprendre de la cacher. |
|
Madame de La Fayette La Princesse de Clèves |