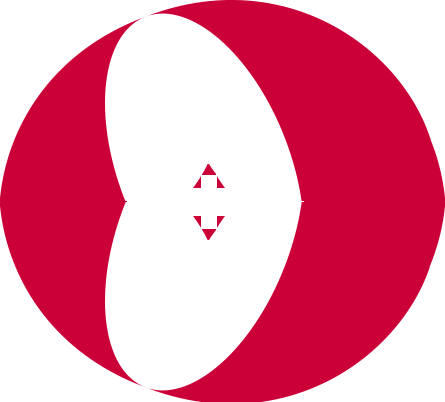| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
 |
030 Madame de La Fayette La Princesse de Clèves |
| Seconde partie |
|
Vous savez l’amitié qu’il y a entre Sancerre
et moi ; néanmoins il devint amoureux de
madame de Tournon, il y a environ deux ans,
et me le cacha avec beaucoup de soin,
aussi-bien qu’à tout le reste du monde :
j’étais bien éloigné de le soupçonner.
Madame de Tournon paraissait encore
inconsolable de la mort de son mari, et
vivait dans une retraite austère. La sœur de
Sancerre était quasi la seule personne
qu’elle vît, et c’était chez elle qu’il en
était devenu amoureux. Un soir qu’il devait y avoir une comédie au Louvre, et que l’on n’attendait plus que le roi et madame de Valentinois pour commencer, l’on vint dire qu’elle s’était trouvée mal, et que le roi ne viendrait pas. On jugea aisément que le mal de cette duchesse était quelque démêlé avec le roi : nous savions les jalousies qu’il avait eues du maréchal de Brissac pendant qu’il avait été à la cour, mais il était retourné en Piémont depuis quelques jours, et nous ne pouvions imaginer le sujet de cette brouillerie. Comme j’en parlais avec Sancerre, M. d’Anville arriva dans la salle, et me dit tout bas que le roi était dans une affliction et dans une colère qui faisaient pitié ; qu’en un raccommodement qui s’était fait entre lui et madame de Valentinois, il y avait quelques jours, sur des démêlés qu’ils avaient eus pour le maréchal de Brissac, le roi lui avait donné une bague, et l’avait priée de la porter ; que, pendant qu’elle s’habillait pour venir à la comédie, il avait remarqué qu’elle n’avait point cette bague, et lui en avait demandé la raison ; qu’elle avait paru étonnée de ne la pas avoir ; qu’elle l’avait demandée à ses femmes, lesquelles, par malheur, ou faute d’être bien instruites, avaient répondu qu’il y avait quatre ou cinq jours qu’elles ne l’avaient vue. Ce temps est précisément celui du départ du maréchal de Brissac, continua M. d’Anville : le roi n’a point douté qu’elle ne lui ait donné la bague, en lui disant adieu. Cette pensée a réveillé si vivement toute cette jalousie, qui n’était pas encore bien éteinte, qu’il s’est emporté, contre son ordinaire, et lui a fait mille reproches. Il vient de rentrer chez lui très-affligé ; mais je ne sais s’il l’est davantage de l’opinion que madame de Valentinois a sacrifié sa bague, que de la crainte de lui avoir déplu par sa colère. Sitôt que M. d’Anville eut achevé de me conter cette nouvelle, je me rapprochai de Sancerre pour la lui apprendre ; je la lui dis comme un secret que l’on venait de me confier, et dont je lui défendais de parler. Le lendemain matin, j’allai d’assez bonne heure chez ma belle-sœur : je trouvai madame de Tournon au chevet de son lit ; elle n’aimait pas madame de Valentinois, et elle savait bien que ma belle-sœur n’avait pas sujet de s’en louer. Sancerre avait été chez elle au sortir de la comédie. Il lui avait appris la brouillerie du roi avec cette duchesse ; et madame de Tournon était venue la conter à ma belle-sœur, sans savoir ou sans faire réflexion que c’était moi qui l’avait apprise à son amant. Sitôt que je m’approchai de ma belle-sœur, elle dit à madame de Tournon que l’on pouvait me confier ce qu’elle venait de lui dire ; et, sans attendre la permission de madame de Tournon, elle me conta mot pour mot tout ce que j’avais dit à Sancerre le soir précédent. Vous pouvez juger comme j’en fus étonné. Je regardai madame de Tournon ; elle me parut embarrassée. Son embarras me donna du soupçon : je n’avais dit la chose qu’à Sancerre ; il m’avait quitté au sortir de la comédie, sans m’en dire la raison ; je me souvins de lui avoir ouï extrêmement louer madame de Tournon : toutes ces choses m’ouvrirent les yeux, et je n’eus pas de peine à démêler qu’il avait une galanterie avec elle, et qu’il l’avait vue depuis qu’il m’avait quitté. Je fus si piqué de voir qu’il me cachait cette aventure, que je dis plusieurs choses qui firent connaître à madame de Tournon l’imprudence qu’elle avait faite ; je la remis à son carrosse, et je l’assurai, en la quittant, que j’enviais le bonheur de celui qui lui avait appris la brouillerie du roi et de madame de Valentinois. Je m’en allai à l’heure même trouver Sancerre ; je lui fis des reproches, et je lui dis que je savais sa passion pour madame de Tournon, sans lui dire comment je l’avais découverte : il fut contraint de me l’avouer. Je lui contai ensuite ce qui me l’avait apprise, et il m’apprit aussi le détail de leur aventure : il me dit que, quoiqu’il fût cadet de sa maison, et très-éloigné de pouvoir prétendre un aussi bon parti, néanmoins elle était résolue de l’épouser. L’on ne peut être plus surpris que je le fus. Je dis à Sancerre de presser la conclusion de son mariage, et qu’il n’y avait rien qu’il ne dût craindre d’une femme qui avait l’artifice de soutenir, aux yeux du public, un personnage si éloigné de la vérité. Il me répondit qu’elle avait été véritablement affligée ; mais que l’inclination qu’elle avait eue pour lui avait surmonté cette affliction, et qu’elle n’avait pu laisser paraître tout d’un coup un si grand changement. Il me dit encore plusieurs autres raisons pour l’excuser, qui me firent voir à quel point il en était amoureux : il m’assura qu’il la ferait consentir que je susse la passion qu’il avait pour elle, puisque aussi-bien c’était elle-même qui me l’avait apprise. Il l’y obligea en effet, quoique avec beaucoup de peine, et je fus ensuite très-avant dans leur confidence. Je n’ai jamais vu une femme avoir une conduite si honnête et si agréable à l’égard de son amant ; néanmoins j’étais toujours choqué de son affectation à paraître encore affligée. Sancerre était si amoureux et si content de la manière dont elle en usait pour lui, qu’il n’osait quasi la presser de conclure leur mariage, de peur qu’elle ne crût qu’il le souhaitait plutôt par intérêt que par une véritable passion. Il lui en parla toutefois, et elle lui parut résolue à l’épouser ; elle commença même à quitter cette retraite où elle vivait, et à se remettre dans le monde : elle venait chez ma belle-sœur à des heures où une partie de la cour s’y trouvait. Sancerre n’y venait que rarement, mais ceux qui y étaient tous les soirs et qui l’y voyaient souvent la trouvaient très-aimable. Peu de temps après qu’elle eut commencé à quitter sa solitude, Sancerre crut voir quelque refroidissement dans la passion qu’elle avait pour lui. Il m’en parla plusieurs fois, sans que je fisse aucun fondement sur ses plaintes ; mais à la fin, comme il me dit qu’au lieu d’achever leur mariage, elle semblait l’éloigner, je commençai à croire qu’il n’avait pas de tort d’avoir de l’inquiétude : je lui répondis que, quand la passion de madame de Tournon diminuerait après avoir duré deux ans, il ne faudrait pas s’en étonner ; que quand même, sans être diminuée, elle ne serait pas assez forte pour l’obliger à l’épouser, il ne devrait pas s’en plaindre ; que ce mariage, à l’égard du public, lui ferait un extrême tort, non-seulement parce qu’il n’était pas un assez bon parti pour elle, mais par le préjudice qu’il apporterait à sa réputation : qu’ainsi tout ce qu’il pouvait souhaiter était qu’elle ne le trompât point, et qu’elle ne lui donnât pas de fausses espérances. Je lui dis encore que, si elle n’avait pas la force de l’épouser, ou qu’elle lui avouât qu’elle en aimait quelque autre, il ne fallait point qu’il s’emportât, ni qu’il se plaignît ; mais qu’il devrait conserver pour elle de l’estime et de la reconnaissance. Je vous donne, lui dis-je, le conseil que je prendrais pour moi-même ; car la sincérité me touche d’une telle sorte, que je crois que, si ma maîtresse et même ma femme m’avouait que quelqu’un lui plût, j’en serais affligé sans en être aigri ; je quitterais le personnage d’amant ou de mari, pour la conseiller et pour la plaindre. Ces paroles firent rougir madame de Clèves, et elle y trouva un certain rapport avec l’état où elle était, qui la surprit, et qui lui donna un trouble dont elle fut long-temps à se remettre. Sancerre parla à madame de Tournon, continua M. de Clèves ; il lui dit tout ce que je lui avais conseillé ; mais elle le rassura avec tant de soin, et parut si offensée de ses soupçons, qu’elle les lui ôta entièrement. Elle remit néanmoins leur mariage après un voyage qu’il allait faire et qui devait être assez long : mais elle se conduisit si bien jusqu’à son départ, et en parut si affligée, que je crus aussi-bien que lui qu’elle l’aimait véritablement. Il partit il y a environ trois mois. Pendant son absence j’ai peu vu madame de Tournon : vous m’avez entièrement occupé, et je savais seulement qu’il devait bientôt revenir. Avant-hier, en arrivant à Paris, j’appris qu’elle était morte. J’envoyai savoir chez lui si on n’avait point eu de ses nouvelles : on me manda qu’il était arrivé dès la veille, qui était précisément le jour de la mort de madame de Tournon. J’allai le voir à l’heure même, me doutant bien de l’état où je le trouverais : mais son affliction passait de beaucoup ce que je m’en étais imaginé. Je n’ai jamais vu une douleur si profonde et si tendre. Dès le moment qu’il me vit, il m’embrassa, fondant en larmes : je ne la verrai plus, me dit-il, je ne la verrai plus, elle est morte ! je n’en étais pas digne ; mais je la suivrai bientôt. Après cela il se tut ; et puis, de temps en temps, redisant toujours : elle est morte, et je ne la verrai plus ! il revenait aux cris et aux larmes, et demeurait comme un homme qui n’avait plus de raison. Il me dit qu’il n’avait pas reçu souvent de ses lettres pendant son absence ; mais qu’il ne s’en était pas étonné, parce qu’il la connaissait, et qu’il savait la peine qu’elle avait à hasarder de ses lettres. Il ne doutait point qu’il ne l’eût épousée à son retour ; il la regardait comme la plus aimable et la plus fidèle personne qui eût jamais été ; il s’en croyait tendrement aimé ; il la perdait dans le moment qu’il pensait s’attacher à elle pour jamais. Toutes ces pensées le plongeaient dans une affliction violente, dont il était entièrement accablé ; et j’avoue que je ne pouvais m’empêcher d’en être touché. Je fus néanmoins contraint de le quitter pour aller chez le roi : je lui promis que je reviendrais bientôt. Je revins en effet, et je ne fus jamais si surpris que de le trouver tout différent de ce que je l’avais quitté. Il était debout dans sa chambre, avec un visage furieux, marchant et s’arrêtant comme s’il eût été hors de lui-même. Venez, venez, me dit-il, venez voir l’homme du monde le plus désespéré ; je suis plus malheureux mille fois que je n’étais tantôt, et ce que je viens d’apprendre de madame de Tournon est pire que sa mort. Je crus que la douleur le troublait entièrement ; et je ne pouvais m’imaginer qu’il y eût quelque chose de pire que la mort d’une maîtresse que l’on aime, et dont on est aimé. Je lui dis que, tant que son affliction avait eu des bornes, je l’avais approuvée, et que j’y étais entré ; mais que je ne le plaindrais plus s’il s’abandonnait au désespoir, et s’il perdait la raison. Je serais trop heureux de l’avoir perdue, et la vie aussi, s’écria-t-il : madame de Tournon m’était infidèle, et j’apprends son infidélité et sa trahison le lendemain que j’ai appris sa mort, dans un temps où mon ame est remplie et pénétrée de la plus vive douleur et de la plus tendre amour que l’on ait jamais sentie ; dans un temps où son idée est dans mon cœur comme la plus parfaite chose qui ait jamais été, et la plus parfaite à mon égard ; je trouve que je suis trompé, et qu’elle ne mérite pas que je la pleure : cependant j’ai la même affliction de sa mort, que si elle m’était fidèle, et je sens son infidélité comme si elle n’était point morte. Si j’avais appris son changement devant sa mort, la jalousie, la colère, la rage, m’auraient rempli et m’auraient endurci en quelque sorte contre la douleur de sa perte ; mais je suis dans un état où je ne puis ni m’en consoler, ni la haïr. Vous pouvez juger si je fus surpris de ce que me disait Sancerre : je lui demandai comment il avait su ce qu’il venait de me dire. Il me conta qu’un moment après que j’étais sorti de sa chambre, Estouteville, qui est son ami intime, mais qui ne savait pourtant rien de son amour pour madame de Tournon, l’était venu voir ; que d’abord qu’il avait été assis, il avait commencé à pleurer, et qu’il lui avait dit qu’il lui demandait pardon de lui avoir caché ce qu’il lui allait apprendre ; qu’il le priait d’avoir pitié de lui ; qu’il venait lui ouvrir son cœur, et qu’il voyait l’homme du monde le plus affligé de la mort de madame de Tournon. Ce nom, me dit Sancerre, m’a tellement surpris, que, quoique mon premier mouvement ait été de lui dire que j’en étais plus affligé que lui, je n’ai pas eu néanmoins la force de parler. Il a continué, et m’a dit qu’il était amoureux d’elle depuis six mois ; qu’il avait toujours voulu me le dire, mais qu’elle le lui avait défendu expressément, et avec tant d’autorité, qu’il n’avait osé lui désobéir ; qu’il lui avait plu quasi dans le même temps qu’il l’avait aimée ; qu’ils avaient caché leur passion à tout le monde ; qu’il n’avait jamais été chez elle publiquement ; qu’il avait eu le plaisir de la consoler de la mort de son mari, et qu’enfin il l’allait épouser dans le temps qu’elle était morte ; mais que ce mariage, qui était un effet de passion, aurait paru un effet de devoir et d’obéissance ; qu’elle avait gagné son père pour se faire commander de l’épouser, afin qu’il n’y eût pas un trop grand changement dans sa conduite, qui avait été si éloignée de se marier. Tant qu’Estouteville m’a parlé, me dit Sancerre, j’ai ajouté foi à ses paroles, parce que j’y ai trouvé de la vraisemblance, et que le temps où il m’a dit qu’il avait commencé à aimer madame de Tournon est précisément celui où elle m’a paru changée ; mais un moment après je l’ai cru un menteur, ou du moins un visionnaire : j’ai été prêt à le lui dire, j’ai passé ensuite à vouloir m’éclaircir ; je l’ai questionné, je lui ai fait paraître des doutes ; enfin j’ai tant fait pour m’assurer de mon malheur, qu’il m’a demandé si je connaissais l’écriture de madame de Tournon : il a mis sur mon lit quatre de ses lettres, et son portrait. Mon frère est entré dans ce moment : Estouteville avait le visage si plein de larmes, qu’il a été contraint de sortir pour ne se pas laisser voir ; il m’a dit qu’il reviendrait ce soir requérir ce qu’il me laissait ; et moi je chassai mon frère, sur le prétexte de me trouver mal, par l’impatience de voir ces lettres que l’on m’avait laissées, et espérant d’y trouver quelque chose qui ne me persuaderait pas tout ce qu’Estouteville venait de me dire. Mais hélas ! que n’y ai-je point trouvé ! Quelle tendresse ! quels serments ! quelles assurances de l’épouser ! quelles lettres ! Jamais elle ne m’en a écrit de semblables. Ainsi, ajouta-t-il, j’éprouve à-la-fois la douleur de la mort et celle de l’infidélité : ce sont deux maux que l’on a souvent comparés, mais qui n’ont jamais été sentis en même temps par la même personne. J’avoue, à ma honte, que je sens encore plus sa perte que son changement ; je ne puis la trouver assez coupable pour consentir à sa mort. Si elle vivait, j’aurais le plaisir de lui faire des reproches, et de me venger d’elle, en lui faisant connaître son injustice : mais je ne la verrai plus, reprenait-il, je ne la verrai plus : ce mal est le plus grand de tous les maux : je souhaiterais de lui rendre la vie aux dépens de la mienne. Quel souhait ! si elle revenait, elle vivrait pour Estouteville. Que j’étais heureux hier, s’écriait-il, que j’étais heureux ! j’étais l’homme du monde le plus affligé ; mais mon affliction était raisonnable, et je trouvais quelque douceur à penser que je ne devais jamais me consoler : aujourd’hui tous mes sentiments sont injustes ; je paie à une passion feinte qu’elle a eue pour moi, le même tribut de douleur que je croyais devoir à une passion véritable. Je ne puis ni haïr, ni aimer sa mémoire : je ne puis me consoler ni m’affliger. Du moins, me dit-il, en se retournant tout d’un coup vers moi, faites, je vous en conjure, que je ne voie jamais Estouteville : son nom seul me fait horreur. Je sais bien que je n’ai nul sujet de m’en plaindre ; c’est ma faute de lui avoir caché que j’aimais madame de Tournon : s’il l’eût su il ne s’y serait peut-être pas attaché, elle ne m’aurait pas été infidèle : il est venu me chercher pour me confier sa douleur ; il me fait pitié. Hé ! c’est avec raison, s’écriait-il : il aimait madame de Tournon ; il en était aimé, et il ne la verra jamais : je sens bien néanmoins que je ne saurais m’empêcher de le haïr. Et encore une fois, je vous conjure de faire en sorte que je ne le voie point. Sancerre se remit ensuite à pleurer, à regretter madame de Tournon, à lui parler, et à lui dire les choses du monde les plus tendres : il repassa ensuite à la haine, aux plaintes, aux reproches et aux imprécations contre elle. Comme je le vis dans un état si violent, je connus bien qu’il me fallait quelque secours pour m’aider à calmer son esprit : j’envoyai querir son frère, que je venais de quitter chez le roi : j’allai lui parler dans l’antichambre, avant qu’il entrât, et je lui contai l’état où était Sancerre. Nous donnâmes des ordres pour empêcher qu’il ne vît Estouteville, et nous employâmes une partie de la nuit à tâcher de le rendre capable de raison. Ce matin, je l’ai encore trouvé plus affligé : son frère est demeuré auprès de lui, et je suis revenu auprès de vous. L’on ne peut être plus surprise que je le suis, dit alors madame de Clèves, et je croyais madame de Tournon incapable d’amour et de tromperie. L’adresse et la dissimulation, reprit M. de Clèves, ne peuvent aller plus loin qu’elle les a portées. Remarquez que, quand Sancerre crut qu’elle était changée pour lui, elle l’était véritablement, et qu’elle commençait à aimer Estouteville. Elle disait à ce dernier qu’il la consolait de la mort de son mari, et que c’était lui qui était cause qu’elle quittait cette grande retraite ; et il paraissait à Sancerre que c’était parce que nous avions résolu qu’elle ne témoignerait plus d’être si affligée. Elle faisait valoir à Estouteville de cacher leur intelligence, et de paraître obligée à l’épouser par le commandement de son père, comme un effet du soin qu’elle avait de sa réputation ; et c’était pour abandonner Sancerre, sans qu’il eût sujet de s’en plaindre. Il faut que je m’en retourne, continua M. de Clèves, pour voir ce malheureux, et je crois qu’il faut que vous reveniez aussi à Paris. Il est temps que vous voyiez le monde, et que vous receviez ce nombre infini de visites dont aussi-bien vous ne sauriez vous dispenser. |
|
Madame de La Fayette La Princesse de Clèves |