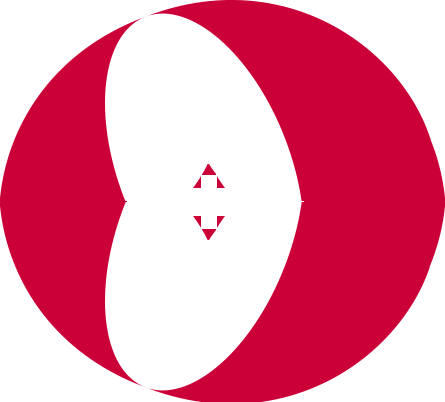| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
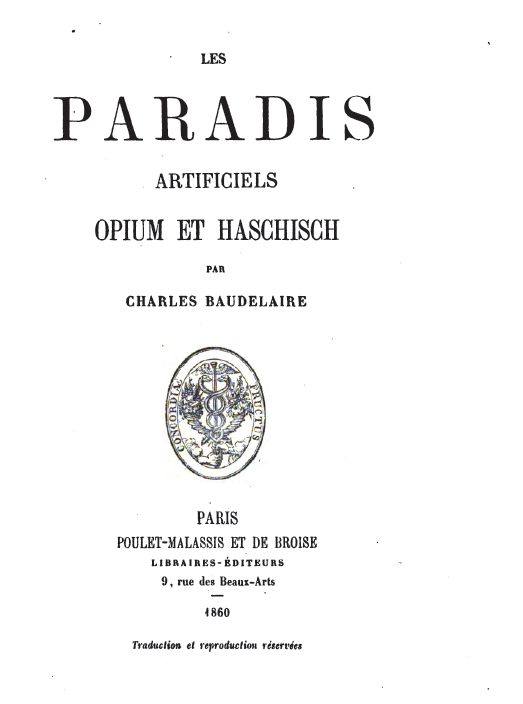 |
012 Livre Charles Baudelaire Les Paradis artificiels |
| UN MANGEUR D’OPIUM |
|
II CONFESSIONS PRÉLIMINAIRES Non, ce ne fut pas pour la recherche d’une volupté coupable et paresseuse qu’il commença à user de l’opium, mais simplement pour adoucir les tortures d’estomac nées d’une habitude cruelle de la faim. Ces angoisses de la famine datent de sa première jeunesse, et c’est à l’âge de vingt-huit ans que le mal et le remède font leur première apparition dans sa vie, après une période assez longue de bonheur, de sécurité et de bien-être. Dans quelles circonstances se produisirent ces angoisses fatales, c’est ce qu’on va voir. Le futur mangeur d’opium avait sept ans quand son père mourut, le laissant à des tuteurs qui lui firent faire sa première éducation dans plusieurs écoles. De très-bonne heure il se distingua par ses aptitudes littéraires, particulièrement par une connaissance prématurée de la langue grecque. À treize ans, il écrivait en grec ; à quinze, il pouvait non-seulement composer des vers grecs en mètres lyriques, mais même converser en grec abondamment et sans embarras, faculté qu’il devait à une habitude journalière d’improviser en grec une traduction des journaux anglais. La nécessité de trouver dans sa mémoire et son imagination une foule de périphrases pour exprimer par une langue morte des idées et des images absolument modernes, avait créé pour lui un dictionnaire toujours prêt, bien autrement complexe et étendu que celui qui résulte de la vulgaire patience des thèmes purement littéraires. « Ce garçon-là, disait un de ses maîtres en le désignant à un étranger, pourrait haranguer une foule athénienne beaucoup mieux que vous ou moi une foule anglaise. » Malheureusement notre helléniste précoce fut enlevé à cet excellent maître ; et, après avoir passé par les mains d’un grossier pédagogue tremblant toujours que l’enfant ne se fit le redresseur de son ignorance, il fut remis aux soins d’un bon et solide professeur, qui, lui aussi, péchait par le manque d’élégance et ne rappelait en rien l’ardente et étincelante érudition du premier. Mauvaise chose, qu’un enfant puisse juger ses maîtres et se placer au-dessus d’eux. On traduisait Sophocle, et, avant l’ouverture de la classe, le zélé professeur, l’archididascalus, se préparait avec une grammaire et un lexique à la lecture des chœurs, purgeant à l’avance sa leçon de toutes les hésitations et de toutes les difficultés. Cependant le jeune homme (il touchait à ses dix-sept ans) brûlait d’aller à l’université, et c’était en vain qu’il tourmentait ses tuteurs à ce sujet. L’un d’eux, homme bon et raisonnable, vivait fort loin. Sur les trois autres, deux avaient remis toute leur autorité entre les mains du quatrième ; et celui-là nous est dépeint comme le mentor le plus entêté du monde et le plus amoureux de sa propre volonté. Notre aventureux jeune homme prend un grand parti ; il fuira l’école. Il écrit à une charmante et excellente femme, une amie de famille sans doute, qui l’a tenu enfant sur ses genoux, pour lui demander cinq guinées. Une réponse pleine de grâce maternelle arrive bientôt, avec le double de la somme demandée. Sa bourse d’écolier contenait encore deux guinées, et douze guinées représentent une fortune infinie pour un enfant qui ne connaît pas les nécessités journalières de la vie. Il ne s’agit plus que d’exécuter la fuite. Le morceau suivant est un de ceux que je ne peux pas me résigner à abréger. Il est bon d’ailleurs que le lecteur puisse de temps en temps goûter par lui-même la manière pénétrante et féminine de l’auteur. « Le docteur Johnson fait une observation fort juste (et pleine de sentiment, ce que malheureusement on ne peut pas dire de toutes ses observations), c’est que nous ne faisons jamais sciemment pour la dernière fois, sans une tristesse au cœur, ce que nous avons depuis longtemps accoutumance de faire. Je sentis profondément cette vérité, quand j’en vins à quitter un lieu que je n’aimais pas, et où je n’avais pas été heureux. Le soir qui précéda le jour où je devais le fuir pour jamais, j’entendis avec tristesse résonner dans la vieille et haute salle de la classe la prière du soir ; car je l’entendais pour la dernière fois ; et la nuit venue, quand on fit l’appel, mon nom ayant été, comme d’habitude, appelé le premier, je m’avançai, et, passant devant le principal qui était présent, je le saluai ; je le regardais curieusement au visage, et je pensais en moi même : Il est vieux et infirme, et je ne le verrai plus en ce monde ! J’avais raison, car je ne l’ai pas revu et je ne le reverrai jamais. Il me regarda complaisamment, avec un bon sourire, me rendit mon salut, ou plutôt mon adieu, et nous nous quittâmes, sans qu’il s’en doutât, pour toujours. Je ne pouvais pas éprouver un profond respect pour son intelligence ; mais il s’était toujours montré bon pour moi ; il m’avait accordé maintes faveurs, et je souffrais à la pensée de la mortification que j’allais lui infliger. « Le matin arriva, où je devais me lancer sur la mer du monde, matin d’où toute ma vie subséquente a pris, en grande partie, sa couleur. Je logeais dans la maison du principal, et j’avais obtenu, dès mon arrivée, la faveur d’une chambre particulière, qui me servait également de chambre à coucher et de cabinet de travail. À trois heures et demie, je me levai, et je considérai avec une profonde émotion les anciennes tours de…, parées des premières lueurs, et qui commençaient à s’empourprer de l’éclat radieux d’une matinée de juin sans nuages. J’étais ferme et inébranlable dans mon dessein, mais troublé cependant par une appréhension vague d’embarras et de dangers incertains ; et si j’avais pu prévoir la tempête, la véritable grêle d’affliction qui devait bientôt s’abattre sur moi, j’eusse été à bon droit bien autrement agité. La paix profonde du matin faisait avec ce trouble un contraste attendrissant et lui servait presque de médecine. Le silence était plus profond qu’à minuit ; et pour moi le silence d’un matin d’été est plus touchant que tout autre silence, parce que la lumière, quoique large et forte, comme celle de midi dans les autres saisons de l’année, semble différer du jour parfait surtout en ceci que l’homme n’est pas encore dehors ; et ainsi la paix de la nature et des innocentes créatures de Dieu semble profonde et assurée, tant que la présence de l’homme, avec son esprit inquiet et instable, n’en viendra pas troubler la sainteté. Je m’habillai, je pris mon chapeau et mes gants, et je m’attardai quelque temps dans ma chambre. Depuis un an et demi, cette chambre avait été la citadelle de ma pensée ; là, j’avais lu et étudié pendant les longues heures de la nuit ; et, bien qu’à dire vrai, pendant la dernière partie de cette période, moi qui étais fait pour l’amour et les affections douces, j’eusse perdu ma gaieté et mon bonheur dans la lutte fiévreuse que j’avais soutenue contre mon tuteur, d’un autre côté cependant, un garçon comme moi, amoureux des livres, adonné aux recherches de l’esprit, ne pouvait pas n’avoir pas joui de quelques bonnes heures, au milieu même de son découragement. Je pleurais en regardant autour de moi le fauteuil, la cheminée, la table à écrire, et autres objets familiers que j’étais trop sûr de ne pas revoir. Depuis lors jusqu’à l’heure où je trace ces lignes dix-huit années se sont écoulées, et cependant, en ce moment même, je vois distinctement, comme si cela datait d’hier, le contour et l’expression de l’objet sur lequel je fixais un regard d’adieu ; c’était un portrait de la séduisante…[1], qui était suspendu au-dessus de la cheminée, et dont les yeux et la bouche étaient si beaux, et toute la physionomie si radieuse de bonté et de divine sérénité, que j’avais mille fois laissé tomber ma plume ou mon livre pour demander des consolations à son image, comme un dévot à son saint patron. Pendant que je m’oubliais à la contempler, la voix profonde de l’horloge proclama qu’il était quatre heures. Je me haussai jusqu’au portrait, je le baisai, et puis je sortis doucement et je refermai la porte pour toujours ! « Les occasions de rire et de larmes s’entrelacent et se mêlent si bien dans cette vie, que je ne puis sans sourire me rappeler un incident qui se produisit alors et faillit faire obstacle à l’exécution immédiate de mon plan. J’avais une malle d’un poids énorme ; car, outre mes habits, elle contenait presque toute ma bibliothèque. La difficulté était de la faire transporter chez un voiturier. Ma chambre était située à une hauteur aérienne, et ce qu’il y avait de pis, c’est que l’escalier qui conduisait à cet angle du bâtiment aboutissait à un corridor passant devant la porte de la chambre du principal. J’étais adoré de tous les domestiques, et, sachant que chacun d’eux s’empresserait à me servir secrètement, je confiai mon embarras à un valet de chambre du principal. Il jura qu’il ferait tout ce que je voudrais ; et quand le moment fut venu, il monta l’escalier pour emporter la malle. Je craignais fort que cela ne fût au-dessus des forces d’un seul homme ; mais ce groom était un gaillard doué D’épaules atlastiques, faites pour supporter Le poids des plus puissantes monarchies, et il avait un dos aussi vaste que les plaines de Salisbury. Il s’entêta donc à transporter la malle à lui seul, pendant que j’attendais au bas du dernier étage, plein d’anxiété. Durant quelque temps, je l’entendis qui descendait d’un pas ferme et lent ; mais malheureusement, par suite de son inquiétude, comme il se rapprochait de l’endroit dangereux, à quelques pas du corridor son pied glissa, et le puissant fardeau, tombant de ses épaules, acquit une telle vitesse de descente à chaque marche de l’escalier qu’en arrivant au bas il roula, ou plutôt bondit tout droit, avec le vacarme de vingt démons, contre la porte de la chambre à coucher de l’archididascalus. Ma première idée fut que tout était perdu et que ma seule chance pour exécuter une retraite était de sacrifier mon bagage. Néanmoins un moment de réflexion me décida à attendre la fin de l’aventure. Le groom était dans une frayeur horrible pour son propre compte et pour le mien ; mais, en dépit de tout cela, le sentiment du comique s’était, dans ce malheureux contretemps, si irrésistiblement emparé de son esprit, qu’il éclata de rire, — mais d’un rire prolongé, étourdissant, à toute volée, qui aurait réveillé les Sept-Dormants. Aux sons de cette musique de gaieté, qui résonnait aux oreilles mêmes de l’autorité insultée, je ne pus m’empêcher de joindre la mienne, non pas tant à cause de la malheureuse étourderie de la malle, qu’à cause de l’effet nerveux produit sur le groom. Nous nous attendions tous les deux, très-naturellement, à voir le docteur s’élancer hors de sa chambre ; car généralement, s’il entendait remuer une souris, il bondissait comme un mâtin hors de sa niche. Chose singulière, en cette occasion, quand nos éclats de rire eurent cessé, aucun bruit, pas même un frôlement, ne se fit entendre dans la chambre. Le docteur était affligé d’une infirmité douloureuse, qui le tenait quelquefois éveillé, mais qui peut-être, quand il parvenait à s’assoupir, le faisait dormir plus profondément. Encouragé par ce silence, le groom rechargea son fardeau sur ses épaules et effectua le reste de sa descente sans accident. J’attendis jusqu’à ce que j’eusse vu la malle placée sur une brouette, et en route pour la voiture. Alors, sans autre guide que la Providence, je partis à pied, emportant sous mon bras un petit paquet avec quelques objets de toilette, un poëte anglais favori dans une poche, et dans l’autre un petit volume in-douze contenant environ neuf pièces d’Euripide. » Notre écolier avait caressé l’idée de se diriger vers le Westmoreland ; mais un accident qu’il ne nous explique pas changea son itinéraire et le jeta dans les Galles du Nord. Après avoir erré quelque temps dans le Denbighshire, le Merionethshire et le Caernarvonshire, il s’installa dans une petite maison fort propre, à B… ; mais il en fut bientôt rejeté par un incident où son jeune orgueil se trouva froissé de la manière la plus comique. Son hôtesse avait servi chez un évêque, soit comme gouvernante, soit comme bonne d’enfants. La superbe énorme du clergé anglais s’infiltre généralement non-seulement dans les enfants des dignitaires, mais même dans leurs serviteurs. Dans une petite ville comme B…, avoir vécu dans la famille d’un évêque suffisait évidemment pour conférer une sorte de distinction ; de sorte que la bonne dame n’avait sans cesse à la bouche que des phrases comme : « Mylord faisait ceci, mylord faisait cela ; mylord était un homme indispensable au Parlement, indispensable à Oxford… » Peut-être trouva-t-elle que le jeune homme n’écoutait pas ses discours avec assez de révérence. Un jour elle était allée rendre ses devoirs à l’évêque et à sa famille, et celui-ci l’avait questionnée sur ses petites affaires. Apprenant qu’elle avait loué son appartement, le digne prélat avait pris soin de lui recommander d’être fort difficile sur le choix de ses locataires : « Betty, dit-il, rappelez-vous bien que cet endroit est placé sur la grande route qui mène à la capitale, de sorte qu’il doit vraisemblablement servir d’étape à une foule d’escrocs irlandais qui fuient leurs créanciers d’Angleterre, et d’escrocs anglais qui ont laissé des dettes dans l’île de Man. » Et la bonne dame, en racontant orgueilleusement son entrevue avec l’évêque, ne manqua pas d’ajouter sa réponse : « Oh ! mylord, je ne crois vraiment pas que ce gentleman soit un escroc, parce que… » — « Vous ne pensez pas que je sois un escroc ! répond le jeune écolier exaspéré ; désormais je vous épargnerai la peine de penser à de pareilles choses. » Et il s’apprête à partir. La pauvre hôtesse avait bien envie de mettre les pouces ; mais, la colère ayant inspiré à celui-ci quelques termes peu respectueux à l’endroit de l’évêque, toute réconciliation devint impossible. « J’étais, dit-il, véritablement indigné de cette facilité de l’évêque à calomnier une personne qu’il n’avait jamais vue, et j’eus envie de lui faire savoir là-dessus ma pensée en grec, ce qui, tout en fournissant une présomption en faveur de mon honnêteté, aurait en même temps (du moins je l’espérais) fait un devoir à l’évêque de me répondre dans la même langue : auquel cas je ne doutais pas qu’il devînt manifeste que si je n’étais pas aussi riche que sa seigneurie, j’étais un bien meilleur helléniste. Des pensées plus saines chassèrent ce projet enfantin… » Sa vie errante recommence ; mais d’auberge en auberge il se trouve rapidement dépouillé de son argent. Pendant une quinzaine de jours il est réduit à se contenter d’un seul plat par jour. L’exercice et l’air des montagnes, qui agissent vigoureusement sur un jeune estomac, lui rendent ce maigre régime fort douloureux ; car ce repas unique est fait de thé ou de café. Enfin le thé et le café deviennent un luxe impossible, et durant tout son séjour dans le pays de Galles il subsiste uniquement de mûres et de baies d’églantier. De temps à autre une bonne hospitalité coupe, comme une fête, ce régime d’anachorète, et cette hospitalité, il la paye généralement par de petits services d’écrivain public. Il remplit l’office de secrétaire pour les paysans qui ont des parents à Londres ou à Liverpool. Plus souvent ce sont des lettres d’amour que les filles qui ont été servantes, soit à Shrewsbury, soit dans toute autre ville sur la côte d’Angleterre, le chargent de rédiger pour les amoureux qu’elles y ont laissés. Il y a même un épisode de ce genre qui a un caractère touchant. Dans une partie reculée du Merionethshire, à Llan-y-Stindwr, il loge pendant un peu plus de trois jours chez des jeunes gens qui le traitent avec une cordialité charmante ; quatre sœurs et trois frères, tous parlant anglais, et doués d’une élégance et d’une beauté natives tout à fait singulières. Il rédige une lettre pour un des frères, qui, ayant servi sur un navire de guerre, veut réclamer ses parts de prise, et plus secrètement, deux lettres d’amour pour deux des sœurs. Ces naïves créatures, par leur candeur, leur distinction naturelle, et leurs pudiques rougeurs, quand elles dictent leurs instructions, font songer aux grâces limpides et délicates des keepsakes. Il s’acquitte si bien de son devoir que les blanches filles sont tout émerveillées qu’il ait su concilier les exigences de leur orgueilleuse pudeur avec leur envie secrète de dire les choses les plus aimables. Mais un matin il remarque un embarras singulier, presque une affliction ; c’est que les vieux parents reviennent, gens grognons et austères qui s’étaient absentés pour assister à un meeting annuel de méthodistes à Caernarvon. À toutes les phrases que le jeune homme leur adresse, il n’obtient pas d’autre réponse que : « Dym Sassenach » (no English). « Malgré tout ce que les jeunes gens pouvaient dire en ma faveur, je compris aisément que mes talents pour écrire des lettres d’amour seraient auprès de ces graves méthodistes sexagénaires une aussi pauvre recommandation que mes vers saphiques ou alcaïques. » Et de peur que la gracieuse hospitalité offerte par la jeunesse ne se transforme dans la main de ces rudes vieillards en une cruelle charité, il reprend son singulier pèlerinage. L’auteur ne nous dit pas par quels moyens ingénieux il réussit, malgré sa misère, à se transporter à Londres. Mais ici la misère, d’âpre qu’elle était, devient positivement terrible, presque une agonie journalière. Qu’on se figure seize semaines de tortures causées par une faim permanente, à peine soulagée par quelques bribes de pain subtilement dérobées à la table d’un homme dont nous aurons à parler tout à l’heure ; deux mois passés à la belle étoile ; et enfin le sommeil corrompu par des angoisses et des soubresauts intermittents. Certes son équipée d’écolier lui coûtait cher. Quand la saison inclémente arriva comme pour augmenter ces souffrances qui semblaient ne pouvoir s’aggraver, il eut le bonheur de trouver un abri, mais quel abri ! L’homme au déjeuner de qui il assistait et à qui il dérobait quelques croûtes de pain (celui-ci le croyait malade et ignorait qu’il fût absolument dénué de tout) lui permit de coucher dans une vaste maison inoccupée dont il était locataire. En fait de meubles, rien qu’une table et quelques chaises ; un désert poudreux, plein de rats. Au milieu de cette désolation habitait cependant une pauvre petite fille, non pas idiote, mais plus que simple, non pas jolie certes, et âgée d’une dizaine d’années, à moins toutefois que la faim dont elle était rongée n’eût vieilli prématurément son visage. Était-ce simplement une servante ou une fille naturelle de l’homme en question, l’auteur ne l’a jamais su. Cette pauvre abandonnée fut bien heureuse quand elle apprit qu’elle aurait désormais un compagnon pour les noires heures de la nuit. La maison était vaste, et l’absence de meubles et de tapisseries la rendait plus sonore ; le fourmillement des rats emplissait de bruit les salles et l’escalier. À travers les douleurs physiques du froid et de la faim, la malheureuse petite avait su se créer un mal imaginaire : elle avait peur des revenants. Le jeune homme lui promit de la protéger contre eux, et, ajoute-t-il assez drôlement, « c’était tout le secours que je pouvais lui offrir. » Ces deux pauvres êtres, maigres, affamés, frissonnants, couchaient sur le plancher avec des liasses de papiers de procédure pour oreiller, sans autre couverture qu’un vieux manteau de cavalier. Plus tard cependant, ils découvrirent dans le grenier une vieille housse de canapé, un petit morceau de tapis et quelques autres nippes qui leur firent un peu plus de chaleur. La pauvre enfant se serrait contre lui pour se réchauffer et pour se rassurer contre ses ennemis de l’autre monde. Quand il n’était pas plus malade qu’à l’ordinaire, il la prenait dans ses bras, et la petite, réchauffée par ce contact fraternel, dormait souvent tandis que lui, il n’y pouvait réussir. Car durant ses deux derniers mois de souffrance il dormait beaucoup pendant le jour, ou plutôt il tombait dans des somnolences soudaines ; mauvais sommeil hanté de rêves tumultueux ; sans cesse il s’éveillait, et sans cesse il s’endormait, la douleur et l’angoisse interrompant violemment le sommeil, et l’épuisement le ramenant irrésistiblement. Quel est l’homme nerveux qui ne connaît pas ce sommeil de chien, comme dit la langue anglaise dans son elliptique énergie ? Car les douleurs morales produisent des effets analogues à ceux des souffrances physiques, telles que la faim. On s’entend soi-même gémir ; on est quelquefois réveillé par sa propre voix ; l’estomac va se creusant sans cesse et se contractant comme une éponge opprimée par une main vigoureuse ; le diaphragme se rétrécit et se soulève ; la respiration manque, et l’angoisse va toujours croissant jusqu’à ce que, trouvant un remède dans l’intensité même de la douleur, la nature humaine fasse explosion dans un grand cri et dans un bondissement de tout le corps qui amène enfin une violente délivrance. Cependant le maître de la maison arrivait quelquefois soudainement, et de très-bonne heure ; quelquefois il ne venait pas du tout. Il était toujours sur le qui-vive, à cause des huissiers, raffinant le procédé de Cromwell et couchant chaque nuit dans un quartier différent ; examinant à travers un guichet la physionomie des gens qui frappaient à la porte ; déjeunant seul avec du thé et un petit pain ou quelques biscuits qu’il avait achetés en route, et n’invitant jamais personne. C’est pendant ce déjeuner, merveilleusement frugal, que le jeune homme trouvait subtilement quelque prétexte pour rester dans la chambre et entamer la conversation ; puis, avec l’air le plus indifférent qu’il pût se composer, il s’emparait des derniers débris de pain traînant sur la table ; mais quelquefois aucune épave ne restait pour lui. Tout avait été englouti. Quant à la petite fille, elle n’était jamais admise dans le cabinet de l’homme, si l’on peut appeler ainsi un capharnaüm de paperasses et de parchemins. À six heures ce personnage mystérieux décampait et fermait sa chambre. Le matin, à peine était-il arrivé que la petite descendait pour vaquer à son service. Quand l’heure du travail et des affaires commençait pour l’homme, le jeune vagabond sortait, et allait errer ou s’asseoir dans les parcs ou ailleurs. À la nuit il revenait à son gîte désolé, et au coup de marteau la petite accourait d’un pas tremblant pour ouvrir la porte d’entrée. À suivre |
|
Charles Baudelaire Les Paradis artificiels |