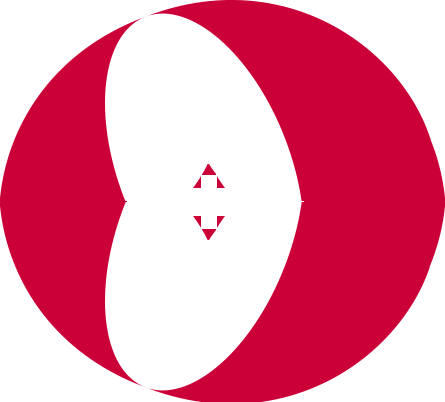| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
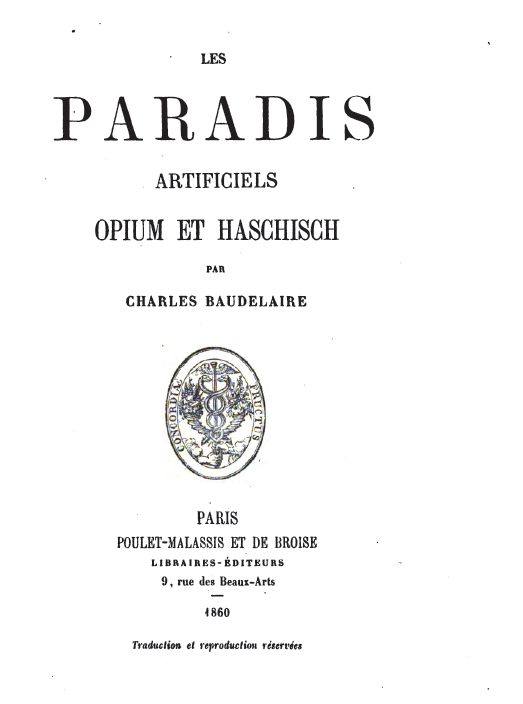 |
012 Livre Charles Baudelaire Les Paradis artificiels |
| LE POËME DU HASCHISCH |
|
IV L’HOMME-DIEU (cont.) Il ne faut pas croire que tous ces phénomènes se produisent dans l’esprit pêle-mêle, avec l’accent criard de la réalité et le désordre de la vie extérieure. L’œil intérieur transforme tout et donne à chaque chose le complément de beauté qui lui manque pour qu’elle soit vraiment digne de plaire. C’est aussi à cette phase essentiellement voluptueuse et sensuelle qu’il faut rapporter l’amour des eaux limpides, courantes ou stagnantes, qui se développe si étonnamment dans l’ivresse cérébrale de quelques artistes. Les miroirs deviennent un prétexte à cette rêverie qui ressemble à une soif spirituelle, conjointe à la soif physique qui dessèche le gosier, et dont j’ai parlé précédemment ; les eaux fuyantes, les jeux d’eau, les cascades harmonieuses, l’immensité bleue de la mer, roulent, chantent, dorment avec un charme inexprimable. L’eau s’étale comme une véritable enchanteresse, et, bien que je ne croie pas beaucoup aux folies furieuses causées par le haschisch, je n’affirmerais pas que la contemplation d’un gouffre limpide fût tout à fait sans danger pour un esprit amoureux de l’espace et du cristal, et que la vieille fable de l’Ondine ne pût devenir pour l’enthousiaste une tragique réalité. Je crois avoir suffisamment parlé de l’accroissement monstrueux du temps et de l’espace, deux idées toujours connexes, mais que l’esprit affronte alors sans tristesse et sans peur. Il regarde avec un certain délice mélancolique à travers les années profondes, et s’enfonce audacieusement dans d’infinies perspectives. On a bien deviné, je présume, que cet accroissement anormal et tyrannique s’applique également à tous les sentiments et à toutes les idées : ainsi à la bienveillance ; j’en ai donné, je crois, un assez bel échantillon ; ainsi à l’idée de beauté ; ainsi à l’amour. L’idée de beauté doit naturellement s’emparer d’une place vaste dans un tempérament spirituel tel que je l’ai supposé. L’harmonie, le balancement des lignes, l’eurythmie dans les mouvements, apparaissent au rêveur comme des nécessités, comme des devoirs, non seulement pour tous les êtres de la création, mais pour lui-même, le rêveur, qui se trouve, à cette période de la crise, doué d’une merveilleuse aptitude pour comprendre le rythme immortel et universel. Et si notre fanatique manque de beauté personnelle, ne croyez pas qu’il souffre longtemps de l’aveu auquel il est contraint, ni qu’il se regarde comme une note discordante dans le monde d’harmonie et de beauté improvisé par son imagination. Les sophismes du haschisch sont nombreux et admirables, tendant généralement à l’optimisme, et l’un des principaux, le plus efficace, est celui qui transforme le désir en réalité. Il en est de même sans doute dans maint cas de la vie ordinaire, mais ici avec combien plus d’ardeur et de subtilité ! D’ailleurs, comment un être si bien doué pour comprendre l’harmonie, une sorte de prêtre du Beau, pourrait-il faire une exception et une tache dans sa propre théorie ? La beauté morale et sa puissance, la grâce et ses séductions, l’éloquence et ses prouesses, toutes ces idées se présentent bientôt comme des correctifs d’une laideur indiscrète, puis comme des consolateurs, enfin comme des adulateurs parfaits d’un sceptre imaginaire. Quant à l’amour, j’ai entendu bien des personnes animées d’une curiosité de lycéen, chercher à se renseigner auprès de celles à qui était familier l’usage du haschisch. Que peut être cette ivresse de l’amour, déjà si puissante à son état naturel, quand elle est enfermée dans l’autre ivresse, comme un soleil dans un soleil ? Telle est la question qui se dressera dans une foule d’esprits que j’appellerai les badauds du monde intellectuel. Pour répondre à un sous-entendu déshonnête, à cette partie de la question qui n’ose pas se produire, je renverrai le lecteur à Pline, qui a parlé quelque part des propriétés du chanvre de façon à dissiper sur ce sujet bien des illusions. On sait, en outre, que l’atonie est le résultat le plus ordinaire de l’abus que les hommes font de leurs nerfs et des substances propres à les exciter. Or, comme il ne s’agit pas ici de puissance affective, mais d’émotion ou de susceptibilité, je prierai simplement le lecteur de considérer que l’imagination d’un homme nerveux, enivré de haschisch, est poussée jusqu’à un degré prodigieux, aussi peu déterminable que la force extrême possible du vent dans un ouragan, et ses sens subtilisés à un point presque aussi difficile à définir. Il est donc permis de croire qu’une caresse légère, la plus innocente de toutes, une poignée de main, par exemple, peut avoir une valeur centuplée par l’état actuel de l’âme et des sens, et les conduire peut-être, et très rapidement, jusqu’à cette syncope qui est considérée par les vulgaires mortels comme le summum du bonheur. Mais que le haschisch réveille, dans une imagination souvent occupée des choses de l’amour, des souvenirs tendres, auxquels la douleur et le malheur donnent même un lustre nouveau, cela est indubitable. Il n’est pas moins certain qu’une forte dose de sensualité se mêle à ces agitations de l’esprit ; et d’ailleurs il n’est pas inutile de remarquer, ce qui suffirait à constater sur ce point l’immoralité du haschisch, qu’une secte d’Ismaïlites (c’est des Ismaïlites que sont issus les Assassins) égarait ses adorations bien au-delà de l’impartial Lingam, c’est-à-dire jusqu’au culte absolu et exclusif de la moitié féminine du symbole. Il n’y aurait rien que de naturel, chaque homme étant la représentation de l’histoire, de voir une hérésie obscène, une religion monstrueuse se produire dans un esprit qui s’est lâchement livré à la merci d’une drogue infernale, et qui sourit à la dilapidation de ses propres facultés. Puisque nous avons vu se manifester dans l’ivresse du haschisch une bienveillance singulière appliquée même aux inconnus, une espèce de philanthropie plutôt faite de pitié que d’amour (c’est ici que se montre le premier germe de l’esprit satanique qui se développera d’une manière extraordinaire), mais qui va jusqu’à la crainte d’affliger qui que ce soit, on devine ce que peut devenir la sentimentalité localisée, appliquée à une personne chérie, jouant ou ayant joué un rôle important dans la vie morale du malade. Le culte, l’adoration, la prière, les rêves de bonheur se projettent et s’élancent avec l’énergie ambitieuse et l’éclat d’un feu d’artifice ; comme la poudre et les matières colorantes du feu, ils éblouissent et s’évanouissent dans les ténèbres. Il n’est sorte de combinaison sentimentale à laquelle ne puisse se prêter le souple amour d’un esclave du haschisch. Le goût de la protection, un sentiment de paternité ardente et dévouée peuvent se mêler à une sensualité coupable que le haschisch saura toujours excuser et absoudre. Il va plus loin encore. Je suppose des fautes commises ayant laissé dans l’âme des traces amères, un mari ou un amant ne contemplant qu’avec tristesse (dans son état normal) un passé nuancé d’orages ; ces amertumes peuvent alors se changer en douceurs ; le besoin de pardon rend l’imagination plus habile et plus suppliante, et le remords lui-même, dans ce drame diabolique qui ne s’exprime que par un long monologue, peut agir comme excitant et réchauffer puissamment l’enthousiasme du cœur. Oui, le remords ! Avais-je tort de dire que le haschisch apparaissait, à un esprit vraiment philosophique, comme un parfait instrument satanique ? Le remords, singulier ingrédient du plaisir, est bientôt noyé dans la délicieuse contemplation du remords, dans une espèce d’analyse voluptueuse ; et cette analyse est si rapide que l’homme, ce diable naturel, pour parler comme les swedenborgiens, ne s’aperçoit pas combien elle est involontaire, et combien, de seconde en seconde, il se rapproche de la perfection diabolique. Il admire son remords et il se glorifie, pendant qu’il est en train de perdre sa liberté. Voilà donc mon homme supposé, l’esprit de mon choix, arrivé à ce degré de joie et de sérénité où il est contraint de s’admirer lui-même. Toute contradiction s’efface, tous les problèmes philosophiques deviennent limpides, ou du moins paraissent tels. Tout est matière à jouissance. La plénitude de sa vie actuelle lui inspire un orgueil démesuré. Une voix parle en lui (hélas ! c’est la sienne) qui lui dit : « Tu as maintenant le droit de te considérer comme supérieur à tous les hommes ; nul ne connaît et ne pourrait comprendre tout ce que tu penses et tout ce que tu sens ; ils seraient même incapables d’apprécier la bienveillance qu’ils t’inspirent. Tu es un roi que les passants méconnaissent, et qui vit dans la solitude de sa conviction : mais que t’importe ? Ne possèdes-tu pas ce mépris souverain qui rend l’âme si bonne ? » Cependant nous pouvons supposer que de temps à autre un souvenir mordant traverse et corrompe ce bonheur. Une suggestion fournie par l’extérieur peut ranimer un passé désagréable à contempler. De combien d’actions sottes ou viles le passé n’est-il pas rempli, qui sont véritablement indignes de ce roi de la pensée et qui en souillent la dignité idéale ? Croyez que l’homme au haschisch affrontera courageusement ces fantômes pleins de reproches, et même qu’il saura tirer de ces hideux souvenirs de nouveaux éléments de plaisir et d’orgueil. Telle sera l’évolution de son raisonnement : la première sensation de douleur passée, il analysera curieusement cette action ou ce sentiment dont le souvenir a troublé sa glorification actuelle, les motifs qui le faisaient agir alors, les circonstances dont il était environné, et s’il ne trouve pas dans ces circonstances des raisons suffisantes, sinon pour absoudre, au moins pour atténuer son péché, n’imaginez pas qu’il se sente vaincu ! J’assiste à son raisonnement comme au jeu d’un mécanisme sous une vitre transparente : « Cette action ridicule, lâche ou vile, dont le souvenir m’a un moment agité, est en complète contradiction avec ma vraie nature, ma nature actuelle, et l’énergie même avec laquelle je la condamne, le soin inquisitorial avec lequel je l’analyse et je la juge, prouvent mes hautes et divines aptitudes pour la vertu. Combien trouverait-on dans le monde d’hommes aussi habiles pour se juger, aussi sévères pour se condamner ? » Et non seulement il se condamne, mais il se glorifie. L’horrible souvenir ainsi absorbé dans la contemplation d’une vertu idéale, d’une charité idéale, d’un génie idéal, il se livre candidement à sa triomphante orgie spirituelle. Nous avons vu que, contrefaisant d’une manière sacrilège le sacrement de la pénitence, à la fois pénitent et confesseur, il s’était donné une facile absolution, ou, pis encore, qu’il avait tiré de sa condamnation une nouvelle pâture pour son orgueil. Maintenant, de la contemplation de ses rêves et de ses projets de vertu, il conclut à son aptitude pratique à la vertu ; l’énergie amoureuse avec laquelle il embrasse ce fantôme de vertu lui paraît une preuve suffisante, péremptoire, de l’énergie virile nécessaire pour l’accomplissement de son idéal. Il confond complétement le rêve avec l’action, et son imagination s’échauffant de plus en plus devant le spectacle enchanteur de sa propre nature corrigée et idéalisée, substituant cette image fascinatrice de lui-même à son réel individu, si pauvre en volonté, si riche en vanité, il finit par décréter son apothéose en ces termes nets et simples, qui contiennent pour lui tout un monde d’abominables jouissances : « Je suis le plus vertueux de tous les hommes ! » Cela ne vous fait-il pas souvenir de Jean-Jacques, qui, lui aussi, après s’être confessé à l’univers, non sans une certaine volupté, a osé pousser le même cri de triomphe (ou du moins la différence est bien petite) avec la même sincérité et la même conviction ? L’enthousiasme avec lequel il admirait la vertu, l’attendrissement nerveux qui remplissait ses yeux de larmes, à la vue d’une belle action ou à la pensée de toutes les belles actions qu’il aurait voulu accomplir, suffisaient pour lui donner une idée superlative de sa valeur morale. Jean-Jacques s’était enivré sans haschisch. Suivrai-je plus loin l’analyse de cette victorieuse monomanie ? Expliquerai-je comment, sous l’empire du poison, mon homme se fait bientôt centre de l’univers ? comment il devient l’expression vivante et outrée du proverbe qui dit que la passion rapporte tout à elle ? Il croit à sa vertu et à son génie ; ne devine-t-on pas la fin ? Tous les objets environnants sont autant de suggestions qui agitent en lui un monde de pensées, toutes plus colorées, plus vivantes, plus subtiles que jamais et revêtues d’un vernis magique. « Ces villes magnifiques, se dit-il, où les bâtiments superbes sont échelonnés comme dans les décors, — ces beaux navires balancés par les eaux de la rade dans un désœuvrement nostalgique, et qui ont l’air de traduire notre pensée : Quand partons-nous pour le bonheur ? — ces musées qui regorgent de belles formes et de couleurs enivrantes, — ces bibliothèques où sont accumulés les travaux de la science et les rêves de la Muse, — ces instruments rassemblés qui parlent avec une seule voix, — ces femmes enchanteresses, plus charmantes encore par la science de la parure et l’économie du regard, — toutes ces choses ont été créées pour moi, pour moi, pour moi ! Pour moi, l’humanité a travaillé, a été martyrisée, immolée, — pour servir de pâture, de pabulum, à mon implacable appétit d’émotion, de connaissance et de beauté ! » Je saute et j’abrège. Personne ne s’étonnera qu’une pensée finale, suprême, jaillisse du cerveau du rêveur : « Je suis devenu Dieu ! », qu’un cri sauvage, ardent, s’élance de sa poitrine avec une énergie telle, une telle puissance de projection, que, si les volontés et les croyances d’un homme ivre avaient une vertu efficace, ce cri culbuterait les anges disséminés dans les chemins du ciel : « Je suis un Dieu ! » Mais bientôt cet ouragan d’orgueil se transforme en une température de béatitude calme, muette, reposée, et l’universalité des êtres se présente colorée et comme illuminée par une aurore sulfureuse. Si par hasard un vague souvenir se glisse dans l’âme de ce déplorable bienheureux : N’y aurait-il pas un autre Dieu ? croyez qu’il se redressera devant celui-là, qu’il discutera ses volontés et qu’il l’affrontera sans terreur. Quel est le philosophe français qui, pour railler les doctrines allemandes modernes, disait : « Je suis un dieu qui a mal dîné ? » Cette ironie ne mordrait pas sur un esprit enlevé par le haschisch ; il répondrait tranquillement : « Il est possible que j’aie mal dîné, mais je suis un Dieu. » |
|
Charles Baudelaire Les Paradis artificiels |