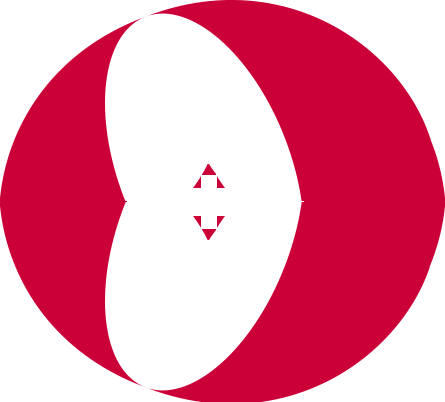| Ïðèîáðåñòè Êóðñ Çíàòîê |
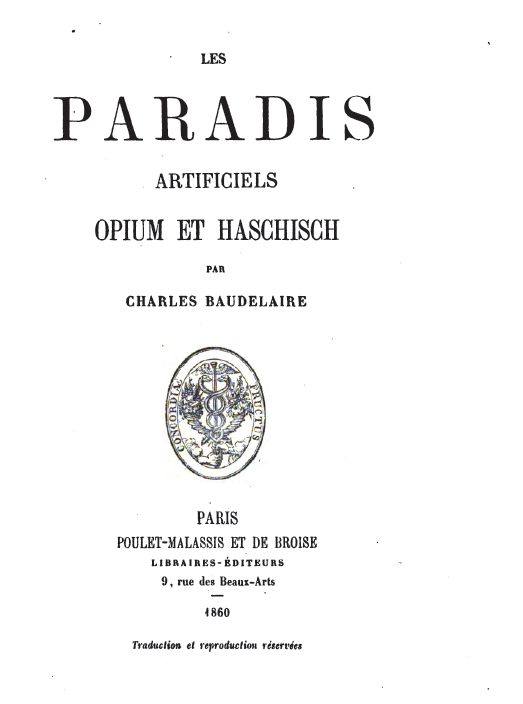 |
012 Livre Charles Baudelaire Les Paradis artificiels |
| LE POËME DU HASCHISCH |
|
IV L’HOMME-DIEU Il est temps de laisser de côté toute cette jonglerie et ces grandes marionnettes, nées de la fumée des cerveaux enfantins. N’avons-nous pas à parler de choses plus graves : des modifications des sentiments humains, et, en un mot, de la morale du haschisch ? Jusqu’à présent je n’ai fait qu’une monographie abrégée de l’ivresse ; je me suis borné à en accentuer les principaux traits, surtout les traits matériels. Mais, ce qui est plus important, je crois, pour l’homme spirituel, c’est de connaître l’action du poison sur la partie spirituelle de l’homme, c’est-à-dire le grossissement, la déformation et l’exagération de ses sentiments habituels et de ses perceptions morales, qui présentent alors, dans une atmosphère exceptionnelle, un véritable phénomène de réfraction. L’homme qui, s’étant livré longtemps à l’opium ou au haschisch, a pu trouver, affaibli comme il l’était par l’habitude de son servage, l’énergie nécessaire pour se délivrer, m’apparaît comme un prisonnier évadé. Il m’inspire plus d’admiration que l’homme prudent qui n’a jamais failli, ayant toujours eu soin d’éviter la tentation. Les Anglais se servent fréquemment, à propos des mangeurs d’opium, de termes qui ne peuvent paraître excessifs qu’aux innocents à qui sont inconnues les horreurs de cette déchéance : enchained, fettered, enslaved ! Chaînes, en effet, auprès desquelles toutes les autres, chaînes du devoir, chaînes de l’amour illégitime, ne sont que des trames de gaze et des tissus d’araignée ! Épouvantable mariage de l’homme avec lui-même ! « J’étais devenu un esclave de l’opium ; il me tenait dans ses liens, et tous mes travaux et mes plans avaient pris la couleur de mes rêves, » dit l’époux de Ligeia ; mais en combien de merveilleux passages Edgar Poe, ce poëte incomparable, ce philosophe non réfuté, qu’il faut toujours citer à propos des maladies mystérieuses de l’esprit, ne décrit-il pas les sombres et attachantes splendeurs de l’opium ? L’amant de la lumineuse Bérénice, Egœus le métaphysicien, parle d’une altération de ses facultés, qui le contraint à donner une valeur anormale, monstrueuse, aux phénomènes les plus simples : « Réfléchir infatigablement de longues heures, l’attention rivée à quelque citation puérile sur la marge ou dans le texte d’un livre, — rester absorbé, la plus grande partie d’une journée d’été, dans une ombre bizarre, s’allongeant obliquement sur la tapisserie ou sur le plancher, — m’oublier une nuit entière à surveiller la flamme droite d’une lampe ou les braises du foyer, — rêver des jours entiers sur le parfum d’une fleur, — répéter d’une manière monotone quelque mot vulgaire, jusqu’à ce que le son, à force d’être répété, cessât de présenter à l’esprit une idée quelconque, — telles étaient quelques-unes des plus communes et des moins pernicieuses aberrations de mes facultés mentales, aberrations qui, sans doute, ne sont pas absolument sans exemple, mais qui défient certainement toute explication et toute analyse. » Et le nerveux Auguste Bedloe qui chaque matin, avant sa promenade, avale sa dose d’opium, nous avoue que le principal bénéfice qu’il tire de cet empoisonnement quotidien, est de prendre à toute chose, même à la plus triviale, un intérêt exagéré : « Cependant l’opium avait produit son effet accoutumé, qui est de revêtir tout le monde extérieur d’une intensité d’intérêt. Dans le tremblement d’une feuille, — dans la couleur d’un brin d’herbe, — dans la forme d’un trèfle, — dans le bourdonnement d’une abeille, — dans l’éclat d’une goutte de rosée, — dans le soupir du vent, — dans les vagues odeurs échappées de la forêt, — se produisait tout un monde d’inspirations, une procession magnifique et bigarrée de pensées désordonnées et rapsodiques. » Ainsi s’exprime, par la bouche de ses personnages, le maître de l’horrible, le prince du mystère. Ces deux caractéristiques de l’opium sont parfaitement applicables au haschisch ; dans l’un comme dans l’autre cas, l’intelligence, libre naguère, devient esclave ; mais le mot rapsodique, qui définit si bien un train de pensées suggéré et commandé par le monde extérieur et le hasard des circonstances, est d’une vérité plus vraie et plus terrible dans le cas du haschisch. Ici, le raisonnement n’est plus qu’une épave à la merci de tous les courants, et le train de pensées est infiniment plus accéléré et plus rapsodique. C’est dire, je crois, d’une manière suffisamment claire, que le haschisch est, dans son effet présent, beaucoup plus véhément que l’opium, beaucoup plus ennemi de la vie régulière, en un mot, beaucoup plus troublant. J’ignore si dix années d’intoxication par le haschisch amèneront des désastres égaux à ceux causés par dix années de régime d’opium ; je dis que, pour l’heure présente et pour le lendemain, le haschisch a des résultats plus funestes ; l’un est un séducteur paisible, l’autre un démon désordonné. Je veux, dans cette dernière partie, définir et analyser le ravage moral causé par cette dangereuse et délicieuse gymnastique, ravage si grand, danger si profond, que ceux qui ne reviennent du combat que légèrement avariés, m’apparaissent comme des braves échappés de la caverne d’un Protée multiforme, des Orphées vainqueurs de l’Enfer. Qu’on prenne, si l’on veut, cette forme de langage pour une métaphore excessive, j’avouerai que les poisons excitants me semblent non seulement un des plus terribles et des plus sûrs moyens dont dispose l’Esprit des Ténèbres pour enrôler et asservir la déplorable humanité, mais même une de ses incorporations les plus parfaites. Cette fois, pour abréger ma tâche et rendre mon analyse plus claire, au lieu de rassembler des anecdotes éparses, j’accumulerai sur un seul personnage fictif une masse d’observations. J’ai donc besoin de supposer une âme de mon choix. Dans ses Confessions, De Quincey affirme avec raison que l’opium, au lieu d’endormir l’homme, l’excite, mais qu’il ne l’excite que dans sa voie naturelle, et qu’ainsi, pour juger les merveilles de l’opium, il serait absurde d’en référer à un marchand de bœufs ; car celui-ci ne rêvera que bœufs et pâturages. Or, je n’ai pas à décrire les lourdes fantaisies d’un éleveur enivré de haschisch ; qui les lirait avec plaisir ? qui consentirait à les lire ? Pour idéaliser mon sujet, je dois en concentrer tous les rayons dans un cercle unique, je dois les polariser ; et le cercle tragique où je les vais rassembler sera, comme je l’ai dit, une âme de mon choix, quelque chose d’analogue à ce que le xviiie siècle appelait l’homme sensible, à ce que l’école romantique nommait l’homme incompris, et à ce que les familles et la masse bourgeoise flétrissent généralement de l’épithète d’original. Un tempérament moitié nerveux, moitié bilieux, tel est le plus favorable aux évolutions d’une pareille ivresse ; ajoutons un esprit cultivé, exercé aux études de la forme et de la couleur ; un cœur tendre, fatigué par le malheur, mais encore prêt au rajeunissement ; nous irons, si vous le voulez bien, jusqu’à admettre des fautes anciennes, et, ce qui doit en résulter dans une nature facilement excitable, sinon des remords positifs, au moins le regret du temps profané et mal rempli. Le goût de la métaphysique, la connaissance des différentes hypothèses de la philosophie sur la destinée humaine, ne sont certainement pas des compléments inutiles, — non plus que cet amour de la vertu, de la vertu abstraite, stoïcienne ou mystique, qui est posé dans tous les livres dont l’enfance moderne fait sa nourriture, comme le plus haut sommet où une âme distinguée puisse monter. Si l’on ajoute à tout cela une grande finesse de sens que j’ai omise comme condition surérogatoire, je crois que j’ai rassemblé les éléments généraux les plus communs de l’homme sensible moderne, de ce que l’on pourrait appeler la forme banale de l’originalité. Voyons maintenant ce que deviendra cette individualité poussée à outrance par le haschisch. Suivons cette procession de l’imagination humaine jusque sous son dernier et plus splendide reposoir, jusqu’à la croyance de l’individu en sa propre divinité. Si vous êtes une de ces âmes, votre amour inné de la forme et de la couleur trouvera tout d’abord une pâture immense dans les premiers développements de votre ivresse. Les couleurs prendront une énergie inaccoutumée et entreront dans le cerveau avec une intensité victorieuse. Délicates, médiocres, ou même mauvaises, les peintures des plafonds revêtiront une vie effrayante ; les plus grossiers papiers peints qui tapissent les murs des auberges se creuseront comme de splendides dioramas. Les nymphes aux chairs éclatantes vous regardent avec de grands yeux plus profonds et plus limpides que le ciel et l’eau ; les personnages de l’antiquité, affublés de leurs costumes sacerdotaux ou militaires, échangent avec vous par le simple regard de solennelles confidences. La sinuosité des lignes est un langage définitivement clair où vous lisez l’agitation et le désir des âmes. Cependant se développe cet état mystérieux et temporaire de l’esprit, où la profondeur de la vie, hérissée de ses problèmes multiples, se révèle tout entière dans le spectacle, si naturel et si trivial qu’il soit, qu’on a sous les yeux, — où le premier objet venu devient symbole parlant. Fourier et Swedenborg, l’un avec ses analogies, l’autre avec ses correspondances, se sont incarnés dans le végétal et l’animal qui tombent sous votre regard, et au lieu d’enseigner par la voix, ils vous endoctrinent par la forme et par la couleur. L’intelligence de l’allégorie prend en vous des proportions à vous-même inconnues ; nous noterons, en passant, que l’allégorie, ce genre si spirituel, que les peintres maladroits nous ont accoutumés à mépriser, mais qui est vraiment l’une des formes primitives et les plus naturelles de la poésie, reprend sa domination légitime dans l’intelligence illuminée par l’ivresse. Le haschisch s’étend alors sur toute la vie comme un vernis magique ; il la colore en solennité et en éclaire toute la profondeur. Paysages dentelés, horizons fuyants, perspectives de villes blanchies par la lividité cadavéreuse de l’orage, ou illuminées par les ardeurs concentrées des soleils couchants, — profondeur de l’espace, allégorie de la profondeur du temps, — la danse, le geste ou la déclamation des comédiens, si vous vous êtes jeté dans un théâtre, — la première phrase venue, si vos yeux tombent sur un livre, — tout enfin, l’universalité des êtres se dresse devant vous avec une gloire nouvelle non soupçonnée jusqu’alors. La grammaire, l’aride grammaire elle-même, devient quelque chose comme une sorcellerie évocatoire ; les mots ressuscitent revêtus de chair et d’os, le substantif, dans sa majesté substantielle, l’adjectif, vêtement transparent qui l’habille et le colore comme un glacis, et le verbe, ange du mouvement, qui donne le branle à la phrase. La musique, autre langue chère aux paresseux ou aux esprits profonds qui cherchent le délassement dans la variété du travail, vous parle de vous-même et vous raconte le poème de votre vie : elle s’incorpore à vous, et vous vous fondez en elle. Elle parle de votre passion, non pas d’une manière vague et indéfinie, comme elle fait dans vos soirées nonchalantes, un jour d’opéra, mais d’une manière circonstanciée, positive, chaque mouvement du rythme marquant un mouvement connu de votre âme, chaque note se transformant en mot, et le poème entier entrant dans votre cerveau comme un dictionnaire doué de vie. À suivre |
|
Charles Baudelaire Les Paradis artificiels |